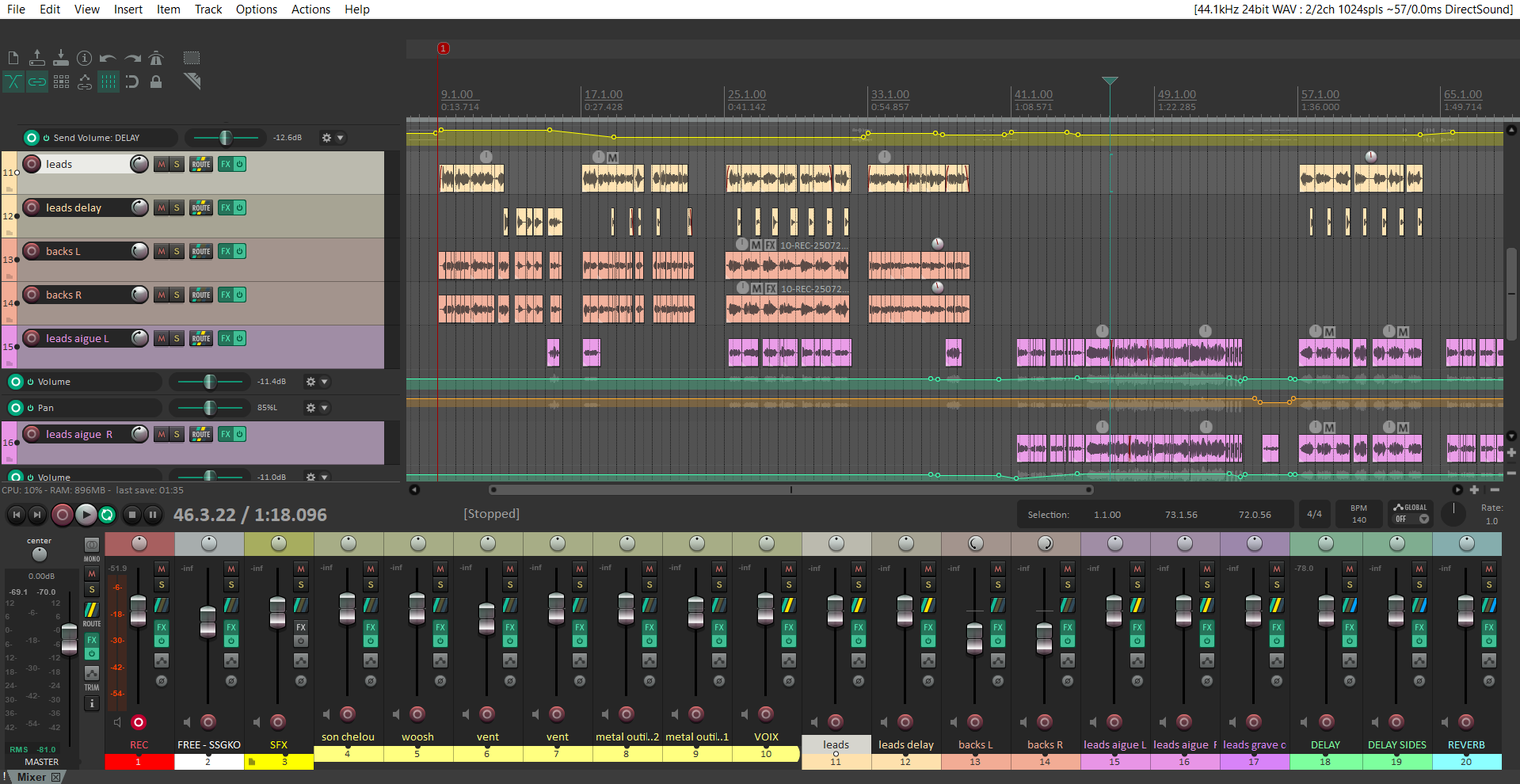

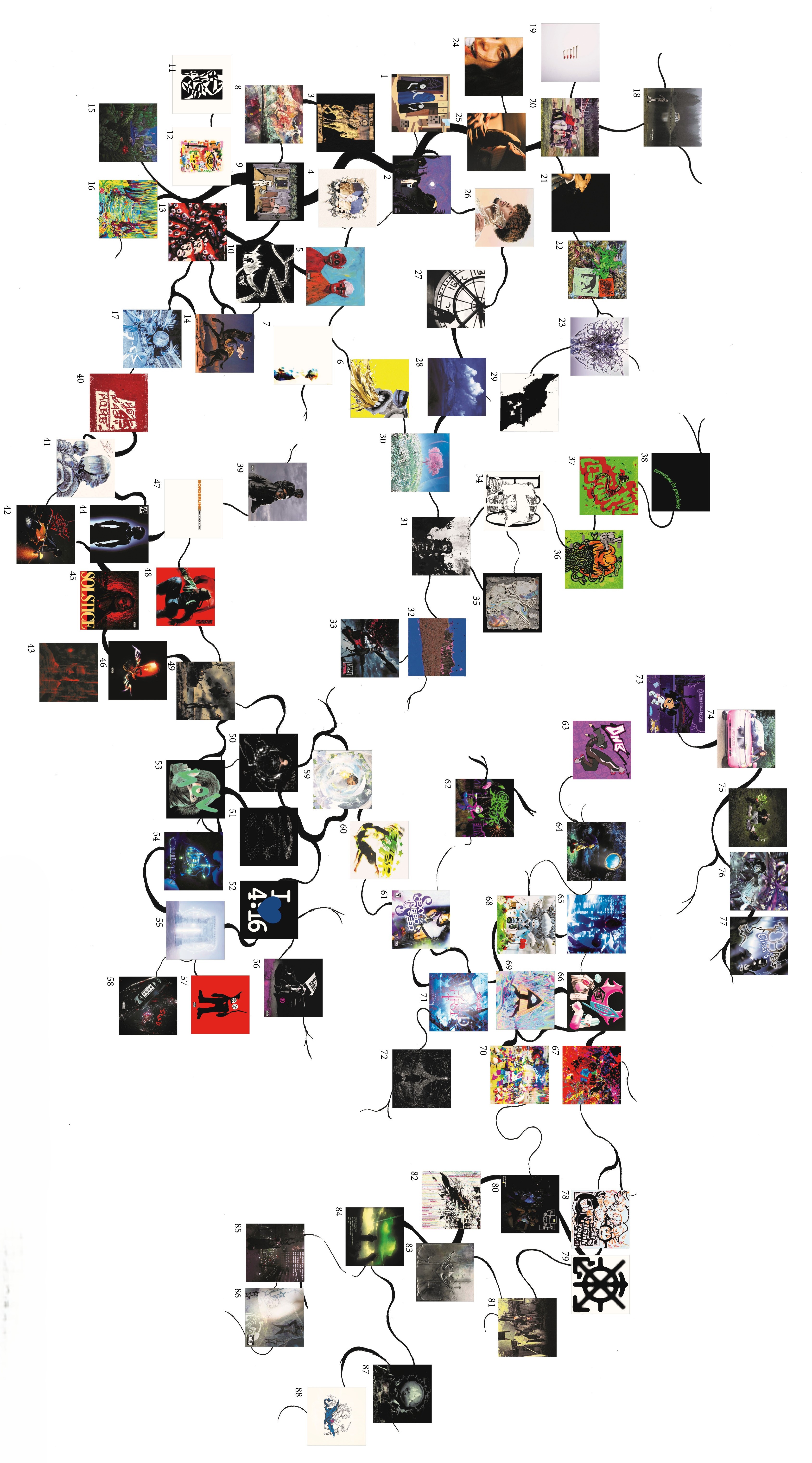
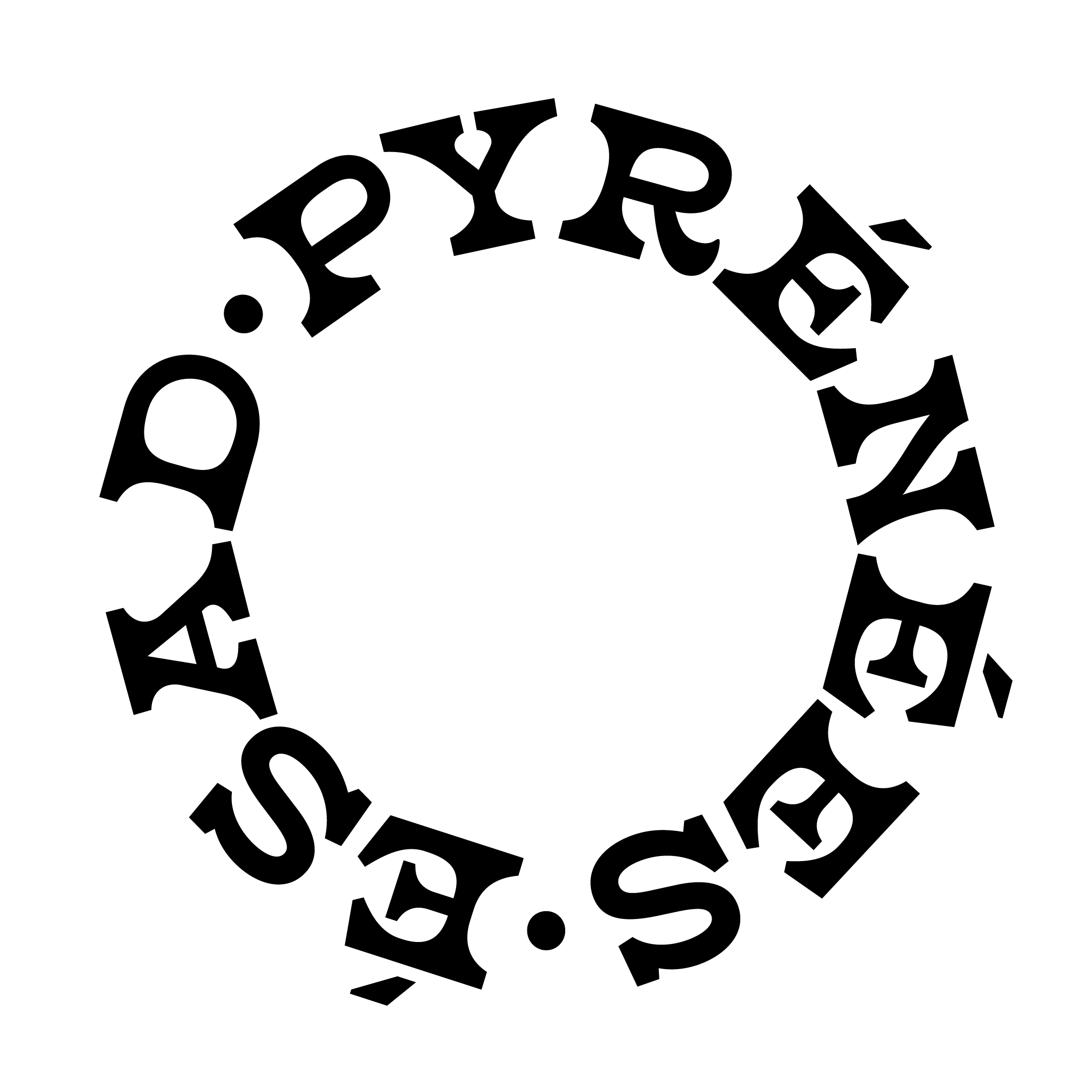 DNSEP Design
DNSEP Design
Ce mémoire vise à explorer les relations entre design graphique et musique indépendante, en recentrant le corpus sur la scène rap underground française. Celle-ci, très prolifique, est surtout remarquable par ses différentes façons d’associer imagerie et musicalité. De ces associations naissent des sous-genres, qui évoluent et développent chacun leur esthétique et leurs codes musicaux et visuels, particulièrement par l’usage des technologies numériques. J’ai ainsi réalisé une carte permettant de naviguer plus facilement dans ce réseau dense, tentaculaire, et qui structure en partie l’argumentation.
La relation entre art musical et art graphique est la source de nombreuses recherches et ouvrages théoriques, cherchant à comprendre comment le visuel et le sonore interagissent, se complètent, fusionnent. Le chercheur Jean-Yves Bosseur a ainsi étudié cette relation en détail dans le cadre de deux ouvrages : Le sonore et le visuel en 19921, et Musique et arts plastiques en 20152. Dans le premier, Bosseur écrivait déjà ceci : « Les tentatives d’échange, voire d’osmose entre les domaines du visuel et du sonore n’ont cessé, à notre époque, de se ramifier et se diversifier »3. Ces ouvrages mettent cependant l’accent sur la partie artistique issue de cette rencontre, celle qui vise à pousser toujours plus loin une hybridation des médiums, « qui [joue] délibérément sur le paradoxe que suppose toute ambition de classification »4. Même au sein du design graphique, qui sera notre champ d’analyse pourtant peu évoqué par Bosseur, on retrouve ce genre de projet ambitieux. Il ne sera pas ici question d’analyser ces derniers, ni comment les designeur·euses explorent cette relation au travers de projets expérimentaux. Nous nous intéresserons plutôt à la manière dont design graphique et musique collaborent et prennent place dans un contexte bien réel de commande et d’existence dans un écosystème bouillonnant.
En effet, notre corpus se centrera autour d’une scène musicale particulièrement active, où le design graphique prend une place importante : la scène rap souterraine francophone. Resserrer ainsi le corpus sur un univers musical très précis permet de poser un cadre, de prendre des exemples concrets, et d’analyser plus finement les œuvres. Cette scène underground possède cependant ses propres codes, son mode de fonctionnement particulier allant de paire avec la culture rap. C’est pourquoi il est important de d’abord définir ce corpus, le contexte culturel dans lequel il prend place, ainsi que les méthodes de travail autour de celui-ci.
Les contours de cette culture sont en réalité très vagues et difficiles à définir : quelles sont les limites de l’"underground" dans le rap ? Qu’est-ce qui fait que les artistes choisi·es s’inscrivent dans ce contexte ? Enregistrer ses morceaux en studio plutôt que dans sa chambre invalide-t’il ce rejet de l’industrie ? D’un autre côté, underground veut-il dire que la diffusion des morceaux est peu importante ? Comment le design graphique intervient-il dans cette phase de médiatisation, de partage des contenus créés au départ dans des espaces privés ? L’accès de plus en plus aisé aux moyens d’enregistrement et de publication incite en effet les artistes débutant·es à travailler depuis chez eux, dans des chambres, des caves, des appartements. L’esthétique homemade est intimement liée à l’underground, qui s’éloigne des moyens traditionnels de production de musique. De plus, ces nouveaux acteurs semblent désireux d’apporter leur touche personnelle à un univers musical de plus en plus polyvalent depuis 2015. La scène souterraine francophone se caractérise donc par sa capacité à pousser les limites du rap de plus en plus loin, notamment par le biais des nouvelles technologies numériques. De cela résulte une explosion de sous-genres, floutant les frontières avec les autres styles de musique.
Lorsque l’on évoque cette scène underground et son rapport avec les technologies numériques, trois notions peuvent y être associées, définies par Pascal Plantard : braconnage, bricolage et butinage. À l’origine utilisées pour discuter des technologies numériques, ces trois comportements s’appliquent en réalité très bien au milieu underground, si l’on définit plus précisément ces termes. Braconner se réfère ainsi à la façon dont les usagers détournent les outils à leur disposition pour s’extraire des carcans prévus et trouver de nouvelles façons d’utiliser ces outils. Le bricolage est déjà très clairement défini par Plantard, c’est « l’art de faire avec ce que l’on a. C’est exécuter un grand nombre de tâches diversifiées dans un univers instrumental clos, avec un ensemble fini d’outils et de matériaux pour réaliser un projet déterminé ». Ce bricolage est ainsi instinctivement pratiqué par tous les usagers de technologies numériques selon Plantard. Enfin, butiner, c’est prendre inspiration dans diverses cultures et univers créatifs pour s’en approprier les imaginaires. Il s’agit ici d’une définition retravaillée par rapport à celle de Plantard, plus pragmatique, mais qui s’applique de ce fait à la façon dont les créateur·ices trouvent l’inspiration pour faire évoluer leurs esthétiques. À partir de ces trois notions, nous pourrons analyser avec plus de précision la façon dont les artistes et designeur·euses s’approprient de nouvelles inspirations, esthétiques, technologies, et construisent de nouveaux imaginaires. Braconnage, bricolage et butinage seront mentionnés puis explicités dans les parties suivantes, en fonction des usages de chaque sous-genre. La présence de l’esthétique homemade dans les milieux créatifs analysés est essentielle, puisque c’est elle qui permet de rattacher la scène rap underground à ces notions.
Malgré ces critères précis de définition, on retrouve tout de même dans
ce corpus une forte activité et une grande diversité de propositions, dues à la forte démocratisation du rap depuis plusieurs années.
L’arrivée de technologies numériques facilitant toujours plus la
création et la mise en ligne de musique a également joué un rôle
important dans cette croissance. Bosseur évoque d’ailleurs parfaitement
l’impact de celles-ci sur la création musicale : « Un objet sonore est
envisagé sous le double aspect de son apparence visuelle et de ses
conséquences acoustiques. Les nouvelles technologies elles-mêmes se
situent au croisement de différents modes d’expression. »5.
Cette citation résume l’importance des nouvelles technologies dans la création
graphique comme musicale. Créer à travers une interface informatique
invite déjà à penser la musique visuellement : les ondes sonores sont
retranscrites par des spectres audios[fig
Ces associations fréquentes entre rappeur·euses et designer·euses
contribuent à développer des esthétiques, qui à leur tour prennent plus
d’ampleur et évoluent en sous-genres. Ces propagations et évolutions
d’esthétiques peuvent se rapporter à la notion de rhizome, définie par
les philosophes français Gilles Deleuze et Félix Guattari. Dans cette
théorie, l’organisation et la division des branchements n’obéit à aucune
hiérarchie, et chaque élément peut en influencer un autre, créant un
nouvel embranchement. Selon ce principe, j’ai pu établir une
cartographie subjective de cette scène souterraine, afin de rendre
compte de ses genres, sous-genres, et sous-sous-genres[fig
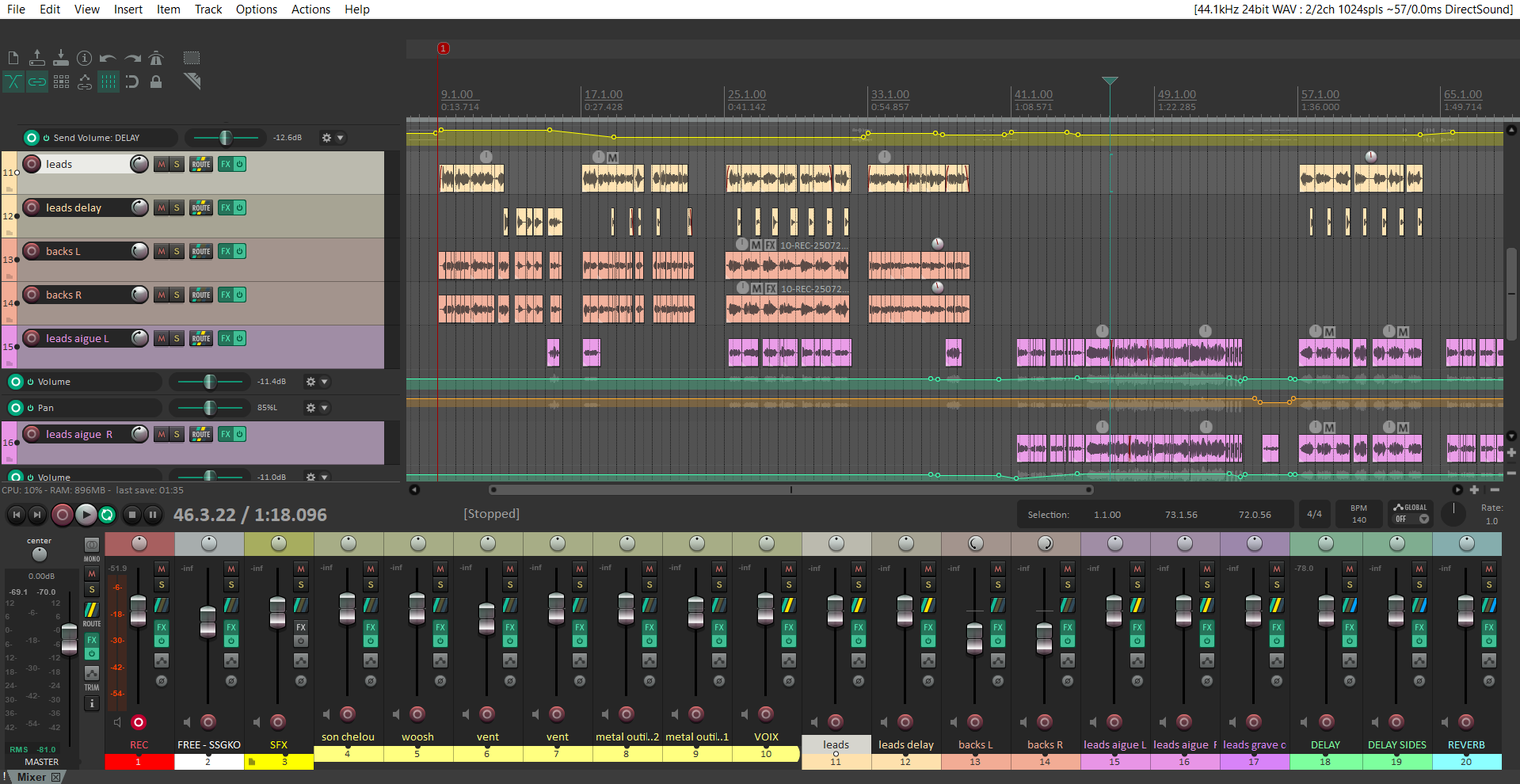

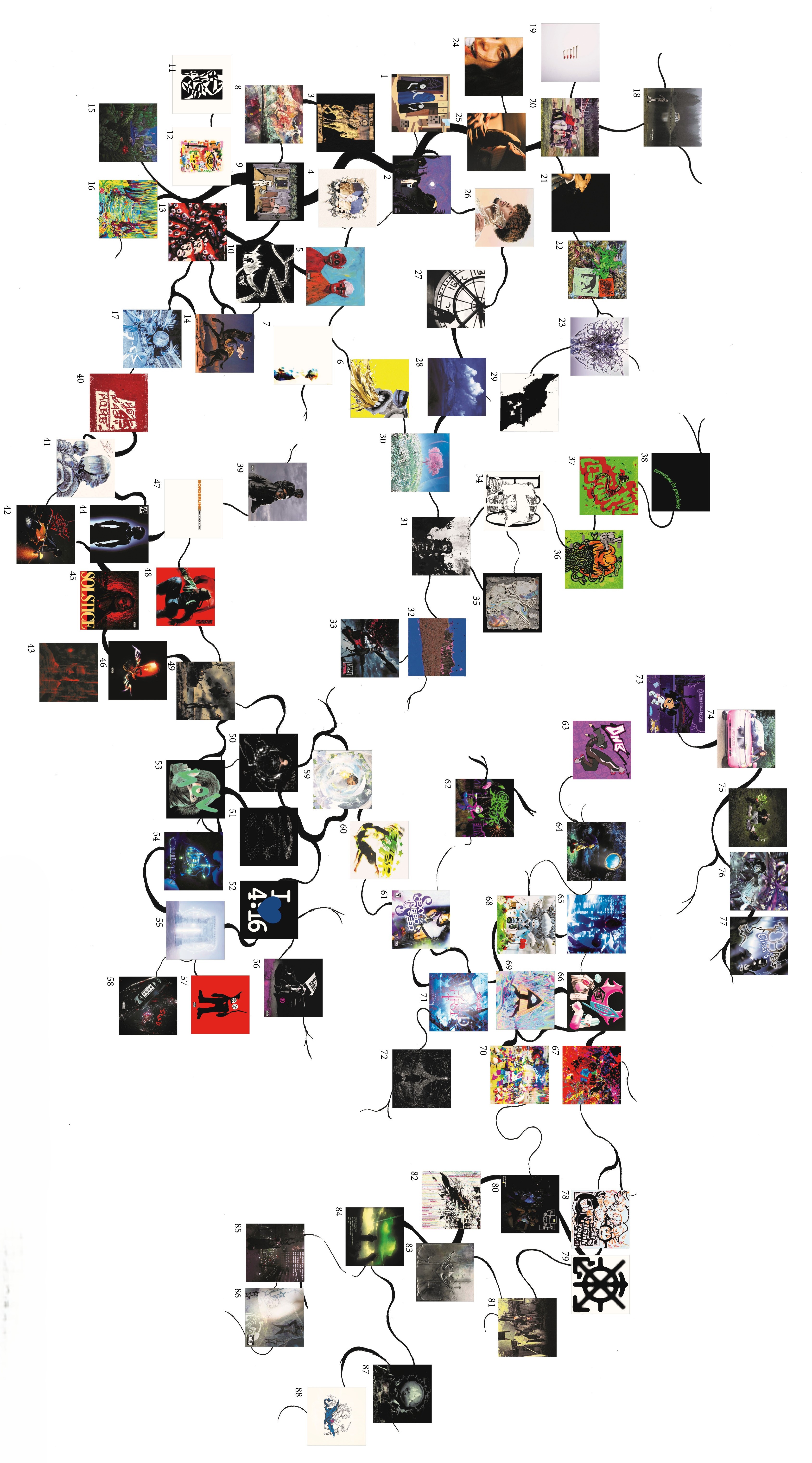
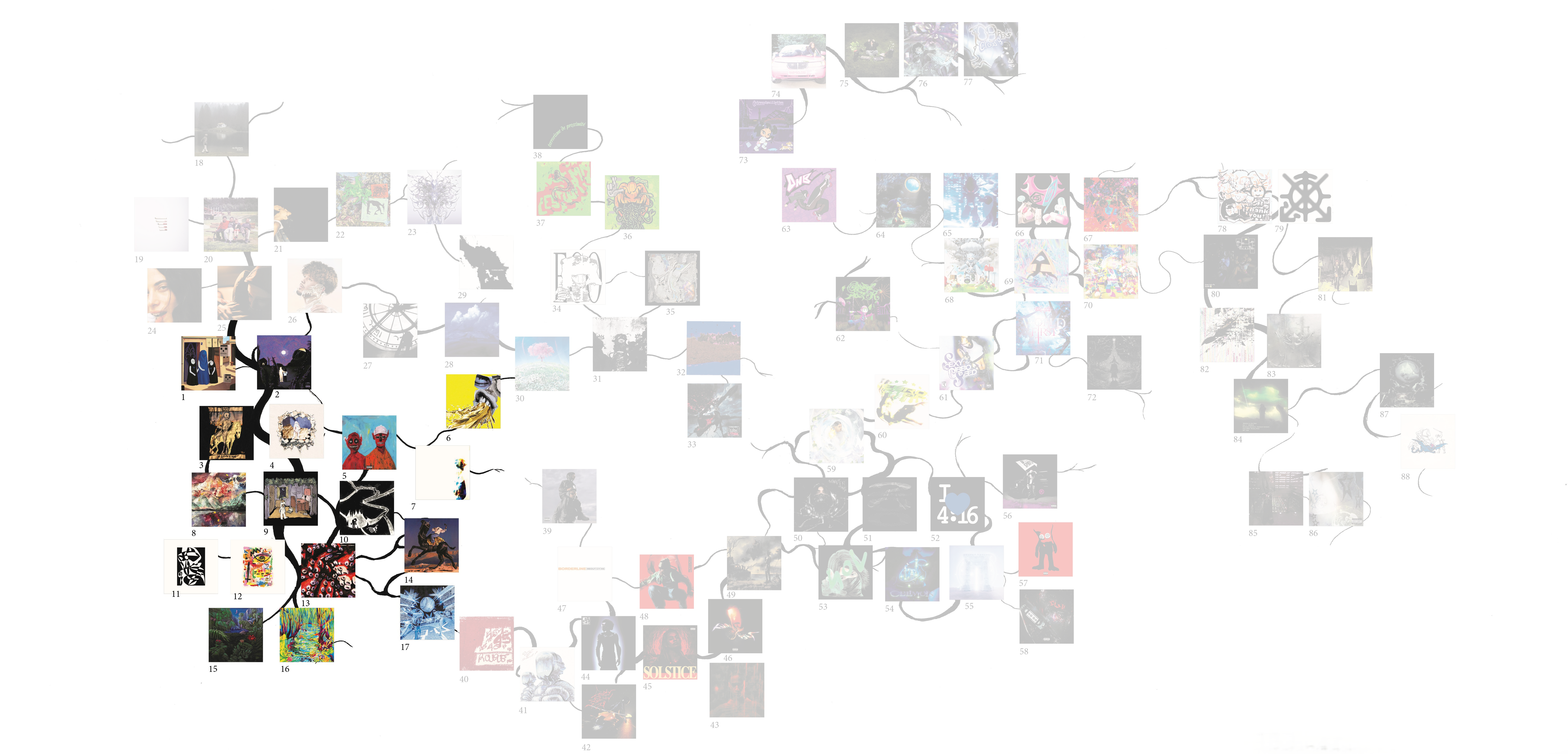
Afin de mieux pouvoir observer les pochettes, et les connexions qui se
font entre elles, munissez vous de la carte, imprimée sur une feuille à part ou
ouverte dans un nouvel onglet afin de pouvoir plonger dedans en détail.
Nous commençons notre étude par la partie gauche, celle qui pose des
bases encore proches du rap « classique » comme il se définit dans
l’inconscient collectif (cf. annexe : Rythmiques dans le rap :
contexte et définitions). Après avoir regroupé les projets, on observe
sur la carte un premier ensemble avec une forte dominante de pochettes
utilisant les arts plastiques. La peinture s’impose comme une
incontournable, présente sur une bonne dizaine de pochettes, mais des
subtilités viennent s’ajouter au corpus : des collages comme sur la
pochette de GOLDMAKER d’Ajna, du papier à gratter sur 3ème cycle de
H Jeunecrack, ou même de la couture sur XIII et Brûler la maison
d’Asinine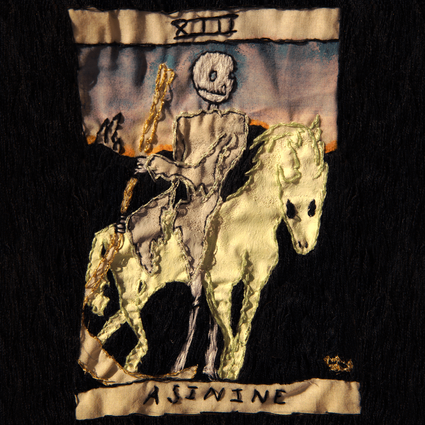 Asinine, XIII, 2023. L’illustration se fait ici tangible, avec des matériaux
réels, comme pour faire appel à une époque où la matérialité dominait.
Le graphisme est utilisé comme sorte d’ancre au réel, pour signaler que
ce rap ne se noie pas encore totalement dans l’usage du numérique.
Au-delà de sa caractéristique matérielle, l’illustration sur ces
pochettes se montre souvent figurative. Les pochettes dépeignent des
scènes, des personnages, des éléments renvoyant au contenu de la
musique. L’illustration fait souvent le choix de s’appuyer sur le
contenu textuel du projet, puisque celui-ci prévaut. On retrouve ainsi
très explicitement une jungle illustrée à la manière du Douanier
Rousseau sur la pochette de Jungle des illusions vol.1 de Jungle Jack
Asinine, XIII, 2023. L’illustration se fait ici tangible, avec des matériaux
réels, comme pour faire appel à une époque où la matérialité dominait.
Le graphisme est utilisé comme sorte d’ancre au réel, pour signaler que
ce rap ne se noie pas encore totalement dans l’usage du numérique.
Au-delà de sa caractéristique matérielle, l’illustration sur ces
pochettes se montre souvent figurative. Les pochettes dépeignent des
scènes, des personnages, des éléments renvoyant au contenu de la
musique. L’illustration fait souvent le choix de s’appuyer sur le
contenu textuel du projet, puisque celui-ci prévaut. On retrouve ainsi
très explicitement une jungle illustrée à la manière du Douanier
Rousseau sur la pochette de Jungle des illusions vol.1 de Jungle Jack Jungle Jack, JUNGLE DES ILLUSIONS VOL
Jungle Jack, JUNGLE DES ILLUSIONS VOL
À côté des créations plus plastiques, on retrouve un autre ensemble dans
cette partie gauche de la carte. Dans celui-ci, les artistes partagent
une pratique commune et prononcée du braconnage, au sens où l’entend
Pascal Plantard, notamment par la pratique du sample* qui sera détaillée
plus tard. Ce braconnage est en réalité pratiqué par toute la scène
underground, où les artistes trouvent des moyens détournés d’accéder aux
outils numériques qui sont désormais nécessaires pour créer leur
musique, leurs pochettes, leurs affiches. Ainsi, les logiciels crackés
sont légion, d’abord par manque de budget mais plus subtilement par
revendication. Michel de Certeau, ayant inspiré à Plantard sa notion de
braconnage, parlait déjà en 1980 de « micro-résistances », des pratiques
quotidiennes et individuelles qui constituent un moyen de s’échapper de
son rôle de simple consommateur. Ces résistances se manifestent au
travers d’une « créativité cachée dans un enchevêtrement de ruses
silencieuses et subtiles, efficaces, par lesquelles chacun s’invente une
manière propre de cheminer à travers la forêt des produits imposés »6. Travailler avec un logiciel cracké, que ce soit un DAW* ou la
suite Adobe, c’est refuser la domination monétaire, la privatisation
générale des outils qui forment la norme créative. Malgré cela, les
artistes continuent à utiliser ces logiciels, ce qui constitue en soi un
paradoxe. Des piques sont ainsi souvent lancées par les rappeur·euses, soulignant l’absurdité de créer la musique qui les fait vivre sur des
logiciels propriétaires piratés : « Ableton cracké, ils devraient
m’offrir la licence » (H Jeunecrack, Catenaccio)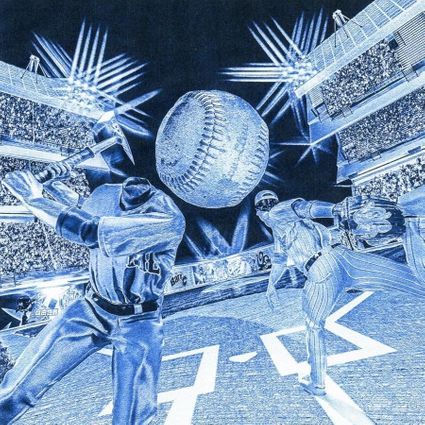 H Jeunecrack & Mairo, Catenaccio, dans l’EP La solution, 2024.
H Jeunecrack & Mairo, Catenaccio, dans l’EP La solution, 2024.
Comme évoqué précédemment, ce braconnage intervient particulièrement dans cette partie de la carte du fait de
l’héritage musical revendiqué par les artistes. Le sample est en effet
un procédé de création musicale utilisé depuis les origines de la
culture hip-hop, et reste toujours très présent encore aujourd’hui dans
le rap. Sampler consiste à extraire quelques mesures d’un morceau déjà
existant puis les retravailler, les découper, les réagencer, les
boucler, pour qu’au final en ressorte une nouvelle œuvre, dans le cas du
rap une instrumentale*. La légitimité du sample, la question des droits
d’auteur que cet emprunt soulève, ainsi que la valeur créative de
s’appuyer sur une mélodie déjà existante sont des débats infinis tenus
depuis des décennies. Les rappeur·euses ne s’encombrent pas de ces
débats, et se considèrent dans leur droit de créer à partir de tout ce
qui existe. Ce braconnage sert encore une fois un double propos, celui
de la liberté créative, mais aussi une position politique. Comme le
soulignent Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours dans leur ouvrage dédié
Monter Sampler : L’échantillonage généralisé, l’ère du numérique donne
un nouveau sens à l’acte de sampler : « la dématérialisation des
supports, l’absence de déperdition de qualité entre original et copie
mettent en crise leur statut respectif. (…) La reproduction libre et
fidèle induit une circulation des œuvres qui échappe à l’industrie ».
Cette dernière est ici sous entendue capitaliste et désireuse de garder
la mainmise sur les œuvres qui ne sont pour elle que potentielle source
de revenus financiers. « Pour [l’industrie], reproduire, télécharger
sont des actes de piraterie quand ils ne sont pas accompagnés d’une
redevance. Au travers des outils de reproduction et de diffusion se
dégagent des zones de libre échange, qui échappent pour le moment aux
lois de la performance économique »7. Sampler, braconner, c’est donc
s’opposer à l’idée que chaque œuvre est un objet fini, cloisonné.
Réutiliser un morceau, comme faire un collage à partir de photos ou de
tableaux permet aux artistes d’invoquer un imaginaire, de faire
référence, de raconter une histoire sans même mettre de mots dessus.
Lorsque Mairo sample la boucle de piano du morceau Intro du duo
légendaire Ärsenik, il s’agit d’un véritable hommage. Le duo est en
effet source d’inspiration pour beaucoup de rappeur·euses encore
aujourd’hui, notamment grâce à leur album phare sorti en 1998, Quelques
gouttes suffisent… 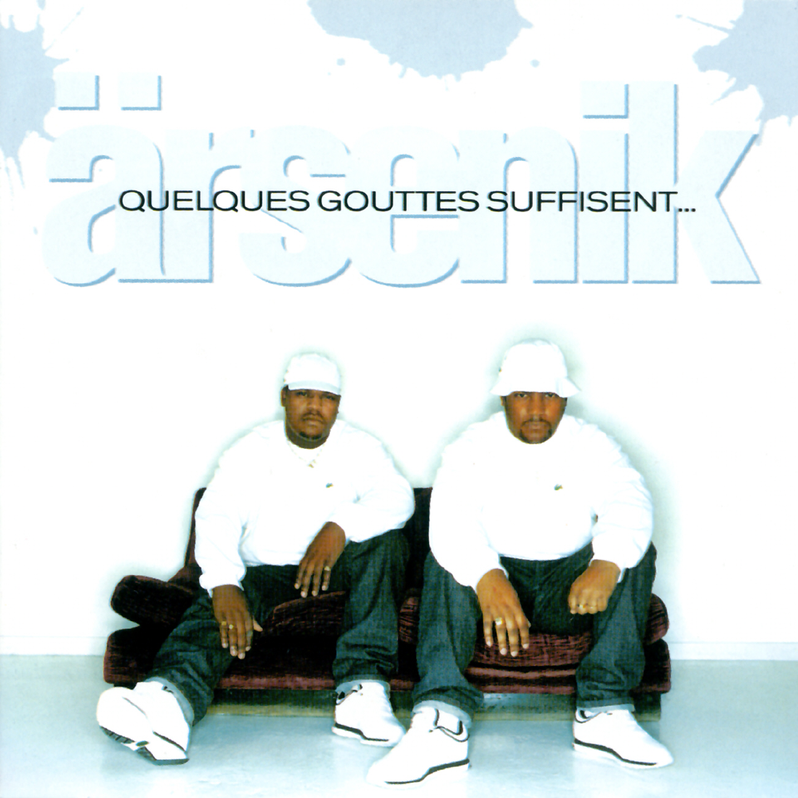 Ärsenik, Intro dans l’album Quelques gouttes suffisent…, 1998 La citation prend encore plus de sens en la
plaçant dans le morceau introduisant à son tour son EP omar chappier,
la mouche.
Ärsenik, Intro dans l’album Quelques gouttes suffisent…, 1998 La citation prend encore plus de sens en la
plaçant dans le morceau introduisant à son tour son EP omar chappier,
la mouche.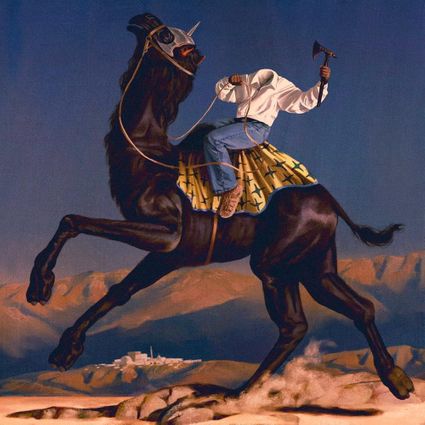 Mairo, la mouche, dans l’EP omar chappier, sample à partir de 0:43 secondes, 2024 Mairo revendique d’ailleurs explicitement son
inspiration dans un autre morceau : « J’écoute Lino, Calbo et
Nakk »8 les deux premiers rappeurs formant le duo Ärsenik. John
Oswald, un compositeur pratiquant le sample depuis son enfance, résume
cet état d’esprit : « les samples ne remplaceront jamais le piano. Ils
ne font que le rappeler. Le sample met davantage en valeur la musique
originale qu’il ne la détériore ». Le compositeur va même plus loin, et
rejoint Beauvais et Bouhours dans leur vision de l’industrie artistique
à l’ère des technologies numériques : « Il est inutile de tenter de
passer par l’étroite fenêtre du Copyright, alors que la porte est grande
ouverte. Si vous samplez, créditez. Et si vous avez été samplé, dites-vous que c’est un honneur »9.
Mairo, la mouche, dans l’EP omar chappier, sample à partir de 0:43 secondes, 2024 Mairo revendique d’ailleurs explicitement son
inspiration dans un autre morceau : « J’écoute Lino, Calbo et
Nakk »8 les deux premiers rappeurs formant le duo Ärsenik. John
Oswald, un compositeur pratiquant le sample depuis son enfance, résume
cet état d’esprit : « les samples ne remplaceront jamais le piano. Ils
ne font que le rappeler. Le sample met davantage en valeur la musique
originale qu’il ne la détériore ». Le compositeur va même plus loin, et
rejoint Beauvais et Bouhours dans leur vision de l’industrie artistique
à l’ère des technologies numériques : « Il est inutile de tenter de
passer par l’étroite fenêtre du Copyright, alors que la porte est grande
ouverte. Si vous samplez, créditez. Et si vous avez été samplé, dites-vous que c’est un honneur »9.
Ainsi, par l’inspiration et le braconnage d’esthétiques déjà existantes, les artistes de ce courant construisent leur musique comme une sorte d’hommage à leur culture. Cela n’est cependant pas leur seul objectif, puisqu’ils participent à faire évoluer cette dernière. Les nouvelles rythmiques des instrumentales, l’imagerie faisant appel aux arts classiques, sont par exemple absentes des vieux classiques du rap, et sont donc des constructions artistiques datant de cette nouvelle génération. L’association entre graphisme et musique a ici contribué à faire évoluer cette frange du rap.
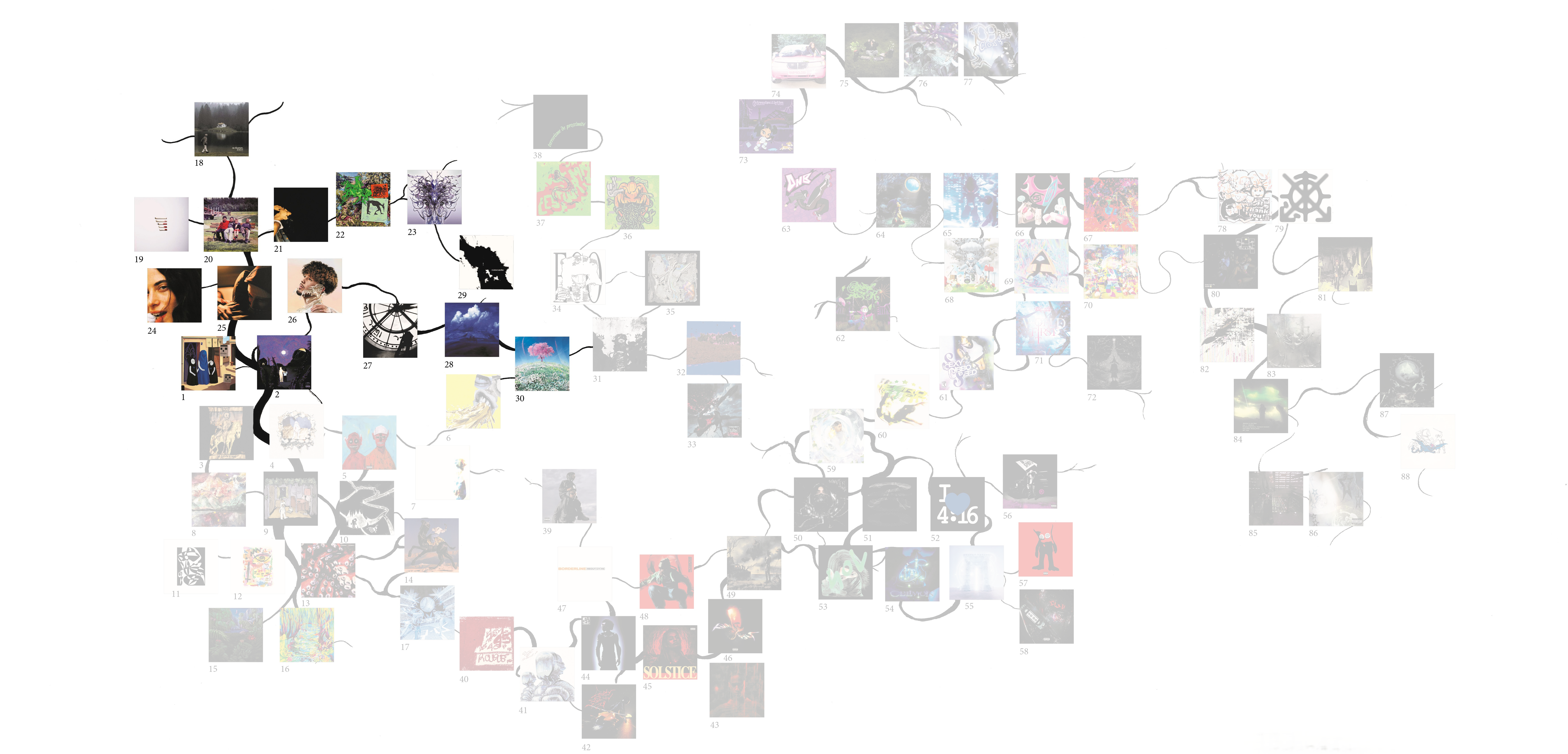
Un écosystème dérivé se forme d’ailleurs à partir de ces évolutions, s’éloignant des codes musicaux et graphiques que nous venons d’analyser, mais toujours attaché à un fond proche du rap old-school au sens
propre. On pourra trouver cette frange du rap lyrique s’étendant
au-dessus des projets évoqués plus tôt, toujours dans la partie gauche.
Les artistes y montrent leurs côtés les plus vulnérables, mélancoliques, introspectifs. Cette intimité était jusqu’alors relativement dissimulée
dans le rap, peut-être par pudeur mais surtout pour montrer une version
de soi idéalisée à un public en quête de personnalités fortes. Ce n’est
que récemment que des artistes écrivant sur des sujets plus personnels
ont émergé. Khali parle de santé mentale en profondeur, sujet pourtant
évité dans les milieux sociaux dont il est issu : « Chez nous le psy ça
n’existe pas. Chez nous tu pries pour que la tristesse passe »(Khali, NO PSY)  Khali, NO PSY, dans l’album IL ME RESSEMBLE PAS NON PLUS, 2022.
Wallace Cleaver, lui, dépeint la nostalgie d’une enfance dans une
campagne loin de la capitale10. Ces paroles mélancoliques sont
presque toujours accompagnées d’instruments plus organiques que dans les
prods trap* actuelles, comme du piano, grand favori, de la guitare, voire
du violon. Les percussions restent présentes, nécessaires pour appuyer
le rythme et garder une attache au milieu d’origine : le rap. Même ce
dernier est sujet à beaucoup d’évolution, puisque la plupart des
artistes de cette nouvelle génération se tournent souvent vers le chant, plus mélodieux, pour communiquer des émotions. Se montrer vulnérable et
exposer ses pensées les plus intimes est d’abord une thérapie pour les
artistes, mais aussi un moyen de lancer une réflexion chez les
auditeur·ices rap, qui avant les années 2015 avaient peu l’occasion
d’entendre de tels sujets dans le paysage rap. Pour les plus jeunes
générations en particulier, ce dialogue revêt beaucoup d’importance, puisque ces personnalités deviennent comme des modèles, des figures de
référence.
Khali, NO PSY, dans l’album IL ME RESSEMBLE PAS NON PLUS, 2022.
Wallace Cleaver, lui, dépeint la nostalgie d’une enfance dans une
campagne loin de la capitale10. Ces paroles mélancoliques sont
presque toujours accompagnées d’instruments plus organiques que dans les
prods trap* actuelles, comme du piano, grand favori, de la guitare, voire
du violon. Les percussions restent présentes, nécessaires pour appuyer
le rythme et garder une attache au milieu d’origine : le rap. Même ce
dernier est sujet à beaucoup d’évolution, puisque la plupart des
artistes de cette nouvelle génération se tournent souvent vers le chant, plus mélodieux, pour communiquer des émotions. Se montrer vulnérable et
exposer ses pensées les plus intimes est d’abord une thérapie pour les
artistes, mais aussi un moyen de lancer une réflexion chez les
auditeur·ices rap, qui avant les années 2015 avaient peu l’occasion
d’entendre de tels sujets dans le paysage rap. Pour les plus jeunes
générations en particulier, ce dialogue revêt beaucoup d’importance, puisque ces personnalités deviennent comme des modèles, des figures de
référence.
La mise en image de ces morceaux poursuit cette volonté d’ouverture
sentimentale : le design graphique au sens propre s’efface, tout juste
le temps d’une typographie discrète. Il laisse ainsi la place à une
réalité plus terre à terre, comme pour y ancrer les émotions évoquées
dans les morceaux. La photographie est donc le médium privilégié dans la
conception de ces pochettes, capturant des instants de vie comme
l’étreinte franche de l’EP 41BORO de Wallace Cleaver, ou une simple
cigarette sur REGARDE de Henri Bleu. Wallace Cleaver choisira même de
pousser le lien entre ses paroles et leur mise en image sur la pochette
de son album à la recherche du temps perdu[fig
De la même façon, les artistes en quête d’un rap plus intime regroupés
dans cette partie de la carte font le choix d’une esthétique plus proche
de la réalité, moins colorée, comme un reflet de leur vision du monde.
Cependant, malgré cette ouverture et cette entrée dans l’intimité, on
remarque, comme avec les imageries peintes, une mise à distance de
l’image du ou de la rappeur·euse. L’artiste n’apparaît jamais
véritablement ni entièrement sur les pochettes. Khali montrera ainsi son
double modélisé en 3D sur IL NE ME RESSEMBLE PAS NON PLUS, Bupropion.
tourne le dos à l’objectif sur haven [fig
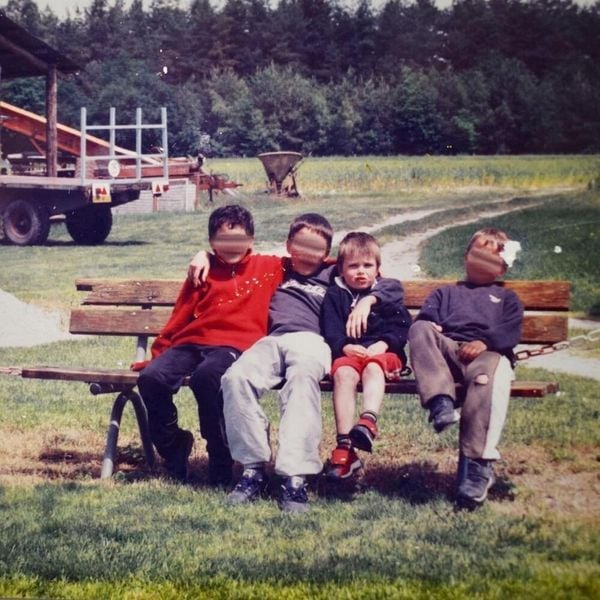
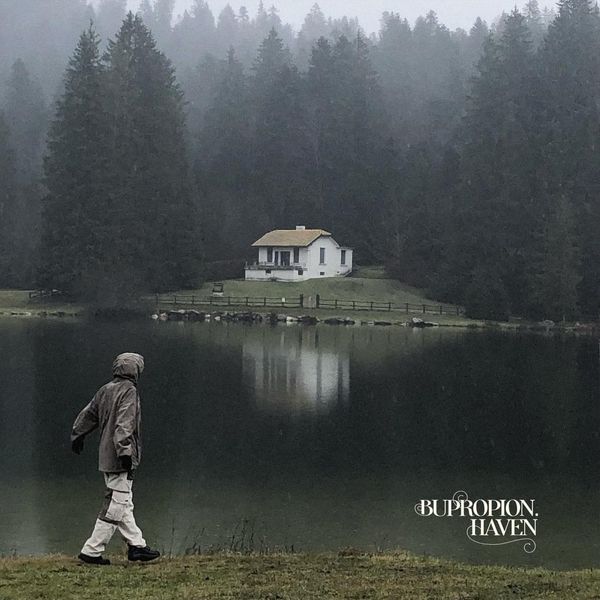
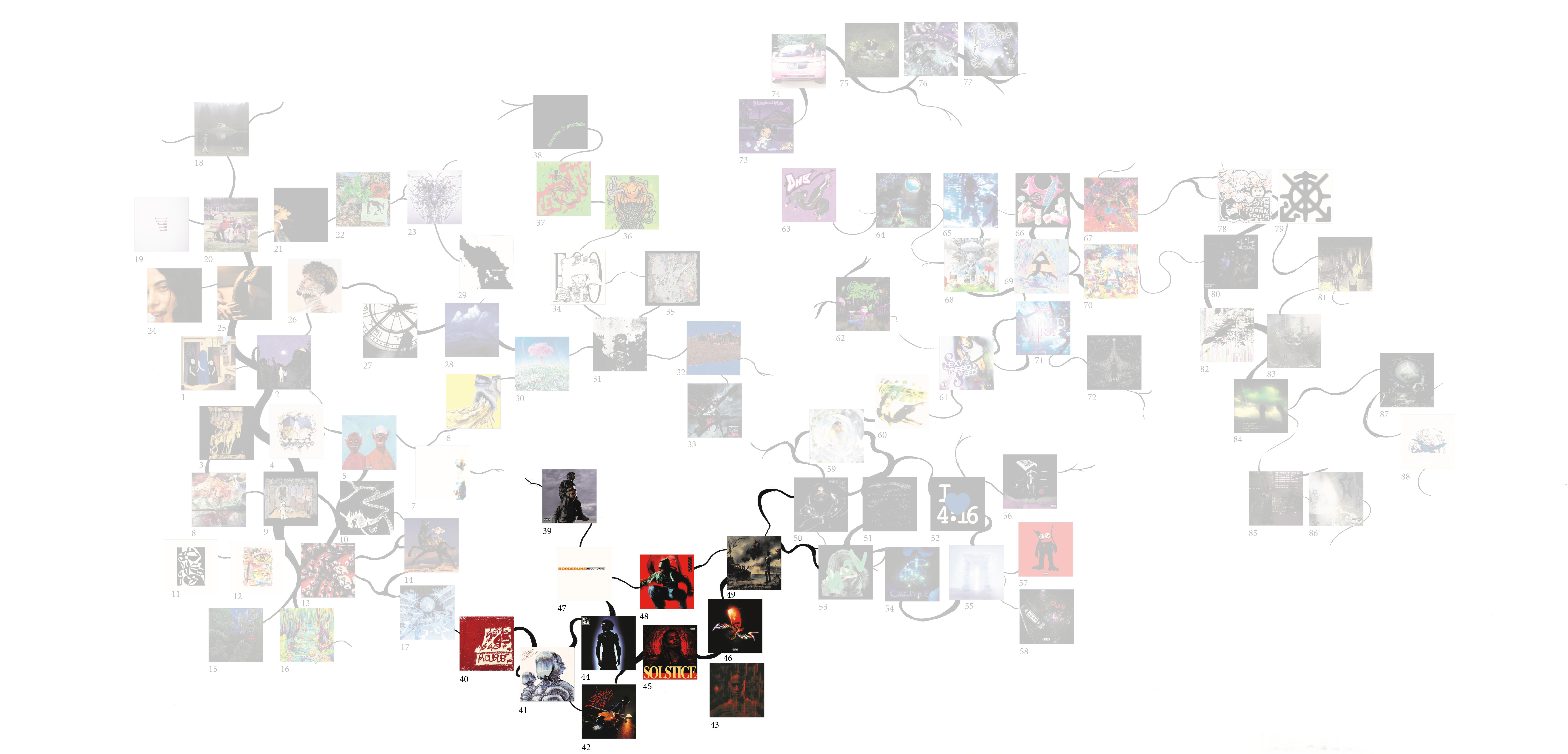
En naviguant plus à droite dans la carte, nous entrons dans une nouvelle
strate du rap underground français, une descendante directe de ce rap
lyrique et technique. La plupart des artistes présent·es ici ont fait le
choix de mettre en avant leur personnalité forte, reflet de leur
ambition mais aussi passion pour cette musique dont ils ont construit
l’évolution. Si les artistes précédemment cité·es tiraient leur héritage
de la culture hip-hop précédant les années 2010, on pourrait argumenter
qu’ici, il s’agit plutôt de faire évoluer la trap plus tardive. Il
s’agit moins de faire passer un message social ou politique que
d’imposer un style flamboyant, d’attirer le regard et surtout l’oreille.
Musicalement, cette volonté se traduit par des instrumentales plus
complexes, complètes et parfois évolutives, parfois presque
symphoniques. Les boucles de sample et de percussions répétées toutes
les quatre mesures se muent en des structures de morceaux plus complexes : intros, couplets, pré-refrains, refrains, ponts, outros… Tant de
choix musicaux peu exploités (bien que tout de même présents) par les
rappeur·euses précédent·es plus axé·es sur le fond. Ces structures
permettent aux artistes de développer des univers imagés plus détaillés, avec une manière différente de ce que feraient les seules paroles.
Ainsi, un artiste comme Slimka se met en scène en différents personnages
au fil des projets, en passant des inspirations de films d’action comme
Old Boy Slimka, Rainbow, dans l’album Tunnel Vision. Clip réalisé par le collectif Exit Void ou Kill Bill
Slimka, Rainbow, dans l’album Tunnel Vision. Clip réalisé par le collectif Exit Void ou Kill Bill Slimka, Headshot, dans l’album Tunnel Vision. Clip réalisé par le collectif Exit Void pour les clips de son album Tunnel
Vision en 2021, jusqu’à développer une personnalité à part entière, apparence physique comprise, pour Le Grand Mystico en 2023. Le lien
entre musique et mise en image de ces albums se fait ici de lui-même, mais il est favorisé entre autres par l’attention apportée aux détails
des instrumentales. Dans Le Grand Mystico, les cuivres, trompettes, et
d’autres instruments typiquement associés aux musiques festives, foraines (comme dans Jamais comme les autres), créent un univers
cohérent au fil des morceaux. On les retrouve d’ailleurs dans un détail
de la pochette de l’album, comme s’ils étaient indissociables de
l’imagerie de celui-ci. Ces instruments, lorsque couplés à des sonorités
plus électroniques, comme des basses très fortes et sombres, donnent à
l’album une tournure inquiétante, presque malsaine, conçue pour
surprendre, voire choquer l’oreille non avertie. Le look adopté par
l’artiste semble avoir la même visée : cheveux coiffés en grandes piques
et vêtements excentriques, pleins de pointes et de lanières de cuir
Slimka, Headshot, dans l’album Tunnel Vision. Clip réalisé par le collectif Exit Void pour les clips de son album Tunnel
Vision en 2021, jusqu’à développer une personnalité à part entière, apparence physique comprise, pour Le Grand Mystico en 2023. Le lien
entre musique et mise en image de ces albums se fait ici de lui-même, mais il est favorisé entre autres par l’attention apportée aux détails
des instrumentales. Dans Le Grand Mystico, les cuivres, trompettes, et
d’autres instruments typiquement associés aux musiques festives, foraines (comme dans Jamais comme les autres), créent un univers
cohérent au fil des morceaux. On les retrouve d’ailleurs dans un détail
de la pochette de l’album, comme s’ils étaient indissociables de
l’imagerie de celui-ci. Ces instruments, lorsque couplés à des sonorités
plus électroniques, comme des basses très fortes et sombres, donnent à
l’album une tournure inquiétante, presque malsaine, conçue pour
surprendre, voire choquer l’oreille non avertie. Le look adopté par
l’artiste semble avoir la même visée : cheveux coiffés en grandes piques
et vêtements excentriques, pleins de pointes et de lanières de cuir Slimka dans son accoutrement représentant son personnage décrit dans l’album Le Grand Mystico. La
mise en image de ces personnages est très importante pour Slimka mais
aussi pour les autres artistes, puisqu’il s’agit d’une projection de
leur intention artistique. On retrouve donc les rappeur·euses eux-mêmes
sur la grande majorité des pochettes de cette partie de la carte. Les
couleurs utilisées sont également parlantes, puisqu’on observe une
dominante de rouge vif (sur Solstice de Lala &ce, Deadly Poison
Sting de Baby Hayabusa et RECHERCHE&DESTRUCTION de Jolagreen23
Slimka dans son accoutrement représentant son personnage décrit dans l’album Le Grand Mystico. La
mise en image de ces personnages est très importante pour Slimka mais
aussi pour les autres artistes, puisqu’il s’agit d’une projection de
leur intention artistique. On retrouve donc les rappeur·euses eux-mêmes
sur la grande majorité des pochettes de cette partie de la carte. Les
couleurs utilisées sont également parlantes, puisqu’on observe une
dominante de rouge vif (sur Solstice de Lala &ce, Deadly Poison
Sting de Baby Hayabusa et RECHERCHE&DESTRUCTION de Jolagreen23 Jolagreen23, RECHERCHE&DESTRUCTION, 2023), traduisant les émotions fortes que procurent ces morceaux de trap plus
assurés, voire agressifs que ce qui se fait ailleurs.
Jolagreen23, RECHERCHE&DESTRUCTION, 2023), traduisant les émotions fortes que procurent ces morceaux de trap plus
assurés, voire agressifs que ce qui se fait ailleurs.
Cette mise en avant des artistes s’accompagne d’un travail graphique
plus prononcé, toujours dans une volonté de prolonger l’univers musical
le plus loin possible, de lui construire une véritable identité. Pour
reprendre l’exemple de l’album de Slimka, la communication autour de ce
dernier, coordonnée par le directeur artistique Kenzo RPTG, utilise la
police dessinée par Robin Pitchon, la Triliad[fig
Dans cette partie de la carte, les artistes tendent à peu utiliser ou
revendiquer la pratique du bricolage pour construire leurs esthétiques.
Les collaborations avec d’autres créateur·ices gravitant autour de cette
scène underground aideront à la place à construire une esthétique
poussée : rappeur·euses, illustrateur·ices, graphistes, typographes, réalisateur·ices… On retrouve en réalité ce type de collaborations
partout dans la cartographie, mais celles évoquées ici sont
particulièrement nourries par la volonté de créer des projets aux
univers riches. Les rencontres, la création d’un réseau permettent de
mutualiser des compétences, des connaissances, palliant le manque de
moyens, le bricolage, et le braconnage. Travailler avec d’autres
artistes, dans le domaine musical comme graphique, c’est trouver de
nouvelles inspirations, de nouvelles esthétiques, mais aussi
s’entraider, chacun apportant sa maîtrise de ses compétences. Les
featurings sont ici la partie immergée de l’iceberg : les rappeur·euses
et beatmaker·euses underground collaborent entre elles et eux au fil des
rencontres et des affinités musicales, contrairement à la partie plus
industrielle du rap qui vise à faire se rencontrer les plus grosses
têtes d’affiche pour générer des succès commerciaux. Au delà de l’aspect
musical, on retrouve ainsi des associations de rappeur·euses et de
graphistes ou de réalisateur·ices qui contribuent à former ces
écosystèmes très soudés. L’exemple le plus notable dans cette partie de
la carte serait celui du collectif Holow composé de deux personnes, que
l’on retrouvera entre autres sur des projets comme Faded Flower Story
et Deadly Poison Sting de baby hayabusa, mais aussi avec d’autres
artistes évoluant dans une autre partie de la carte. On retrouvera ainsi
le collectif à l’extrémité droite pour la pochette de Nameless
Belligerent de FEMTOGO, ou au contraire dans la partie gauche avec La
solution, l’EP commun de Mairo et H Jeunecrack, et le clip Deux ailes
de cire de Asinine Asinine, Deux ailes de cire, 2024. Clip réalisé par Jules Harbulot, réalisé en partie en stop-motion et inspiré
de l’univers de Tim Burton.
Asinine, Deux ailes de cire, 2024. Clip réalisé par Jules Harbulot, réalisé en partie en stop-motion et inspiré
de l’univers de Tim Burton.
Tous ces artistes sont lié·es par un réseau
intangible, qui prend sa source dans la volonté de créer un univers
propre à chaque nouveau projet, pour mieux immerger le public dedans.
Ces associations font le propre de cette culture souterraine, et seront
particulièrement prises en exemple dans la partie suivante. Le rôle de
ces beatmaker·euses, graphistes, typographes, réalisateur·ices est
décisif dans la création musicale, mais leur participation reste bien
souvent sous estimée par la majorité du public. Les rappeur·euses
occupent presque toujours la tête d’affiche lors de la promotion d’un
projet, en tant que tête pensante à l’origine de celui-ci. La part
d’implication d’autres personnes lors de la conception musicale et
visuelle reste souvent peu définie, et est laissée à explorer aux
quelques passionné·es voulant réellement comprendre comment leurs
morceaux préférés voient le jour. Ces acteur·ices du rap souterrain sont
heureusement très souvent crédité·es et remercié·es par les artistes, bien plus ouvertement que dans le milieu de la scène mainstream par
exemple. Il est ainsi plus simple de comprendre comment ces projets sont
le résultat de travaux d’équipe, de croisement d’esthétiques et de
réseaux de créateur·ices. Pour en revenir aux projets présents dans
cette branche du rhizome, on constate tout de même un attachement bien
présent à la partie gauche de la carte, précédemment analysée : Lala&ce
fait appel pour la pochette de Solstice à l’illustrateur Dexter
Maurer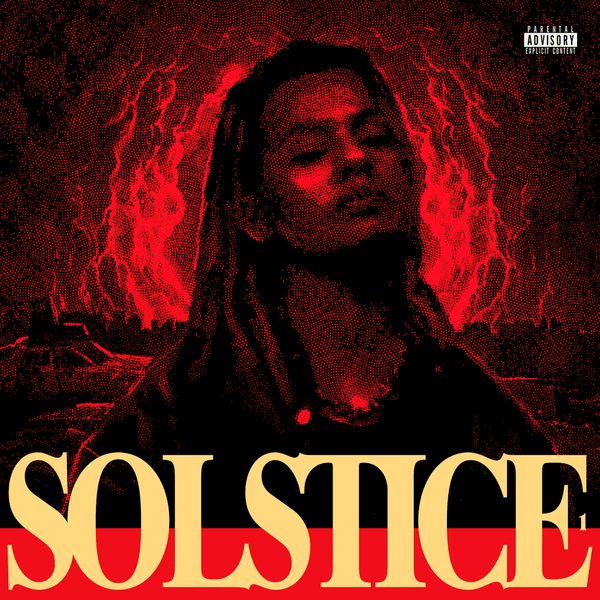 Lala&ce, SOLSTICE, 2024, qui travaille également régulièrement avec Mairo comme sur les
projets omar chappier et Déjeuner en paix, que l’on citait déjà
précédemment. La pochette de l’album Le Grand Mystico[fig
Lala&ce, SOLSTICE, 2024, qui travaille également régulièrement avec Mairo comme sur les
projets omar chappier et Déjeuner en paix, que l’on citait déjà
précédemment. La pochette de l’album Le Grand Mystico[fig
Les frontières entre les sous-genres sont ainsi poreuses, et la notion de rhizome prend tout son sens : chaque nouvel album apporte son lot de références, de rappels à des œuvres existantes, mais tente aussi de se démarquer et de créer un nouvel univers. Les possibilités sont ainsi démultipliées, et il devient difficile de catégoriser les projets et les artistes selon des genres ou des sous-genres. Malgré cela, les tendances qui se dégagent, à la fois musicalement et graphiquement, aident à percevoir l’ensemble du paysage du rap underground. Si ces affirmations se vérifient en grande majorité, il existe un point de rupture dans cette cartographie. À partir d’un certain degré d’innovation musicale et graphique, des artistes ont une fois de plus réussi à se détacher de courants existants. Ceux-ci se saisissent pleinement de ces nouvelles technologies numériques propres à la nouvelle génération, et en font leur direction artistique, quitte à laisser de côté certains fondamentaux du rap.
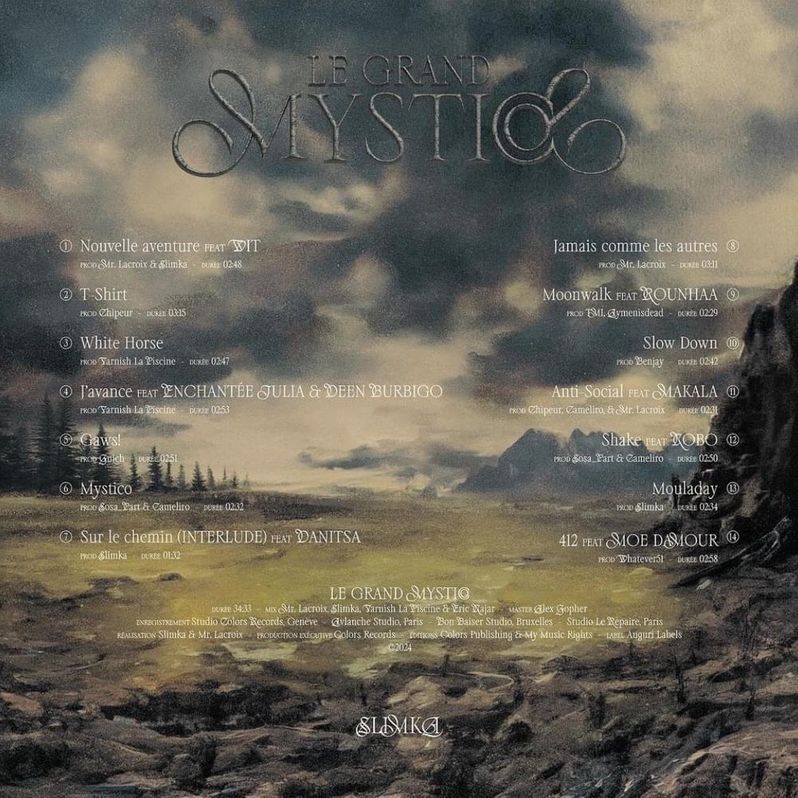

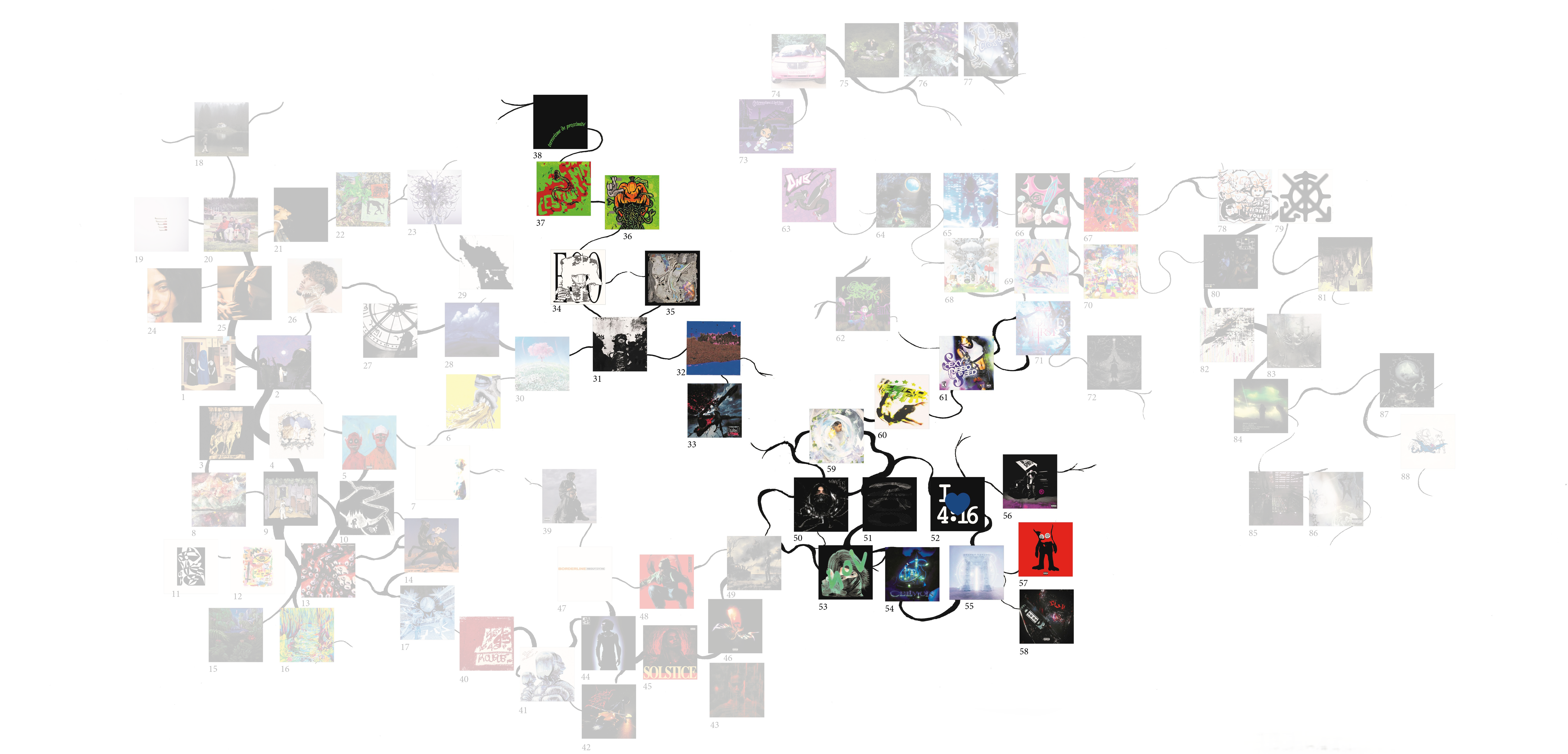
Aux alentours de l’année 2020, un renversement semble s’effectuer dans
la scène rap underground française. Comme frappé·es par la conscience
que le rap ne pouvait échapper à la numérisation des moyens de
créations, les nouveaux·elles artistes se lancèrent à corps perdu dans
une esthétique dite « digitale ». La naissance de cette esthétique
pourrait être fixée en février 2020, date de sortie de l’album TRINITY
de Laylow. Cet album propulsera l’artiste sur le devant de la scène rap, dans laquelle il est aujourd’hui un des acteurs les plus importants.
L’esthétique digitale se retrouve dès le nom, emprunté à la célèbre
agente du film Matrix. La direction artistique de l’album s’inspirera
d’ailleurs plus en profondeur de ce film, avec la dominance de la
couleur verte, s’imposant comme symbole du virtuel depuis les sœurs
Wachowski. De la pochette avec sa photo retouchée, lisse comme si
modélisée en 3D, jusqu’aux morceaux, tout semble robotique, numérique :
Laylow couvre sa voix d’effets, d’AutoTune*, et les instrumentales
sombres utilisent toujours plus de sonorités métalliques, numériques et
agressives Laylow, TRINITY, 2020. On retrouve dans TRINITY ce qui constituera une base, voire même une inspiration pour la nouvelle vague d’artistes qui
émergeront dans les années suivantes. L’album se place comme une pierre
angulaire, une porte ouverte sur toutes les nouvelles déclinaisons qui
vont naître par la suite de cette numérisation du rap.
Laylow, TRINITY, 2020. On retrouve dans TRINITY ce qui constituera une base, voire même une inspiration pour la nouvelle vague d’artistes qui
émergeront dans les années suivantes. L’album se place comme une pierre
angulaire, une porte ouverte sur toutes les nouvelles déclinaisons qui
vont naître par la suite de cette numérisation du rap.
Cette partie de la carte regroupe ainsi des artistes ayant fait des
choix drastiques dans leur musique pour créer de nouvelles sonorités.
Bien que toujours attaché·es aux bases du rap par leur façon de
structurer les morceaux, d’écrire, de déclamer, ces artistes remettent
en question certains fondamentaux. Dans la continuité de la partie
précédente où l’écriture était placée au même plan que la musicalité
pour obtenir une fusion des deux, ici, les paroles passent le plus
souvent après les instrumentales, et les mélodies. Il devient plus
important pour les artistes d’avoir de bonnes toplines* (mélodies
chantées) que porter des paroles lourdes de sens. Bien évidemment, il
s’agit d’un spectre, où les différent·es artistes prennent place à une
extrémité, à l’autre, ou quelque part au milieu. Le rappeur Winnterzuko
souhaitera ainsi garder au milieu des sonorités électroniques des textes
forts dans lesquels il parle de son vécu difficile : enfant immigré d’un
pays en guerre ayant vécu dans la précarité à son arrivée en France, et
ce jusqu’à son début de succès dans le rap. De l’autre côté, cette
entrée dans la numérisation du rap est caractérisée par des effets de
voix toujours plus présents, et des instrumentales toujours plus
complexes et complètes. Celles-ci utilisent de moins en moins
d’instruments réels, au profits de synthétiseurs et de leurs sons et
textures travaillées. L’instrumentale prend parfois le pas sur la voix, qui devient alors un instrument à part entière, comme chez Realo où les
paroles sont la plupart du temps indéchiffrables Realo, Island dans l’album EMOTION, 2020, et justes
vectrices d’une énergie et de mélodies fortes. Du côté graphique, cette
digitalisation est d’abord traduite par une utilisation omniprésente
d’imageries 3D. On constate rapidement cette tendance dans la partie
centrale de la carte, particulièrement en bas. Toutes les pochettes de
cette partie, à l’exception d’une, sont réalisées en 3D, ou en intègrent
des éléments. S’ajoute à cela une présence accentuée du design
graphique, dans la continuité de la partie précédente. Les artistes
cité·es s’associent en effet plus souvent qu’ailleurs avec des
graphistes en particulier, formant des paires créatives de la même
manière que pourraient le faire un rappeur et un beatmaker. Ainsi, des
créateurs comme Kerning Castle, typographe, ou Yev, artiste 3D, se
retrouvent impliqués dans presque tous les projets de Realo, Zoomy, abel31 et Winnterzuko, quatre artistes très proches musicalement et
amicalement (beaucoup de morceaux communs, voire des projets comme SEXY
TURBO SPEED existent d’ailleurs entre ces artistes).
Les imageries 3D et les typographies déformées, extravagantes viennent
encore une fois soutenir le propos de la musique, en appuyant
l’abondance d’effets et de percussions explosives. Les univers
représentés sont irréels, oniriques, comme sur les pochettes de Zoomy
avec OBLIV!ON
Realo, Island dans l’album EMOTION, 2020, et justes
vectrices d’une énergie et de mélodies fortes. Du côté graphique, cette
digitalisation est d’abord traduite par une utilisation omniprésente
d’imageries 3D. On constate rapidement cette tendance dans la partie
centrale de la carte, particulièrement en bas. Toutes les pochettes de
cette partie, à l’exception d’une, sont réalisées en 3D, ou en intègrent
des éléments. S’ajoute à cela une présence accentuée du design
graphique, dans la continuité de la partie précédente. Les artistes
cité·es s’associent en effet plus souvent qu’ailleurs avec des
graphistes en particulier, formant des paires créatives de la même
manière que pourraient le faire un rappeur et un beatmaker. Ainsi, des
créateurs comme Kerning Castle, typographe, ou Yev, artiste 3D, se
retrouvent impliqués dans presque tous les projets de Realo, Zoomy, abel31 et Winnterzuko, quatre artistes très proches musicalement et
amicalement (beaucoup de morceaux communs, voire des projets comme SEXY
TURBO SPEED existent d’ailleurs entre ces artistes).
Les imageries 3D et les typographies déformées, extravagantes viennent
encore une fois soutenir le propos de la musique, en appuyant
l’abondance d’effets et de percussions explosives. Les univers
représentés sont irréels, oniriques, comme sur les pochettes de Zoomy
avec OBLIV!ON Zoomy, OBLIV!ON, 2022 et GATE, ou plongent directement dans le numérique
comme Winnterzuko sur WINNTERMANIA
Zoomy, OBLIV!ON, 2022 et GATE, ou plongent directement dans le numérique
comme Winnterzuko sur WINNTERMANIA Winnterzuko, WINNTERMANIA, 2022. Cette proximité entre graphistes
et rappeur·euses finit par créer une esthétique commune, comme un
écosystème tournant autour de quelques créateur·ices. C’est d’ailleurs
autour de ce milieu que l’on retrouve des affiches de soirées ou DJ sets
très poussées graphiquement : les Rêves Party[fig
Winnterzuko, WINNTERMANIA, 2022. Cette proximité entre graphistes
et rappeur·euses finit par créer une esthétique commune, comme un
écosystème tournant autour de quelques créateur·ices. C’est d’ailleurs
autour de ce milieu que l’on retrouve des affiches de soirées ou DJ sets
très poussées graphiquement : les Rêves Party[fig
Dans toutes ces directions graphiques comme musicales, un trait commun
semble lier les projets de cette partie de la carte : rester à la pointe
de l’innovation artistique. En allant chercher plus loin, on observe sur
les tracklists* des albums des compositions très actuelles dans le monde
du design, cette fois-ci plus sobres que sur les pochettes. Ce contraste
est surtout marqué par l’utilisation de polices linéales couplées à une
mise en page sobre, avec quelques couleurs distinctives, comme sur les
tracklists de OBLIV!ON et DIRTYSPRITE19R[fig
En effet, Pascal Plantard cite dans son texte à propos des notions de
braconnage, bricolage et butinage, un autre anthropologue ayant théorisé
l’insertion sociale de technologies. Victor Scardigli décrit alors en
1992 trois temps à cette démocratisation, qui peuvent être appliqués, en
reformant un peu ces notions, à l’utilisation des outils numériques dans
le rap underground. D’abord, le temps de l’innovation constitue le point
de départ : on y découvre comment utiliser les technologies numériques, et dans le cas du rap, toutes les déclinaisons créatives qu’elles
impliquent. Cette partie centrale de la carte représente assez bien la
période d’innovation, où des artistes comme Winnterzuko ouvrent une
porte en rappant sur des instrumentales se rapprochant de la techno ou
l’électro. Ensuite vient le temps de la massification, où les
technologies numériques se démocratisent à grande échelle. Dans le rap
underground, cette évolution s’apparenterait à l’arrivée de nouvelles et
nouveaux artistes cherchant à s’inspirer de ces pionnier·es, formant une
nouvelle branche du rhizome se développant vers le haut et à droite, encore une nouvelle évolution musicale que nous évoquerons par la suite.
Cette massification cède enfin la place à un temps de banalisation, où
le phénomène de nouveauté s’estompe, et l’utilisation de ces
technologies rentre dans le quotidien. Chez les artistes placés au
centre de la carte, on observe le début de cette tendance, à un moment
où le public et les artistes s’habituent à la présence de ces
instrumentales et effets numériques très chargés. Dans la relation entre
musique et image, cela implique une recherche de renouveau de la part
des rappeur·euses. Tant graphiquement que musicalement, certain·es
artistes tentent de se détacher de cette esthétique numérique qui
pourrait, avec quelques années de recul, devenir clichée. C’est le cas
par exemple d’abel31, qui abandonne peu à peu la 3D pour des
propositions plus proches du design graphique au sens propre. Kerning
Castle transforme ainsi le très célèbre logo I love New-York de Milton
Glaser pour 4h16 abel31, 4h16, 2023, et abel31 utilise simplement des photographies peu
retouchées pour 0010 et mercuriales_. Ces choix de représentations
graphiques témoignent d’une certaine prise de maturité sur sa musique, osant désormais associer des sonorités numériques et artificielles à
d’autres imageries que simplement des modèles 3D. De la même manière, on
constate une évolution progressive du graphisme de ce sous-genre en même
temps que la musique des artistes. Alors que Zoomy se rapproche de la
rage* américaine dans sa mixtape DIRTYSPRITE19R, il choisit encore
une fois de délaisser la 3D au profit d’une photographie, certes encore
très retouchée et stylisée pour conserver une touche personnelle.
abel31, 4h16, 2023, et abel31 utilise simplement des photographies peu
retouchées pour 0010 et mercuriales_. Ces choix de représentations
graphiques témoignent d’une certaine prise de maturité sur sa musique, osant désormais associer des sonorités numériques et artificielles à
d’autres imageries que simplement des modèles 3D. De la même manière, on
constate une évolution progressive du graphisme de ce sous-genre en même
temps que la musique des artistes. Alors que Zoomy se rapproche de la
rage* américaine dans sa mixtape DIRTYSPRITE19R, il choisit encore
une fois de délaisser la 3D au profit d’une photographie, certes encore
très retouchée et stylisée pour conserver une touche personnelle.
Les artistes de cette partie de la carte semblent vite avoir réalisé qu’associer musique et design graphique pouvait autant être efficace que nuisible à l’évolution d’une esthétique. Il s’agissait après quelques années d’exploitation d’imageries 3D, de machinerie et de robotique, d’évoluer vers une nouvelle forme de représentation de leur musique, plus personnelle. La numérisation de la pratique de ces artistes pourrait trouver ici ses limites, en même temps que cette course à l’innovation. Afin d’éviter que leurs morceaux ne vieillissent dans quelques années lorsque les standards technologiques et musicaux auront évolué, les rappeur·euses font le choix de diversifier leur musique et la représentation qu’ils en font. H Jeunecrack constatait d’un œil extérieur ce changement de mouvance en 2023 dans le morceau La preuve : « C’est pas parce que c’est électronique que c’est le turfu : la preuve ». Les artistes cité·es ci-dessus évoluent, mais inlassablement, le rhizome se développe et crée des sous-genres se déplaçant vers la droite sur la carte. Inspiré·es de cette esthétique numérique, certain·es artistes décident volontairement de pousser à outrance les curseurs. Il s’agit pour eux d’intégrer des marqueurs temporels dans leur musique, en utilisant massivement et de nouvellement des outils numériques et leurs caractéristiques, en invoquant des références culturelles présentes ou passées, comme pour témoigner de l’époque dans laquelle ils et elles évoluent.
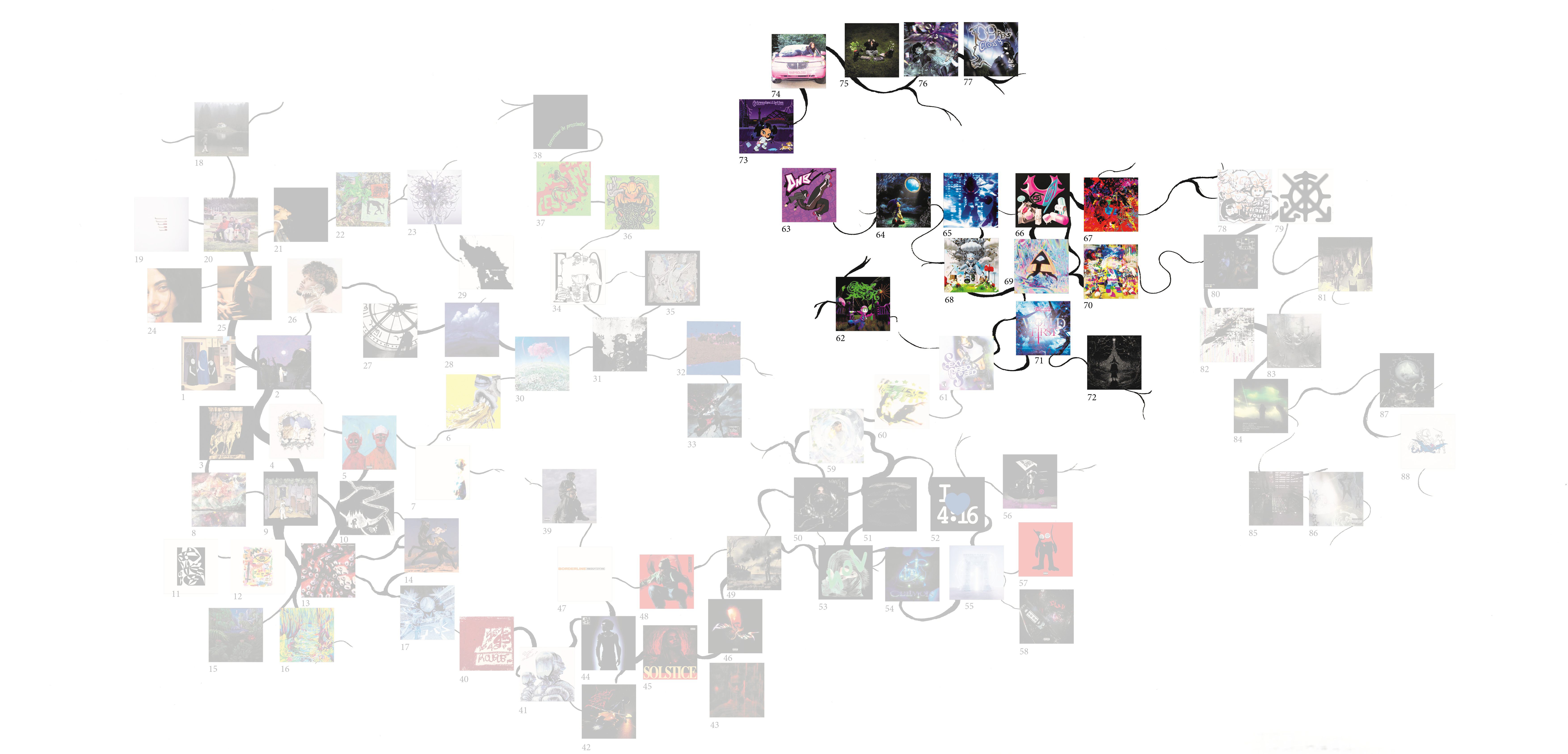
Suite au bouleversement culturel amené par le rap aux sonorités
numériques que nous venons d’évoquer, on observe une diversification
exponentielle d’esthétiques dérivées. L’exploitation de ces sonorités va
encore plus loin, menée par une nouvelle génération d’artistes venu·es y
mélanger leurs nouvelles inspirations culturelles, graphiquement comme
musicalement. Difficile de parler encore de rap ici, tant les mélodies
prennent le pas sur les paroles, devenues inintelligibles. Aux
instrumentales déjà surchargées, héritage de la partie précédente, s’ajoutent maintenant des bugs et glitchs audios, symptomatiques de ces
nouvelles esthétiques développées snorunt & shaadi, vivienne westwood, 2021. Si les termes pour définir
toutes ces évolutions manquent ces dernières années, le grand public
généralisera souvent pour les regrouper sous les dénominations
d’hyperpop*, ou de glitchcore*. Ces termes, en réalité peu appropriés, font surtout référence à d’anciens mouvements des années 2010 auxquels
ces artistes font aujourd’hui appel dans leur façon de rapper et de
composer les instrumentales. À partir des années 2020, le terme hyperpop
va être utilisé par les auditeur·ices de rap pour englober tous ces
germes de nouvelles sonorités. Représentatives d’une génération nourrie
aux stimulations visuelles et sonores extrêmes via les technologies
numériques et les réseaux sociaux, il est tout à fait normal que ces
styles fassent monter les BPM des morceaux à des hauteurs jamais
atteintes dans le rap. En moyenne, un morceau de boom-bap* qui tourne
autour des 90 BPM fait pâle figure face aux 160 BPM voire plus des
morceaux hyperpop. Un article de Cristina Luis, publié dans le journal
El Mundo de Madrid et traduit par Courrier International, résume bien
la genèse de ce style hybride en osmose avec son époque. Nina Emocional, une artiste hyperpop espagnole définit le genre ainsi : « Il y a dans
les morceaux d’hyperpop une sorte d’horror vacui (…) Ils contiennent
beaucoup d’informations. Nous vivons à une époque où le flot d’inputs
est incessant, captant notre attention en permanence. Pour moi, c’est la
musique d’une génération »12. L’artiste conclura même sa définition en
confirmant que l’utilisation du numérique est une composante à part
entière de cette musique, qui est « une recherche constante d’un moyen
d’exprimer [ses] émotions et [son] identité en utilisant les
nouvelles technologies ». Il est vrai qu’à mieux écouter les textes des
artistes de cette catégorie, certain·es utilisent les nombreux effets
sur leurs voix pour cacher un mal-être, une tristesse généralisée.
snorunt dévoile ses complications amoureuses
snorunt & shaadi, vivienne westwood, 2021. Si les termes pour définir
toutes ces évolutions manquent ces dernières années, le grand public
généralisera souvent pour les regrouper sous les dénominations
d’hyperpop*, ou de glitchcore*. Ces termes, en réalité peu appropriés, font surtout référence à d’anciens mouvements des années 2010 auxquels
ces artistes font aujourd’hui appel dans leur façon de rapper et de
composer les instrumentales. À partir des années 2020, le terme hyperpop
va être utilisé par les auditeur·ices de rap pour englober tous ces
germes de nouvelles sonorités. Représentatives d’une génération nourrie
aux stimulations visuelles et sonores extrêmes via les technologies
numériques et les réseaux sociaux, il est tout à fait normal que ces
styles fassent monter les BPM des morceaux à des hauteurs jamais
atteintes dans le rap. En moyenne, un morceau de boom-bap* qui tourne
autour des 90 BPM fait pâle figure face aux 160 BPM voire plus des
morceaux hyperpop. Un article de Cristina Luis, publié dans le journal
El Mundo de Madrid et traduit par Courrier International, résume bien
la genèse de ce style hybride en osmose avec son époque. Nina Emocional, une artiste hyperpop espagnole définit le genre ainsi : « Il y a dans
les morceaux d’hyperpop une sorte d’horror vacui (…) Ils contiennent
beaucoup d’informations. Nous vivons à une époque où le flot d’inputs
est incessant, captant notre attention en permanence. Pour moi, c’est la
musique d’une génération »12. L’artiste conclura même sa définition en
confirmant que l’utilisation du numérique est une composante à part
entière de cette musique, qui est « une recherche constante d’un moyen
d’exprimer [ses] émotions et [son] identité en utilisant les
nouvelles technologies ». Il est vrai qu’à mieux écouter les textes des
artistes de cette catégorie, certain·es utilisent les nombreux effets
sur leurs voix pour cacher un mal-être, une tristesse généralisée.
snorunt dévoile ses complications amoureuses snorunt, 0bpm dans l’album glalie, 2021, et 55ASKY évoque son
enfermement et son addiction aux sucreries et antidépresseurs dans l’album PILLZ & KANDY KRUSH
snorunt, 0bpm dans l’album glalie, 2021, et 55ASKY évoque son
enfermement et son addiction aux sucreries et antidépresseurs dans l’album PILLZ & KANDY KRUSH 55ASKY, PILLZ & KANDY KRUSH, 2024. Tous ces
questionnements d’une jeune génération sont dissimulés sous des couches
d’Autotune, mais aussi par des imageries colorées, et encore une fois
très stimulantes visuellement.
55ASKY, PILLZ & KANDY KRUSH, 2024. Tous ces
questionnements d’une jeune génération sont dissimulés sous des couches
d’Autotune, mais aussi par des imageries colorées, et encore une fois
très stimulantes visuellement.
Toute la partie centrale supérieure jusqu’à la droite de la carte
poursuit donc l’exploration numérique lancée par les artistes de la
partie précédente, en utilisant majoritairement des images 3D pour
illustrer leurs albums. La plupart des artistes conçoivent également un
personnage pour les représenter en ligne, comme Dyspeed, snorunt ou 55ASKY, qui
apparaissent dans leur communication au travers de ces alter-egos. Rien
de plus logique que toutes ces composantes, esthétiques musicales, images 3D, utilisation d’alter-egos, finissent par se mêler au monde des
jeux vidéos. En tant que marqueurs culturels énormes sur ces nouvelles
générations, il est normal que ces artistes choisissent d’associer leur
musique à des univers graphiques dans lesquels ils et elles ont baigné
en grandissant. Intervient alors la troisième notion définie par Pascal
Plantard : le butinage. Les artistes piochent dans leur entourage et
dans les œuvres culturelles qu’ils et elles connaissent pour créer un
amalgame de références personnelles. Ce butinage n’est évidemment pas
spécifique à cette partie de la carte, ni au rap, ni même à la musique
elle-même, tant chaque artiste prend inspiration dans ce qui l’entoure
pour créer. Malgré tout, cette notion reste intéressante à analyser dans
le contexte de l’hyperpop, puisqu’elle ancre ce sous-genre dans une
génération particulière, ayant grandi avec des bases culturelles en
commun. Les références aux jeux-vidéos étaient en vérité déjà présentes
un peu partout dans les parties précédentes : Jolagreen23 nomme son
projet +99XP (points d’expérience dans les jeux) et fait référence au
logo PEGI sur la pochette, et Luther nomme plusieurs morceaux en
référence aux jeux cultes Pokémon et Minecraft : Alakazam et MOSSY
COBBLESTONE. De manière générale, ces appels aux jeux sont disséminés
partout dans la culture rap underground, même lorsque les rappeur·euses
sont hors de l’équation : les graphistes de cette nouvelle génération
aussi ont été nourri·es à ces références. Les mettre de côté en parlant
de la naissance de ces esthétiques serait minimiser leur impact et leur
influence. On retrouvera par exemple une proposition d’affiche pour la
Rêves Party numéro 10 faisant référence à l’univers des JRPG (Japanese
Role Playing Game)[fig
Le butinage de ces artistes, musical comme graphique, est une nouvelle manière de s’adresser au public. Les artistes de la première partie préféraient prendre inspiration dans leur vécu et style de vie, pour aller chercher une résonance dans les auditeur·ices connaissant la même situation qu’eux. Les rappeur·euses hyperpop se servent plutôt d’esthétiques déjà existantes pour susciter les centres d’intérêt communs des auditeur·ices. L’utilisation de ces références sonne comme un nouveau moyen d’expression au sein de cette génération, qui cherche à partager ses propres références avec d’autres personnes. La communication et le partage de morceaux sur Internet permet ce type de rencontre, et contribue à faire de l’hyperpop un style s’étant développé très rapidement ces dernières années. L’artiste Rosa Fernandez confirmera cette relation dans l’article de El Mundo : « c’est un style très associé aux jeux vidéos, au fait de rester dans sa chambre et de créer une communauté sur Internet »13. Ces deux dernières caractéristiques rappellent le caractère underground de notre corpus, commençant tout juste à toucher un public plus large, mais jusqu’ici regroupant essentiellement des communautés en ligne.
Cette manière de partager ses références, d’en trouver des communes avec
d’autres personnes sur internet, touche d’autres esthétiques que
l’univers du jeu-vidéo. En accord avec la vague de nostalgie des années
2000–2010 actuelle, une sorte d’embranchement se crée sur la carte. Des
artistes se servent de ces emprunts à d’anciennes esthétiques, mais se
détachent de l’hyperpop pour faire revivre une esthétique qui leur
correspond plus. La rappeuse Babysolo33 clame ainsi son amour pour les
genres Y2K et Girlypop, ayant dominé les années 2000, pour créer une
sorte de temporalité parallèle. L’auditeu·rice se trouve transporté·e au
milieu des strass, des paillettes, où tout est rose et brillant, y
compris les téléphones à touches et les grosses voitures sous les
palmiers de Miami Tracklist de l’album de Babysolo : Radio $ummer Hits, 2023. Comme partout auparavant, cette identité graphique
particulière vient solidifier un style musical tout aussi girly, que
Babysolo33 développe en se comparant à une princesse, et grâce à sa voix
suave
Tracklist de l’album de Babysolo : Radio $ummer Hits, 2023. Comme partout auparavant, cette identité graphique
particulière vient solidifier un style musical tout aussi girly, que
Babysolo33 développe en se comparant à une princesse, et grâce à sa voix
suave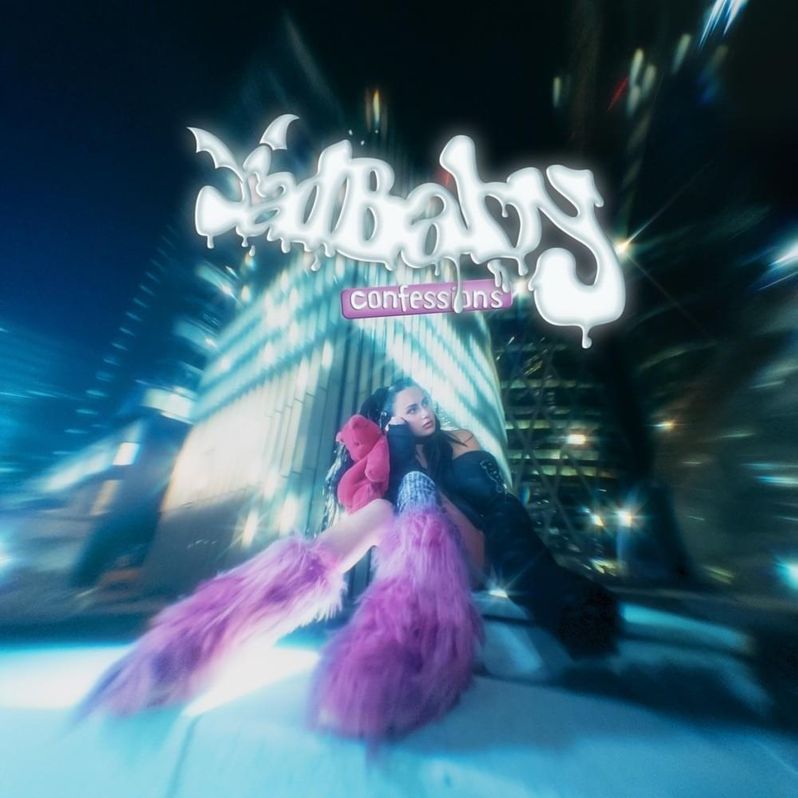 Babysolo33, Leçon2Princess dans l’album SadBaby Confessions, 2022. Si beaucoup de petites filles ont connu et vécu cet univers
musical et graphique à cet époque, l’impact culturel de ce dernier est
tel que même les garçons se retrouvent dans la musique de Babysolo33,
qui fait appel à un imaginaire commun. Résultat d’années d’exposition à
ces esthétiques, le caractère générationnel de ces artistes n’est ainsi
pas à négliger, expliquant leur succès rapide chez des auditeur·ices
relativement jeunes.
Babysolo33, Leçon2Princess dans l’album SadBaby Confessions, 2022. Si beaucoup de petites filles ont connu et vécu cet univers
musical et graphique à cet époque, l’impact culturel de ce dernier est
tel que même les garçons se retrouvent dans la musique de Babysolo33,
qui fait appel à un imaginaire commun. Résultat d’années d’exposition à
ces esthétiques, le caractère générationnel de ces artistes n’est ainsi
pas à négliger, expliquant leur succès rapide chez des auditeur·ices
relativement jeunes.
Pour ces artistes, généralement récemment lancé·es dans le milieu de la
musique, se créer une identité musicale et visuelle représente un défi
de taille. Si celles-ci arrivent généralement avec l’expérience et le
temps, le caractère de plus en plus impulsif de l’industrie musicale
coupe court à ces temps de recherches personnelles. Il s’agit alors pour
les rappeur·euses de construire leur début de carrière en s’appuyant sur
des univers déjà existants, et ensuite éventuellement s’en détacher
après avoir pris en maturité, et développé son propre imaginaire. Des
artistes comme snorunt, évoqué précédemment, ou TKKF se trouvent ainsi
au début de cette progression, et basent leur esthétique presque
uniquement sur les licences qui les ont fait (et qui les font sûrement
toujours) vibrer. TKKF est en effet une personnalité évoluant très
rapidement depuis ces derniers mois, et ce notamment grâce à sa
communication prolifique sur TikTok. Sur ce réseau, il construit un lien
entre sa musique et ce personnage en postant ses morceaux superposés à
des images tirées de jeux Sonic The Hedgehog, personnage culte de SEGA.
Toutes ses pochettes découleront ainsi logiquement de cet univers, faisant apparaître des personnages de Sonic dans différents
environnements. Si TKKF n’est pas le premier à faire cette association
logique entre la très grande vitesse du hérisson bleu et les rythmes
effrénés de l’hyperpop et de la glitchcore (ces deux esthétiques sont
souvent associées sur Internet depuis plusieurs années maintenant), il
est certainement en France celui qui exploite le plus cette relation. Ce
lien entre image et musique deviendra en réalité si proéminent dans sa
façon de se représenter, que Sonic deviendra comme une extension de
l’artiste lui-même, prenant sa place sur ses pochettes TKKF, SXMMER! l0ng, 2024. Sur sa
collaboration avec 55ASKY, TKKF est donc représenté par Sonic, alors que
son acolyte possède un personnage propre à son univers : Rosalith, un ami imaginaire rose très souvent cité dans ses morceaux.
TKKF, SXMMER! l0ng, 2024. Sur sa
collaboration avec 55ASKY, TKKF est donc représenté par Sonic, alors que
son acolyte possède un personnage propre à son univers : Rosalith, un ami imaginaire rose très souvent cité dans ses morceaux. TKKF & 55ASKY, T55F, 2024. Difficile de dire si ce choix
témoigne d’un manque de maturité musicale, l’artiste n’en étant à ce
stade qu’au début de ses expérimentations musicales et graphiques, ou
bien d’un choix réfléchi sur la durée, impliquant tout un univers
graphique à développer pour se différencier de la licence de SEGA.
TKKF & 55ASKY, T55F, 2024. Difficile de dire si ce choix
témoigne d’un manque de maturité musicale, l’artiste n’en étant à ce
stade qu’au début de ses expérimentations musicales et graphiques, ou
bien d’un choix réfléchi sur la durée, impliquant tout un univers
graphique à développer pour se différencier de la licence de SEGA.
Ce type de parcours se retrouve chez d’autres rappeur·euses, qui peinent
pourtant à tirer leur épingle de cet immense jeu, comme commence à le
faire TKKF. En effet, de nombreux et nombreuses artistes débutant·es, absent·es sur la carte, choisissent aujourd’hui l’hyperpop comme porte
d’entrée dans le monde du rap. Que ce soit par effet de mode, ou par
proximité avec les esthétiques mises en avant par ce sous-genre, il
apparaît de plus en plus que ce sous-genre se sature de petits artistes
répliquant sensiblement les mêmes sonorités. On retrouve alors les mêmes
voix saturées d’effets, les mêmes instrumentales rapides, et donc
immanquablement les mêmes idées graphiques s’appuyant parfois à outrance
sur les univers vidéoludiques ou numériques. Du fait de leur jeune âge, ou de leur arrivée récente dans le monde de la musique, ces artistes
peinent à éviter l’écueil décrit en troisième partie, celui de tomber
dans le cliché du sous-genre que l’on représente, tant musicalement que
graphiquement, sans arriver à se distinguer par une idée particulière.
On pourra par exemple évoquer l’artiste Celebii, s’étant fait remarquer
sur TikTok début 2024 par des sons très conformes à l’hyperpop et à la
glitchcore, et associant son image au Pokémon dont il tire son
pseudonyme. Si ces apparitions marquent un début de carrière très
similaire à TKKF, à qui il est très souvent comparé, Celebii annonce
pourtant fin 2024 arrêter de produire des morceaux hyperpop pour évoluer
vers d’autres styles de rap, plus proches de la trap. Deux chemins
distincts se tracent alors ici : celui de Celebii est de tracer une
coupure nette, et de bifurquer brutalement vers un rap plus
traditionnel. Celui-ci n’ayant cependant que peu d’expérience dans ce
domaine (voire aucune, ce dernier annonçant avoir commencé la musique en
2024), les morceaux en résultant peinent à se démarquer des autres
artistes performant déjà dans ces styles, et avec bien plus
d’expérience. Celebii se place alors dans une position déséquilibrée, induite par des fondations musicales un peu fragiles qui ont pu le
conduire à suivre un mouvement musical et graphique comme par réflexe.
TKKF au contraire, décide de faire évoluer progressivement sa musique, et délaisse peu à peu les voix aiguës et pleines d’effets pour rapper
plus agressivement et frontalement, tout en gardant des instrumentales
propres à son style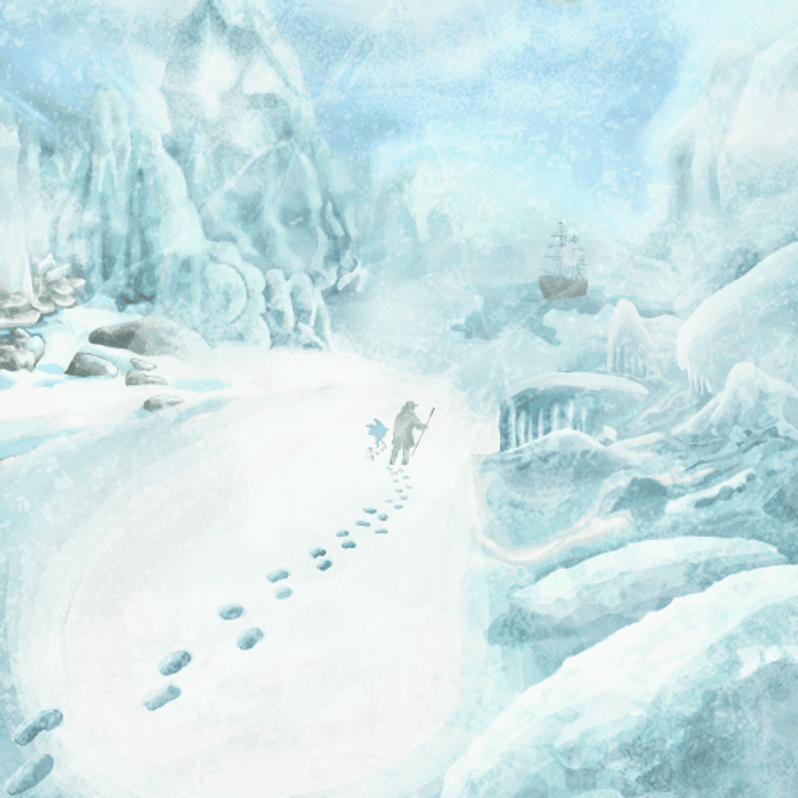 TKKF & Jima, SSX TRICKY dans l’album W1NT3R! l0ng, 2024. Ses pochettes elles aussi évoluent lentement, laissant place à des dessins digitaux plus proches des parties
précédentes de la carte (bien qu’on y retrouve toujours le personnage de
Sonic). On observe ainsi chez cet artiste une vision plus globale de son
début de carrière, qui semble témoigner d’une meilleure capacité à
survivre dans cet environnement musical saturé de propositions en tous
genres.
TKKF & Jima, SSX TRICKY dans l’album W1NT3R! l0ng, 2024. Ses pochettes elles aussi évoluent lentement, laissant place à des dessins digitaux plus proches des parties
précédentes de la carte (bien qu’on y retrouve toujours le personnage de
Sonic). On observe ainsi chez cet artiste une vision plus globale de son
début de carrière, qui semble témoigner d’une meilleure capacité à
survivre dans cet environnement musical saturé de propositions en tous
genres.
D’autres artistes parviennent heureusement à éviter de tomber dans les
clichés qu’amène l’hyperpop, afin de créer leur propre univers musical
et graphique. web7, plus ancien dans le milieu musical, est un bon
exemple de rappeur arrivant à la fin de cette réflexion sur sa propre
musique. Dans ses projets world first et wizard child, celui-ci
s’appuie sur des sonorités 8bit plus anciennes web7, cry online dans l’album world first, 2023, comme sur les
morceaux cry online ou tout bas, et intègre des glitchs, conformément au genre dans lequel il se positionne, mais sans se reposer
sur des licences particulières. On retrouve ainsi simplement une attache
au monde virtuel, à Internet, et à l’amour que l’artiste porte à la vie
en ligne, aux jeux-vidéos (déjà tout indiqué dans de nombreux titres de
morceaux, référençant cet univers : cry online, afk, wifi, no ui
no bullshit, pire 2 pire). En gardant un peu plus ses distances vis à
vis d’une licence en particulier, web7 s’assure ainsi de pouvoir faire
évoluer sa musique et les représentations graphiques qui l’accompagnent
sans se soucier d’une cohérence handicapante. Les pochettes de world
first et wizard child sont ainsi complètement différentes, l’une très
colorée, tout en 3D et l’autre très sombre, pointilliste, les deux
projets étant pourtant sortis à seulement 6 mois d’écart.
Ainsi, les artistes de la partie droite de la carte se réapproprient ces
courants musicaux et graphiques des années 2010 pour les faire évoluer
et emmener le rap dans une toute nouvelle dimension. À ce stade, beaucoup d’auditeur·ices et de journalistes peinent à trouver une
définition et un nom à ces sous-genres, expliquant l’emploi généralisant
du terme « hyperpop ». Mais la question ne se pose pas pour les
créateur·ices musicaux et graphiques, qui se contentent simplement de
mêler les esthétiques et influences qui leur sont chères pour se
construire leur identité propre.
web7, cry online dans l’album world first, 2023, comme sur les
morceaux cry online ou tout bas, et intègre des glitchs, conformément au genre dans lequel il se positionne, mais sans se reposer
sur des licences particulières. On retrouve ainsi simplement une attache
au monde virtuel, à Internet, et à l’amour que l’artiste porte à la vie
en ligne, aux jeux-vidéos (déjà tout indiqué dans de nombreux titres de
morceaux, référençant cet univers : cry online, afk, wifi, no ui
no bullshit, pire 2 pire). En gardant un peu plus ses distances vis à
vis d’une licence en particulier, web7 s’assure ainsi de pouvoir faire
évoluer sa musique et les représentations graphiques qui l’accompagnent
sans se soucier d’une cohérence handicapante. Les pochettes de world
first et wizard child sont ainsi complètement différentes, l’une très
colorée, tout en 3D et l’autre très sombre, pointilliste, les deux
projets étant pourtant sortis à seulement 6 mois d’écart.
Ainsi, les artistes de la partie droite de la carte se réapproprient ces
courants musicaux et graphiques des années 2010 pour les faire évoluer
et emmener le rap dans une toute nouvelle dimension. À ce stade, beaucoup d’auditeur·ices et de journalistes peinent à trouver une
définition et un nom à ces sous-genres, expliquant l’emploi généralisant
du terme « hyperpop ». Mais la question ne se pose pas pour les
créateur·ices musicaux et graphiques, qui se contentent simplement de
mêler les esthétiques et influences qui leur sont chères pour se
construire leur identité propre.
Grâce au regroupement de ces projets par proximité musicale, les différents mouvements au sein de cette relation entre design graphique et rap apparaissent plus clairement. On retrouve, à tous les niveaux de la scène underground, cette volonté de faire appel à des graphistes, des photographes, des peintres, pour traduire au mieux une expression musicale de niche. Chaque sous-genre forme comme un écosystème ayant un fonctionnement autonome et rendant lisible leur processus de création. Lorsque certain·es artistes choisissent d’utiliser l’image pour faire appel à des esthétiques qui les ont inspirées, qu’il s’agisse de tableaux de grands peintres dans la partie gauche, de films, ou de licences de jeux-vidéo vers le centre de la carte, certain·es autres préfèrent placer au centre de leur univers graphique un personnage créé de toutes pièces, comme dans la partie droite. Des rappeur·euses montent une équipe de professionnel·les qualifié·es, tandis que d’autres se reposent sur un réseau et des collaborateur·ices régulier·es partageant leurs références et leur vision artistique. Certain·es poussent leur univers plus loin que de simples pochettes à l’aide de clips, visualisers, posts sur les réseaux, affiches, et d’autres enchaînent les projets sans véritable communication.
Le réseau, en somme, croise des professionnel·les et des amateur·ices éclairé·es. Ces rencontres, ces
partages libres de références et d’esthétiques entre créateur·ices
musicaux et créateur·ices graphiques, pourraient être les déclencheurs
de nouveaux sous-genres. Dans la logique du rhizome, il serait attendu
qu’ils aboutissent eux-mêmes à la création de nouveaux dérivés. On
observe en réalité déjà ce phénomène, que ce soit de la part d’artistes
déjà bien implanté·es comme Realo qui rebat constamment les cartes et
refuse de se cantonner à un genre Realo & Deelee S, BORDERLINE, 2024, ou d’artistes plus jeunes et
nouveaux comme TKKF, qui s’éloignent tous les deux peu à peu des codes
de l’hyperpop qui les ont vu naître. Ce processus répété à l’infini rend
complexe l’étude de cet écosystème underground, et oblige à prendre
certains raccourcis lors des analyses musicales et graphiques afin de
rester concis. Beaucoup de sujets restent ainsi à aborder plus
précisément concernant cette scène underground, notamment les
conséquences de l’explosion du nombre d’artistes grâce aux moyens de
création et de publication de musique favorisés. Cette course à
l’innovation musicale qui en résulte plus ou moins directement, a un
impact sur les artistes ayant peu de visibilité. Ils et elles peuvent
peiner à façonner une identité, noyé·es dans la masse, à concevoir une
esthétique propre dans la diversité déjà là. Cette soif de nouveauté
musicale, tant du côté des artistes que du public, se traduit alors par
une ruée vers les nouvelles technologies, comme un far-west où tout
est à découvrir et où tout le monde s’arrache son lopin de terre. Le
développement des imageries 3D associées à l’Autotune et aux sonorités
glitchées cédera inévitablement sa place au profit de la prochaine
nouvelle découverte (cf. annexe : Artistes et émergence de
l’intelligence artificielle dans le rap). D’un autre côté, cette
constante évolution rhizomatique de la scène rap pousse des artistes à
recroiser leurs influences, à réutiliser des codes existants en les
transformant. Ainsi, un artiste comme Irko, situé à l’extrémité droite
de la carte, récupère les sonorités glitchées de l’hyperpop pour les
transposer dans son univers froid et métallique, associé à l’imagerie de
la guerre et des armes
Realo & Deelee S, BORDERLINE, 2024, ou d’artistes plus jeunes et
nouveaux comme TKKF, qui s’éloignent tous les deux peu à peu des codes
de l’hyperpop qui les ont vu naître. Ce processus répété à l’infini rend
complexe l’étude de cet écosystème underground, et oblige à prendre
certains raccourcis lors des analyses musicales et graphiques afin de
rester concis. Beaucoup de sujets restent ainsi à aborder plus
précisément concernant cette scène underground, notamment les
conséquences de l’explosion du nombre d’artistes grâce aux moyens de
création et de publication de musique favorisés. Cette course à
l’innovation musicale qui en résulte plus ou moins directement, a un
impact sur les artistes ayant peu de visibilité. Ils et elles peuvent
peiner à façonner une identité, noyé·es dans la masse, à concevoir une
esthétique propre dans la diversité déjà là. Cette soif de nouveauté
musicale, tant du côté des artistes que du public, se traduit alors par
une ruée vers les nouvelles technologies, comme un far-west où tout
est à découvrir et où tout le monde s’arrache son lopin de terre. Le
développement des imageries 3D associées à l’Autotune et aux sonorités
glitchées cédera inévitablement sa place au profit de la prochaine
nouvelle découverte (cf. annexe : Artistes et émergence de
l’intelligence artificielle dans le rap). D’un autre côté, cette
constante évolution rhizomatique de la scène rap pousse des artistes à
recroiser leurs influences, à réutiliser des codes existants en les
transformant. Ainsi, un artiste comme Irko, situé à l’extrémité droite
de la carte, récupère les sonorités glitchées de l’hyperpop pour les
transposer dans son univers froid et métallique, associé à l’imagerie de
la guerre et des armes Irko & amne, DANGER RAPPROCHÉ, 2023. Mais un rappeur comme FEMTOGO, d’abord associé à
Irko dans ce sous-genre officieusement surnommé « warmusic », s’en
démarque récemment. Ses derniers projets évoluent vers un style de rap
moins glitché, au sens et au message personnel et profond, que l’on
pourrait placer dans la partie gauche de la carte (cf. l’EP
Francs-Tireurs Partisans, absent de la carte car sorti après
l’écriture de ce mémoire).
Irko & amne, DANGER RAPPROCHÉ, 2023. Mais un rappeur comme FEMTOGO, d’abord associé à
Irko dans ce sous-genre officieusement surnommé « warmusic », s’en
démarque récemment. Ses derniers projets évoluent vers un style de rap
moins glitché, au sens et au message personnel et profond, que l’on
pourrait placer dans la partie gauche de la carte (cf. l’EP
Francs-Tireurs Partisans, absent de la carte car sorti après
l’écriture de ce mémoire).
La lecture de cette cartographie a fait apparaître aussi le caractère cyclique de cette scène. Des artistes d’aujourd’hui reprennent les éléments bases du rap plus traditionnel après l’avoir poussé presque hors de ses limites. Qu’il s’agisse de Realo, présent dans la partie centrale, ou de TKKF et FEMTOGO dans la partie droite, leurs univers respectifs évoluent en ce sens : moins d’Autotune, de glitchs et d’effets sur les voix pour renforcer le sens et les paroles, ainsi qu’une identité graphique se détachant des images 3D. Peut-on alors parler de la numérisation du rap après les années 2020 comme d’une tendance ? S’agit-il de la suite d’un cycle naturel, alternant entre renaissance, évolutions nombreuses, et oubli, pour ensuite recommencer ? Le rhizome continuera inévitablement à créer de nouveaux sous-genres, tant que les créateur·ices musicaux et graphiques seront désireux·ses de se réapproprier ces esthétiques qui les inspirent.
BEAUVAIS Yann, Monter Sampler : L’échantillonage généralisé, Paris : Ed. du Centre Pompidou, 2000
BOSSEUR Jean-Yves, Musique et arts plastiques : Interactions aux XXe et XXIe siècles, Minerve, 2015
BOSSEUR Jean-Yves, Le sonore et le visuel : intersections musique/arts plastiques aujourd’hui, Paris : Dis-voir, 1992
BURTE Laurent, Scratch graphique : Un recherche typographique au plus profond du son, Paris ; PYRAMID ntcv, 2003
Genius, anciennement Rap Genius, site web contributif consacré à
l’explication, l’annotation des paroles de chansons. Devenu avec le
temps une sorte d’encyclopédie musicale (https://
LUIS Cristina, L’hyperpop fait fureur auprès des jeunes Espagnols, traduit de l’espagnol par Courrier International, 6 août 2024 (en ligne : https://
OSWALD John, Nomad’s Land n°3, Éditions Kargo, 1998, traduit de l’anglais par Rémi Rousseau.
PLANTARD Pascal, E-inclusion: braconnage, bricolage et butinage. 2013,
pp.16–22. hal-01739761 (en ligne :
https://
Single : morceau sortant seul, généralement avec une communication importante car avec un potentiel perçu comme intéressant commercialement.
EP (Extended Play) : projet à la durée courte, généralement autour de cinq morceaux, misant sur l’efficacité d’un univers, d’une proposition musicale à transmettre en quelques titres.
Mixtape : format plus complexe car peu défini. Il s’agissait à l’origine de cassettes réalisées par les DJs compilant des morceaux de différent·es artistes. Aujourd’hui, le terme est employé pour des projets plus libres, d’une durée longue mais sans pour autant posséder la cohérence artistique d’un album, comme un regroupement de morceaux avec plusieurs artistes invité·es par exemple.
Album : objet perçu comme important dans le monde de la musique, souvent l’aboutissement de plusieurs années de réflexion, de maturation artistique. Il s’agit d’un évènement important dans la carrière d’un artiste, qui dévoile une proposition musicale et visuelle nouvelle, témoins de son évolution artistique.
Dans le rap, la période des années 1980 à 1990, étendue jusqu’au début des années 2000, est particulièrement déterminante et influente pour le genre. L’importance de cet âge d’or est telle qu’on retrouve son influence partout chez les artistes futur·es. Celleux-ci y font référence directement par leurs paroles, samples ou rythmiques utilisées, ou choisissent au contraire de tourner le dos complètement à cette esthétique, ce qui constitue aussi en soi une forme de reconnaissance. Musicalement, le rythme du boom-bap* synthétise bien l’esthétique de ce rap classique : des percussions dominantes, formant une boucle sur laquelle l’artiste peut venir déployer sa technique lyrique. Dans cette partie du rap, l’accent est mis sur les paroles, les rimes, et le sens. Jusque dans les années 2010, le boom-bap dominait le paysage du rap. Son BPM lent permet de former des phrases longues, complexes, et les rappeur·euses s’attardent alors particulièrement sur leurs textes. Si les thèmes, la façon de les aborder, la manière de construire et de placer les schémas de rimes ont évolué au cours des décennies, l’essence reste la même.
Vers 2012, l’explosion de la trap chamboule le paysage, avec ses BPM beaucoup plus rapides. Les percussions utilisées sont aussi plus variées, et ont des sonorités très numériques. En effet, celles-ci ci sont désormais produites en majorité sur les nouveaux logiciels de composition : les stations audionumériques (DAW) comme FL Studio, Ableton, Pro Tools… En même temps que s’opère ce glissement vers la trap, les textes des rappeur·euses évoluent, influencé·es par la trap américaine aux propos souvent violents sur les armes et la drogue (sujets déjà présents auparavant, mais moins mis en avant). Ce n’est qu’après quelques années d’expérimentations musicales et l’arrivée d’une nouvelle génération, après 2015, que la trap se diversifie et perd progressivement sa connotation violente. Celle-ci devient alors définitivement la norme dans le rap, et prend de multiples facettes : elle peut désormais se faire mélancolique, associée à du chant, ou simplement servir de base pour qu’un·e rappeur·euse expose sa technique, remplaçant le boom-bap dans le choix d’instrumentale par défaut. Les rythmiques présentes dans la trap sont également très diverses, ce qui en fait un genre difficile à cloisonner. Le boom-bap est de son côté instantanément reconnaissable et qualifiable comme tel.
Difficile, dans le monde de la création artistique, de passer à côté du
débat épineux autour de l’intelligence artificielle. Celle-ci promet de
générer des images, des vidéos, et même des voix et des instruments à
budget très réduit voire gratuitement. Beaucoup se sont déjà
engouffré·es dans la brèche, en majorité des petit·es artistes, n’ayant
pas forcément les compétences ou le réseau nécessaire pour réaliser une
pochette et un clip pour accompagner leur morceau. D’autres plus gros
artistes ont récemment commencé à associer l’IA avec leur musique, parfois plus ou moins bien. Jolagreen23 illustrera ainsi plusieurs
morceaux de son projet +99XP par des visualisers entièrement réalisés
par IA Jolagreen23, KEDOISJEFAIRE, 2024, générant beaucoup de débats et de divisions au sein de ses
auditeur·ices. Il faut noter que ces visuels sont en réalité peu
inventifs dans l’utilisation qu’ils font de l’IA. On y reconnaît ces
mouvements de caméra ralentis, dans une entre-deux étrange entre la
stabilité et le tremblement, ces lumières jaunâtres, ces objets dans le
fond qui se transforment ou sont simplement indéfinissables. Ces visuels
sont le symptôme d’une utilisation plutôt paresseuse de l’IA, qui semble
avoir été utilisée pour combler un manque, soit de vision artistique, soit d’équipe technique.
Jolagreen23, KEDOISJEFAIRE, 2024, générant beaucoup de débats et de divisions au sein de ses
auditeur·ices. Il faut noter que ces visuels sont en réalité peu
inventifs dans l’utilisation qu’ils font de l’IA. On y reconnaît ces
mouvements de caméra ralentis, dans une entre-deux étrange entre la
stabilité et le tremblement, ces lumières jaunâtres, ces objets dans le
fond qui se transforment ou sont simplement indéfinissables. Ces visuels
sont le symptôme d’une utilisation plutôt paresseuse de l’IA, qui semble
avoir été utilisée pour combler un manque, soit de vision artistique, soit d’équipe technique.
D’un autre côté, d’autres artistes
réfléchissent plus en profondeur leur rapport à cette nouvelle
technologie, et ouvrent la porte vers une utilisation plus modérée et
plus accompagnée de l’IA. Ainsi, Luther, grâce à une équipe de
production spécialisée dans le traitement d’images et l’intelligence
artificielle, donnera naissance au clip ALED_EXIT_PRORES Luther, ALED
Luther, ALED
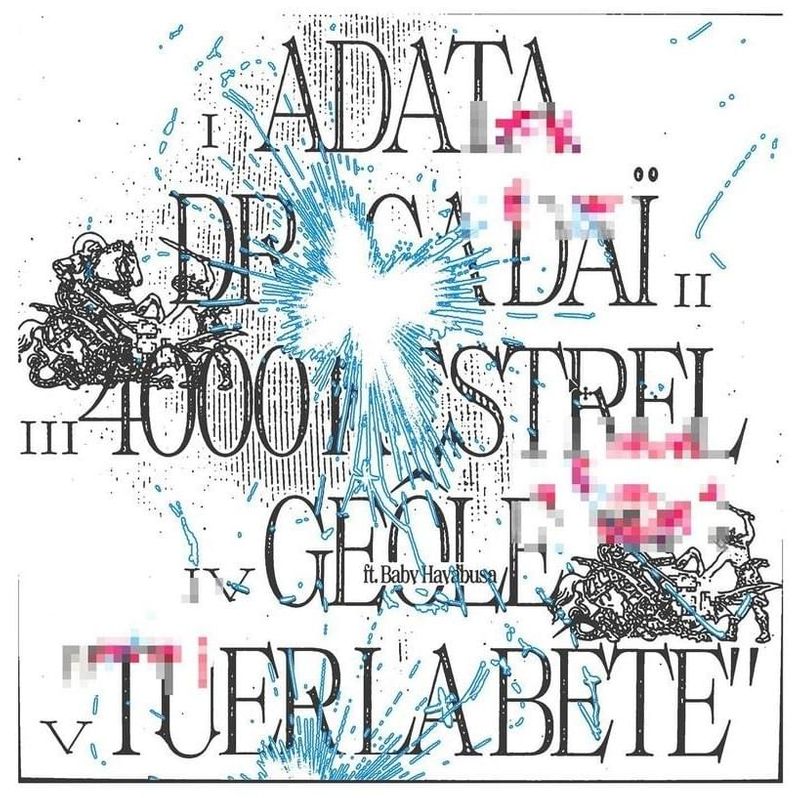

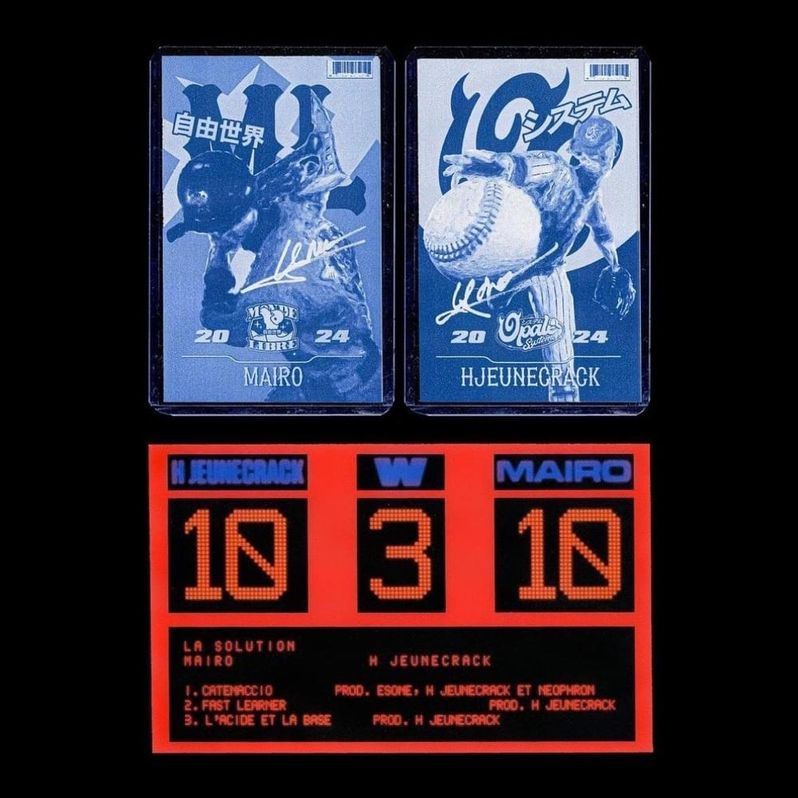

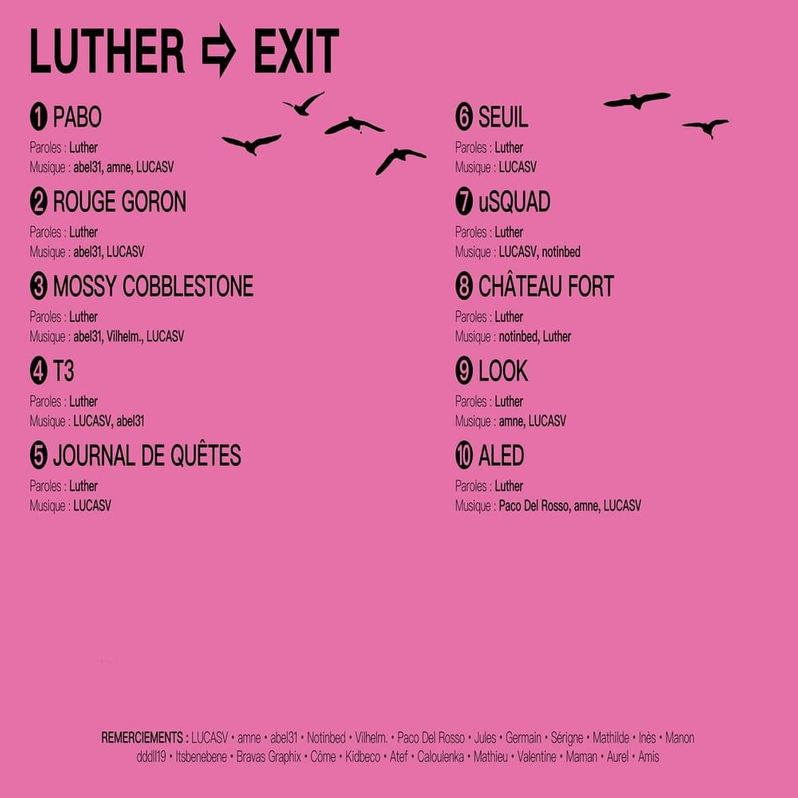
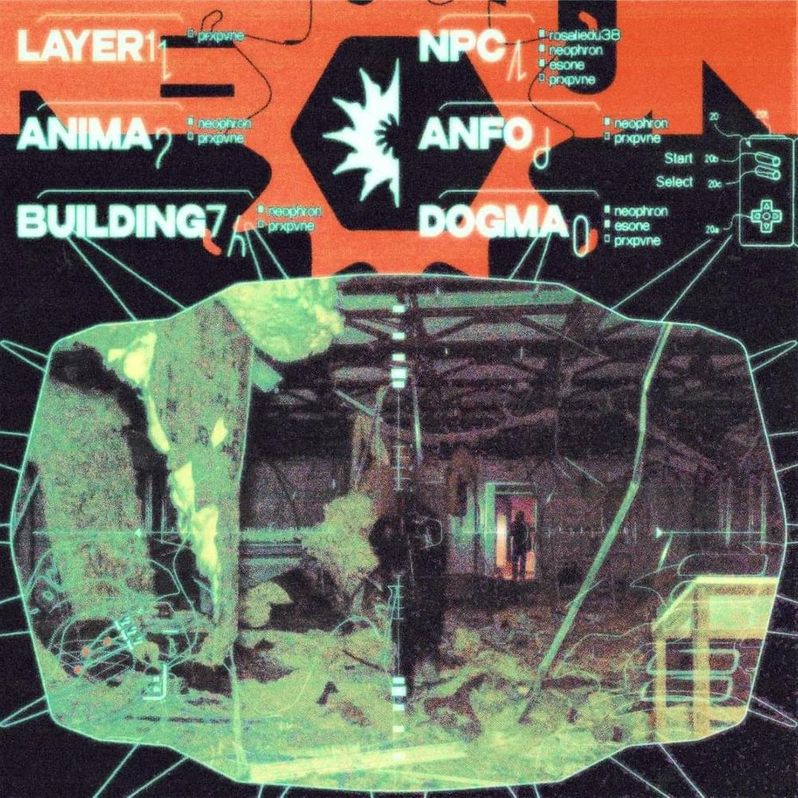

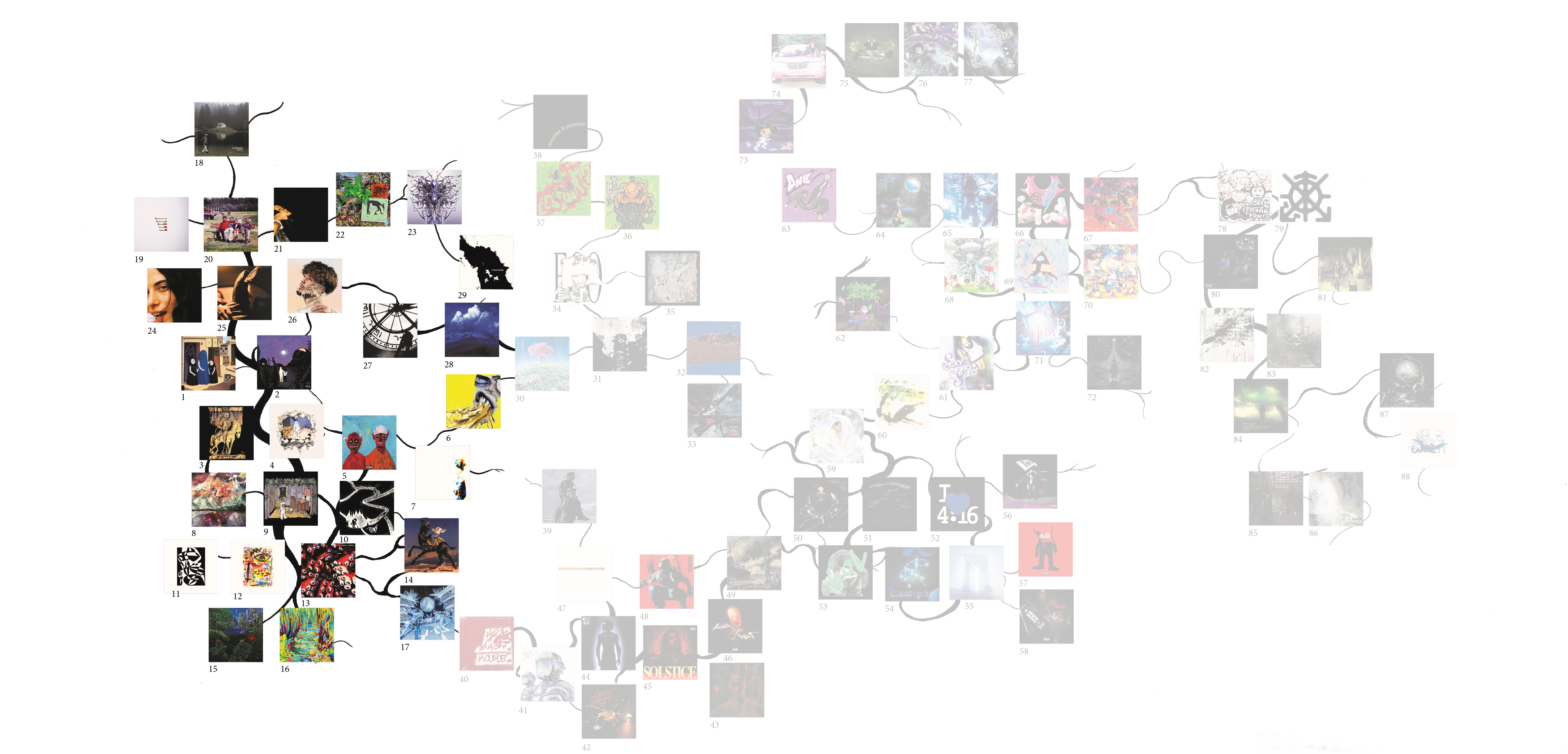
1– Osmin, Zinée
2– Cobalt_, Zinée
3– XIII, Asinine
4– Brûler la maison, Asinine
5– KOLAF, La Fève & Kosei
6– GOLDMAKER, Ajna
7– LA COURSE? NeS
8– Global Warming, Bricksy & 3G
9– Tales from Genovie, Bricksy & 3G & Azur
10– 3ème cycle, Hjeunecrack
11– CANDELA, Keroué
12– Eckmühl, Keroué
13– La pieuvre, Hjeunecrack
14– omar chappier, Mairo
15– Jungle des illusions vol.1, Jungle Jack
16– Jungle des illusions vol.2, Jungle Jack
17– La solution, Hjeunecrack & Mairo
18– haven, bupropion
19– merci, Wallace Cleaver
20– à la recherche du temps perdu, Wallace Cleaver
21– REGARDE, Henri Bleu
22– FéérieMusique, Henri Bleu
23– armor, Henri Bleu
24– baiser, Wallace Cleaver
25– 41BORO, Wallace Cleaver
26– IL ME RESSEMBLE PAS NON PLUS, Khali
27– 23, Khali
28– Le jour se lève, Selug & Senar
29– Cascade, Lovarran
30– PREMIERE RENCONTRE, Planaway
31– GARÇON, Luther
32– EXIT, Luther
33– uuSymphonie, Nyluu
34– ego, 6ilverr
35– i see dead birds, 6ilverr
36– 1M NE SE GASPILLE PAS TOUT SEUL, wasting shit
37– les fourmis, wasting shit
38– Terrorisme de proximité, wasting shit & tommy moisi
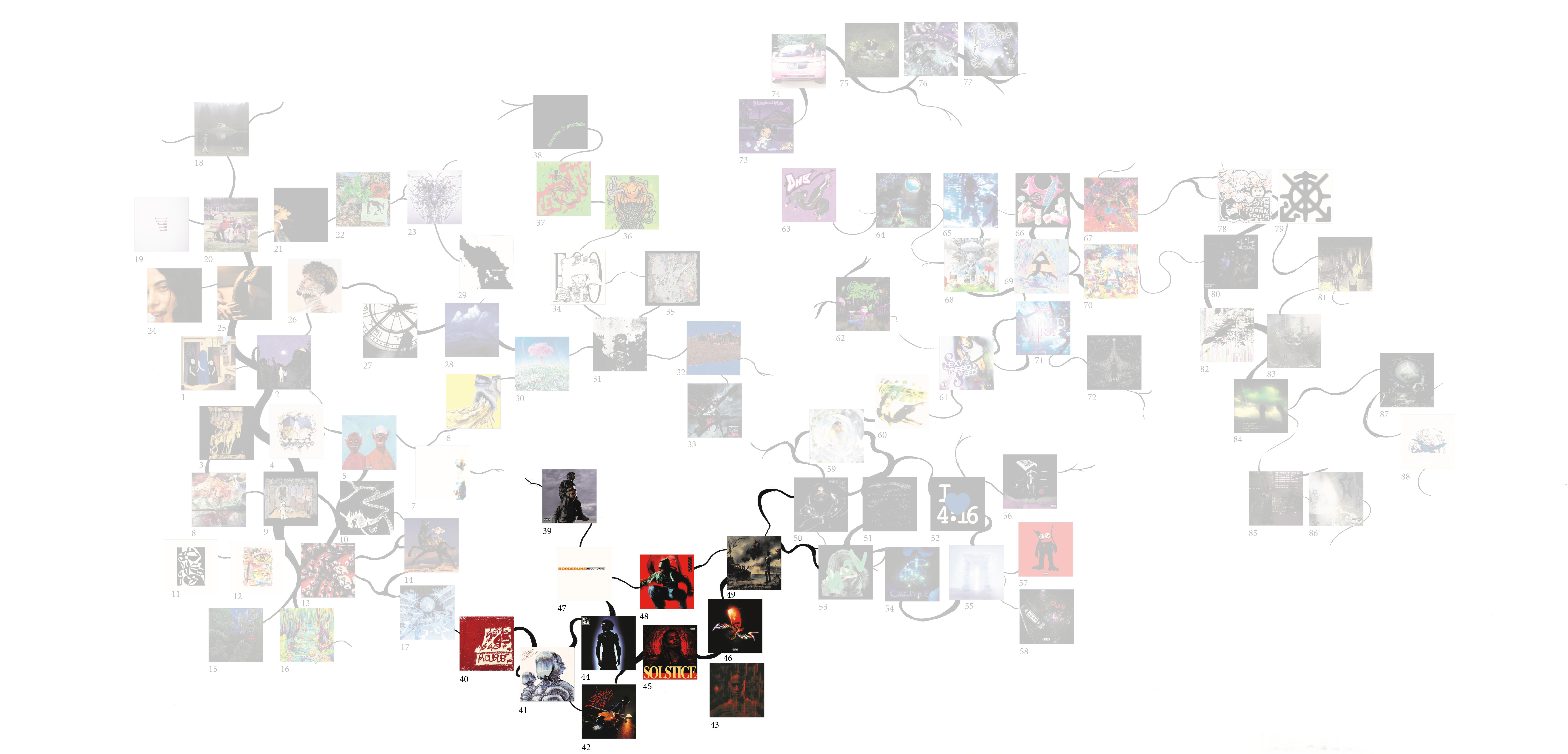
39– ERRR, La Fève
40– 45 et rouge, Mairo
41– QUI A VOLÉ LE SOLEIL ?, Mairo & Slimka
42– Deadly Poison Sting, baby hayabusa
43– 6KLOP EP, Slimka
44– +99XP, Jolagreen23
45– SOLSTICE, Lala &ce
46– Tunnel Vision, Slimka
47– BORDERLINE, Realo
48– RECHERCHE&DESTRUCTION, Jolagreen23
49– Le Grand Mystico, Slimka
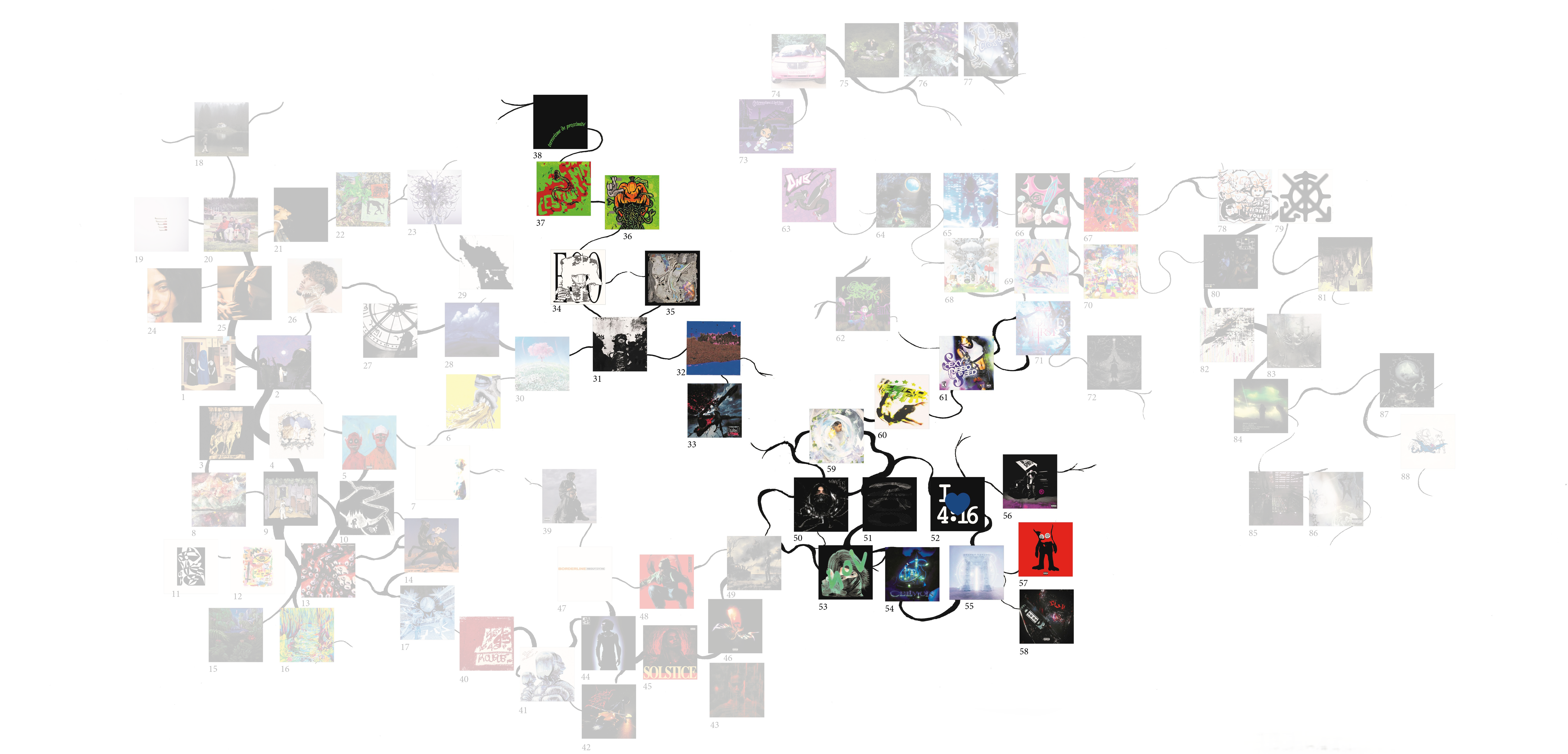
50– WINNTERMANIA, Winnterzuko
51– 200, abel31
52– 4h16, abel31
53– VON, Winnterzuko
54– OBLIV!ON, Zoomy
55– GATE, Zoomy & Vilhelm.
56– DIRTYSPRITE19R, Zoomy
57– ONTHEWAYTOTHEWOAYEAH, Zalmad
58– SUPERWOAHYEAH, Zalmad
59– EMOTION, Realo
60– EURO STEP, Realo
61– SEXY TURBO SPEED, Realo & Zoomy
62– Sauce Park, Lovarran
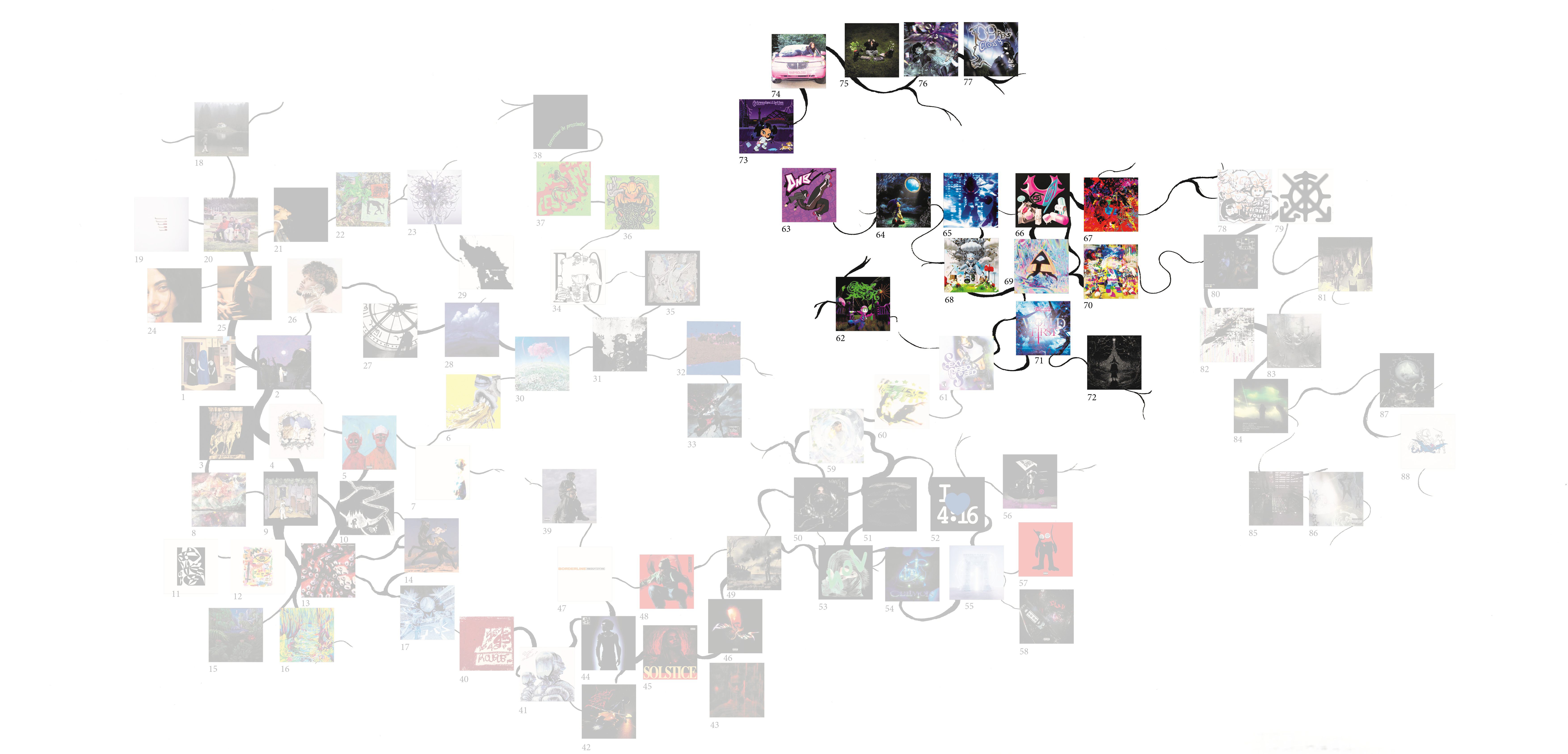
63– DNB, Gemroz
64– SXMMER! l0ng, TKKF
65– H3LLO! w0rld, TKKF
66– PILLZ & KANDY KRUSH, 55ASKY
67– no arnak, no noob_, snorunt
68– L’histoire de Dyspeed, Dyspeed
69– glalie, snorunt
70– vivienne westwood, snorunt & shaadi
71– world first, web7
72– wizard child, web7
73– Stress & Paillettes, Bricksy & 3G & BabySolo33
74– Radio $ummer Hits, BabySolo33
75– Summer Angels, 09PEAS
76– Rockstar tragedy, 09PEAS
77– Cloud9, 09PEAS
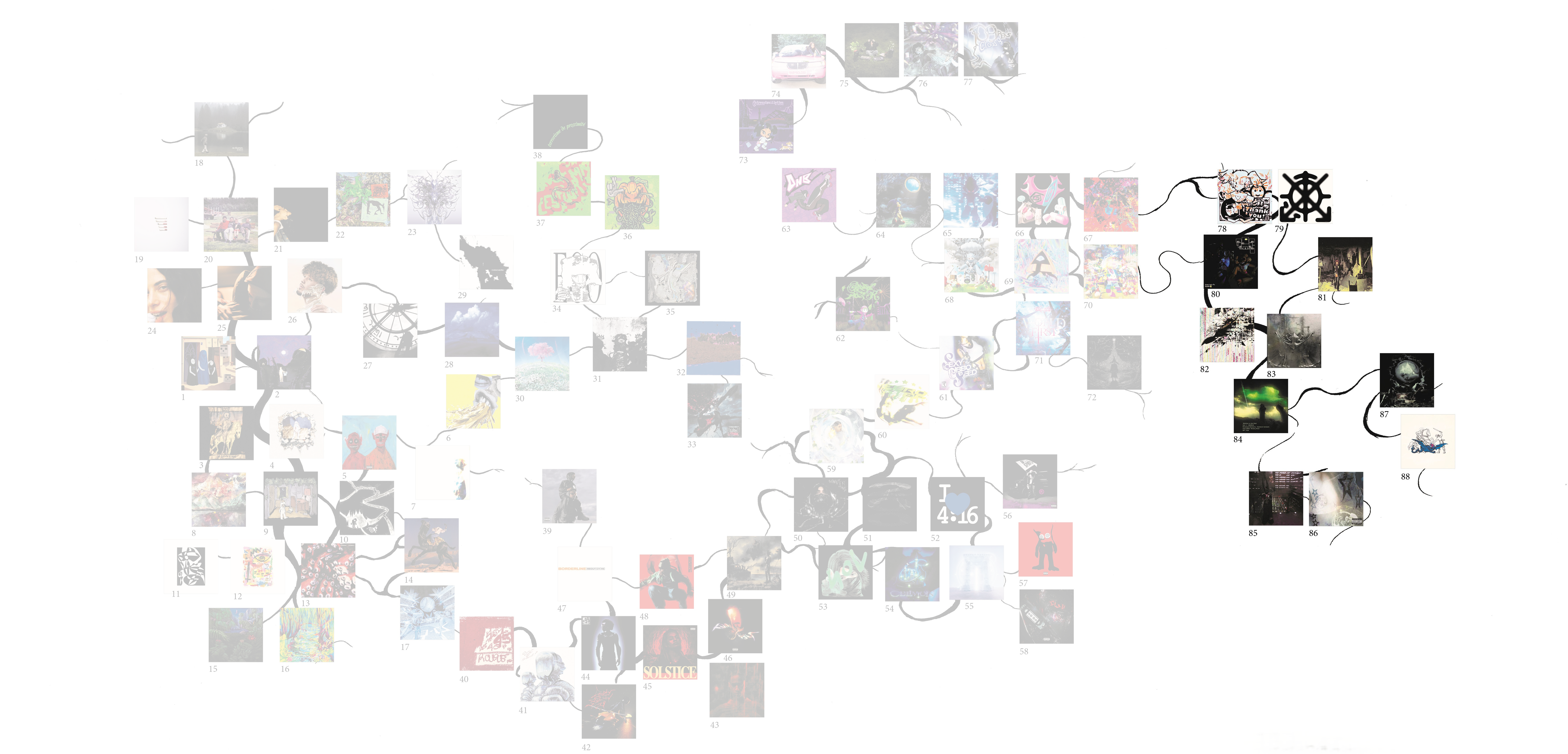
78– karma, Ptite Soeur & Rosaliedu38 & esone & Neophron
79-NOUVELLE ECONOMIE_, Ptite Soeur
80– KAYFABE CHIMERA, Gemroz & Ptite Soeur
81– RED႟UN, Ptite Soeur
82– Dirty Synths and Nice Bars, Meel B & IRKO
83– DANGER RAPPROCHÉ, IRKO
84– Ghillie in the Mist, IRKO
85– HINTERHALT pt1, Douze Déluge
86– LEAVE ME ALONE/OK, Douze Déluge
87– NAMELESS BELLIGERENT, FEMTOGO
88– La Bête, FEMTOGO & Vilhelm.
Merci à Corinne Melin pour ses nombreuses relectures, corrections, et son aide tout au long de la rédaction !
Merci aux professeur·es du pôle Nouveaux Médias pour leur accompagnement !
Merci à ma maman pour ses relectures, corrections et conseils malgré le sujet complètement en dehors de son champ d’intérêt !
Merci les copaines de la classe d’être là et de m’aiguiller quand je doute !
Merci le rap d’être un univers aussi créatif et diversifié !!!
BOSSEUR Jean-Yves, Le sonore et le visuel : intersections musique/arts plastiques aujourd’hui , Paris : Dis-voir, 1992 ↩︎
BOSSEUR Jean Yves, Musique et arts plastiques, Interactions aux XXe et XXIe siècles, Minerve, 2015 ↩︎
BOSSEUR Jean Yves, Le sonore et le visuel, p.5 ↩︎
BOSSEUR Jean Yves, Le sonore et le visuel, p.5 ↩︎
Note de l’éditeur (4ème de couv), BOSSEUR Jean-Yves, Le sonore et le visuel ↩︎
GIARD Luce, préface pour L’invention du quotidien, Michel de Certeau, 1990. ↩︎
BEAUVAIS Yann, Monter Sampler : L’échantillonage généralisé, Paris : Ed. du Centre Pompidou, 2000 ↩︎
H Jeunecrack & Mairo, Catenaccio, 2024 ↩︎
OSWALD John, Nomad’s Land n°3, Éditions Kargo, 1998, p. 9 et 11, traduit de l’anglais par Rémi Rousseau ↩︎
Wallace Cleaver, plus rien n’est grave, dans l’album merci, 2024 ↩︎
Cristina Luis, L’hyperpop fait fureur auprès des jeunes Espagnols, 2024 ↩︎
Cristina Luis, L’hyperpop fait fureur auprès des jeunes Espagnols, 2024 ↩︎
Processus créatif posté sur Instagram par les responsables de la post-production : https://