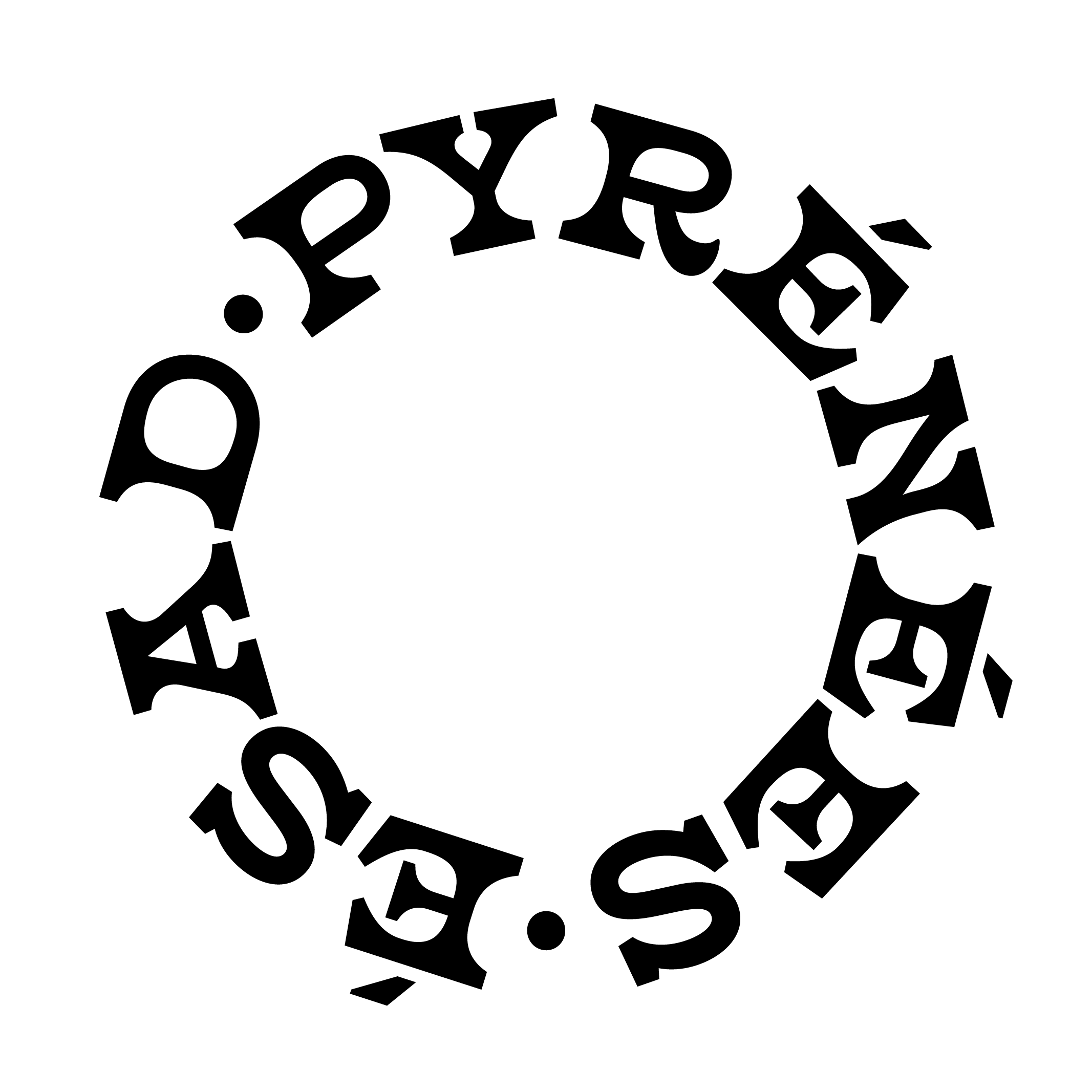I. Introduction
« Que connaîtront nos enfants, au-delà des ouvrages d’explorateurs, des films qui nous survivront et des planches Deyrolle qui continueront à nous faire rêver ? Alors réapproprions-nous l’art d’être de comprendre pour agir, celui d’être responsable pour l’avenir1 ».
Voilà les mots de Louis Albert de Broglie, propriétaire de Deyrolle, une institution scientifique et pédagogique qui existe depuis 1831 et qui s’efforce d’adapter son matériel pédagogique aux enjeux écologiques contemporains. Selon lui, il est primordial que la littérature sur le monde naturel s’adapte sur le fond et sur la forme pour qu’elle ne devienne pas un cabinet de curiosité témoignant de la disparition du vivant.
Les premiers ouvrages pour enfants sur le monde naturel sont apparus en Europe au XVIIIe siècle2, bien qu’ils soient encore peu répandus car réservés à l’aristocratie. Ils avaient pour objectif principal d’informer les lecteurs sur l’existence des espèces avec des enjeux exclusivement pédagogiques et depuis une perspective anthropocentrique, qui concevait le monde naturel comme séparé de l’homme. La représentation graphique a été utilisée comme outil d’étude et de médiation pédagogique de l’histoire naturelle. Les préoccupations relatives à la préservation des espèces n’étaient alors pas encore présentes dans les ouvrages.
Le concept d’écologie est né en Allemagne au milieu du XVIIIe siècle sous l’impulsion du biologiste et artiste Ernst Haeckel, qui l’a défini comme étant « la science des relations des organismes avec le monde environnant, c’est‑à‑dire, dans un sens large, la science des conditions d’existence3 ». Par la suite, le terme s’est lentement répandu dans tout l’Occident au cours du XIXe siècle. Dès lors, le monde naturel a commencé à être perçu comme menacé et digne de protection4, ce qui correspond à la conception de l’écologie telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Simultanément à la naissance de la notion d’écologie, la place de l’image comme représentation réaliste et fiable de la nature a été instaurée par les travaux des explorateurs européens. Ces derniers ont inscrit la découverte des nouvelles espèces et des nouvelles connaissances dans leurs carnets de voyage et planches naturalistes en utilisant l’illustration naturaliste comme technique de représentation artistico-scientifique.
Postérieurement à la révolution graphique des années 1950, la création graphique et littéraire devient un phénomène éditorial remarquable par son ampleur et ses succès pédagogiques5. Les livres documentaires pour la jeunesse se modernisent réellement dans les années 1970 et abordent de nouveaux thèmes qui mettent en évidence les problèmes environnementaux. Ils rendent la notion d’écologie plus militante et dans certains cas, cette notion devient aussi le thème principal d’un ouvrage.
Aujourd’hui, la sensibilisation à l’environnement ne se limite pas seulement à transmettre des connaissances sur le vivant mais vise également à encourager les jeunes lecteurs à devenir des acteurs engagés face à la crise environnementale. À leur tour les livres documentaires jeunesse abordent différents thèmes écologiques qui sont catégorisés par la littérature comme éco‑thèmes.
Parallèlement à l’évolution de la sensibilisation à l’environnement et au développement de la notion de lecteur engagé, les livres documentaires pour enfants présentent de nouveaux regards sur la nature (les animaux, les plantes, les phénomènes naturels, les écosystèmes…)6. Ils déplacent la notion de « nature », héritée de la pensée anthropocentrique occidentale, et la remplacent par une nouvelle notion, celle du « vivant », qui prend de plus en plus de poids ces dernières années.
La représentation graphique du vivant se construit à partir d’un ensemble d’interactions qui mettent en cause les frontières naturelles et culturelles à l’échelle planétaire. L’ensemble de ces interactions, qui dans le livre documentaire jeunesse réunit texte et image, est appelée par la littérature jeunesse comme éco‑graphies. Les auteurs contemporains utilisent la complexité des interactions du vivant pour enrichir la représentation graphique de l’image en inventent de formes narratives originales, au sein de différents types de registres de sensibilisation à l’environment.
Ce mémoire cherche à mettre en lumière les différentes formes de représentations graphiques liées à la sensibilisation à l’environnement dans l’édition documentaire jeunesse consacrée au vivant, avec une attention particulière sur les livres destinés aux lecteurs autonomes au moins âgés de 7–10 ans et jusqu’à l’âge adulte7. En premier lieu, une partie historique montre les origines de la représentation graphique du vivant (du XVIIIe siècle à l’époque moderne). Ensuite, l’analyse graphique d’un corpus d’œuvres permet de classer les œuvres en trois registres éco‑graphiques de sensibilisation environnemental : le registre didactique, le registre poétique et le registre mixte.
Compte tenu de mes origines chiliennes, pour l’analyse de ce mémoire, j’ai étudié une série d’ouvrages provenant de France et du Chili. Après analyse, j’ai sélectionné cinq ouvrages qui me semblaient les plus représentatifs pour constituer le corpus éditorial (trois provenant de France et deux du Chili). Tous les ouvrages étudiés dans ce mémoire ont été publiés au cours des quatre dernières années.
L’inclusion d’œuvres chiliennes permet d’examiner de manière plus large le concept de sensibilisation à l’environnement et enrichit l’analyse comparative des ouvrages étudiés. L’ensemble des livres étudiés partagent la même vision du monde vivant, dite occidentale. Cependant, ils se distinguent par le fait que leur histoire a été marquée par différentes cultures, qui ont un rapport direct avec l’histoire naturelle. Nous pouvons ainsi constater que la représentation graphique du monde vivant, en intégrant certaines conceptions culturelles, peut varier d’une région à l’autre.
Enfin, dans ces ouvrages les enfants sont invités à s’émerveiller face au monde vivant qui les entoure à travers différents registres de sensibilisation à l’environnement. Les registres éco-graphiques dans les livres documentaires pour enfants exposent en parallèle une nouvelle vision du monde vivant liée aux différents éco‑thèmes de notre époque. Nous pouvons nous demander comment les représentations graphiques dans les livres documentaires jeunesse favorisent-elles la sensibilisation et l’engagement à l’environnement du lecteur ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre quelles formes prennent les différents registres éco‑graphiques, à travers quels types de représentations graphiques ils s’expriment et quels sont les thèmes écologiques qu’ils abordent.
II. Rétrospective du travail graphique et scientifique des naturalistes du XVIIIe siècle
Il est difficile de parcourir l’histoire de la représentation du monde vivant sans se souvenir de l’énorme travail accompli dans le domaine de la science, de l’art et de la vulgarisation par les explorateurs naturalistes du XVIIIe siècle. Face aux nombreuses découvertes qu’il fallait classer, nommer et comprendre, ils ont posé les fondements, créé les théories, inventé les concepts, nommé les espèces et défini les styles de représentation graphique de la nature. Ces travaux et ces illustrations ont été inscrits dans leurs carnets de voyage, leurs planches naturalistes et des encyclopédies.
Les œuvres du XVIIIe siècle constituent une source d’inspiration
importante pour les auteurs actuels de livres documentaires jeunesse.
Les écrivains, les illustrateurs, les designers graphiques enrichissent
et renouvellent ces travaux afin d’accompagner les découvertes et les
changements de notre environnement.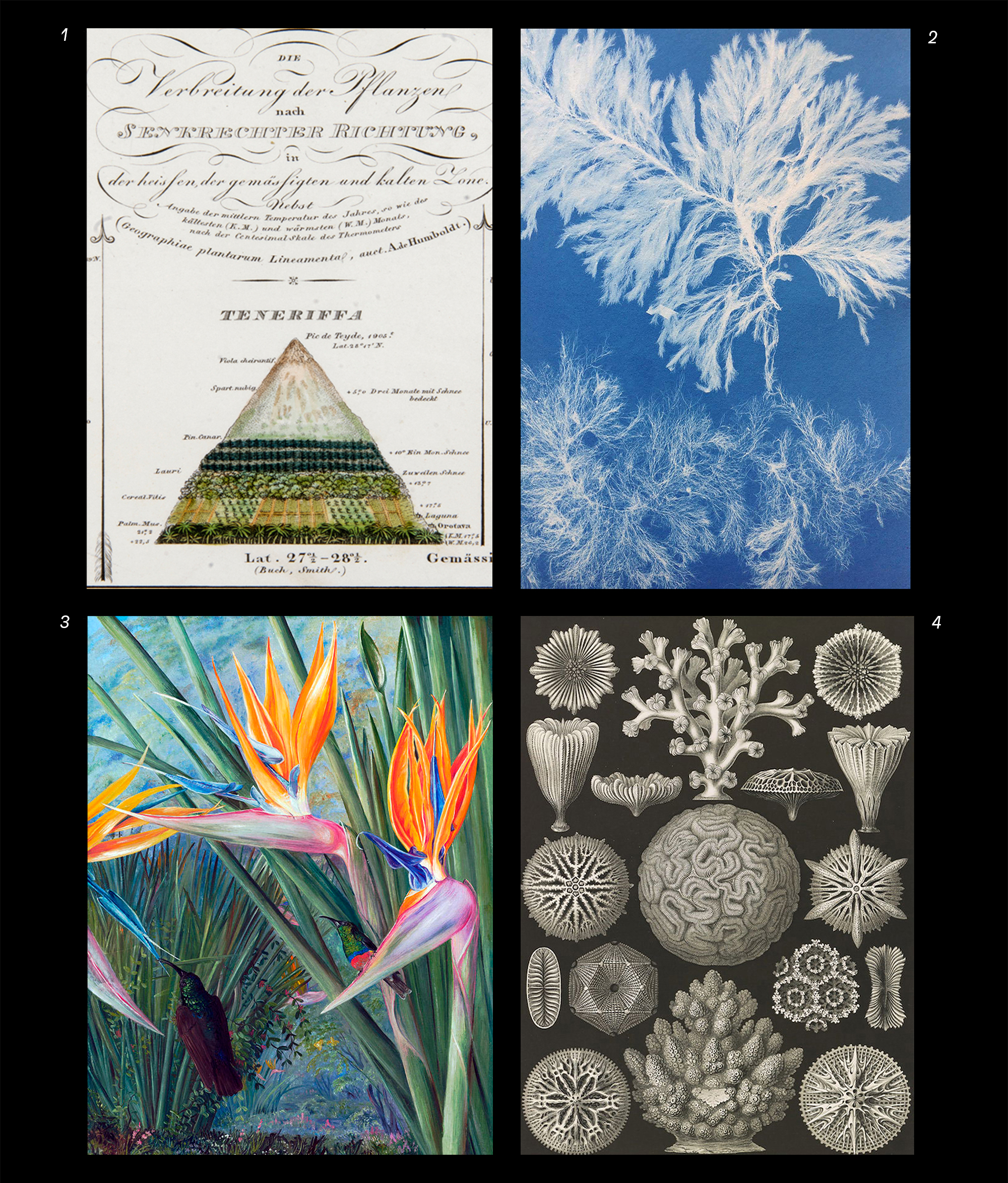
II.1. Alexander von Humboldt, un pionnier dans la représentation de données
Alexander von Humboldt (1769–1859) était un naturaliste, géographe et explorateur allemand. En 1799, il entreprend une exploration scientifique du continent américain, accompagné du botaniste français Aimé Bonplan. Les deux scientifiques ont parcouru le continent en décrivant et en dessinant tous les nouveaux faits et découvertes scientifiques qu’ils ont observés dans la nature. Ensemble, ils ont exploré le Venezuela, le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Pérou, Cuba et le Mexique8.
Après cette exploration, en 1804, à son retour en Europe, il devient le scientifique le plus célèbre et le plus influent de son époque. Ses textes ont été publiés en plusieurs langues et, par ses livres, ses illustrations, ses peintures de paysages et ses cartographies, il a contribué à la vulgarisation de la science, tant au niveau local qu’international.
Le style de représentation graphique d’Alexander von Humboldt reflète
son désir d’être fidèle à la réalité de ses découvertes, de ses
observations et des exigences de la science. Mais il a aussi été un
pionnier dans la présentation d’une vision plus holistique, dans
laquelle il a également donné de l’importance à son imagination et à son
intuition. En effet, dans son travail, il combine des données
scientifiques avec des éléments artistiques, historiques et politiques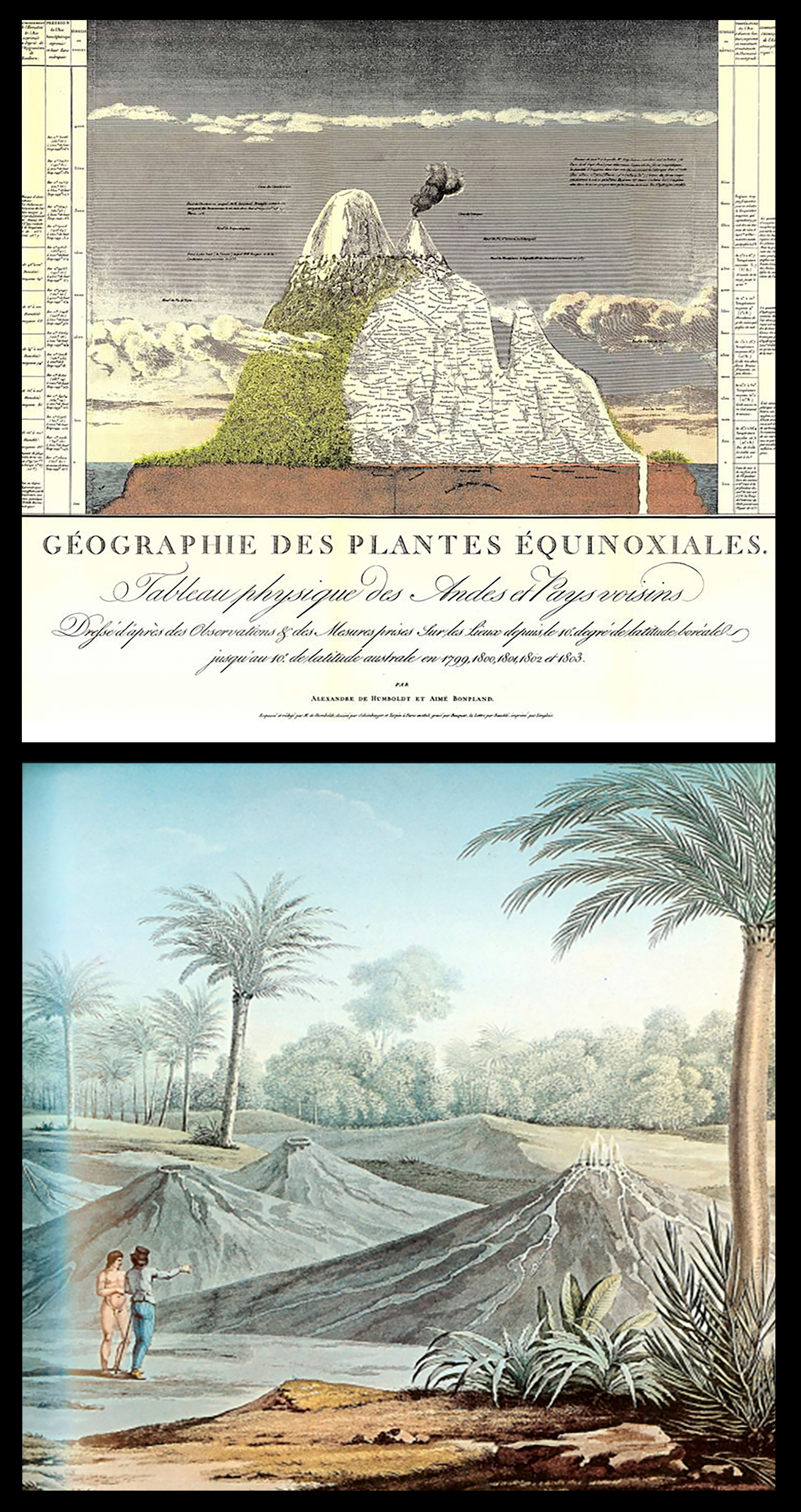 journals
journals
Les peintures de von Humboldt représentant la nature sont très influencées par les recherches de Goethe9 à la croisée de la philosophie et de la botanique. Prenant la forme de cartographies, elles révèlent de nouveaux repères naturels pour la science mais aussi les corrélations et les interconnexions de ces repères.
Pour conclure, nous pouvons penser aujourd’hui que
ces cartographies de données complexes pourraient être les ancêtres des
infographies et de la visualisation de données graphique et
scientifique. En effet, elles combinent le
pouvoir synthétique du diagramme avec l’attrait visuel de la peinture. Sa perspective avant-gardiste de la corrélation entre les espèces vivantes et la sensibilité de la
représentation artistique de ses œuvres étaient novatrices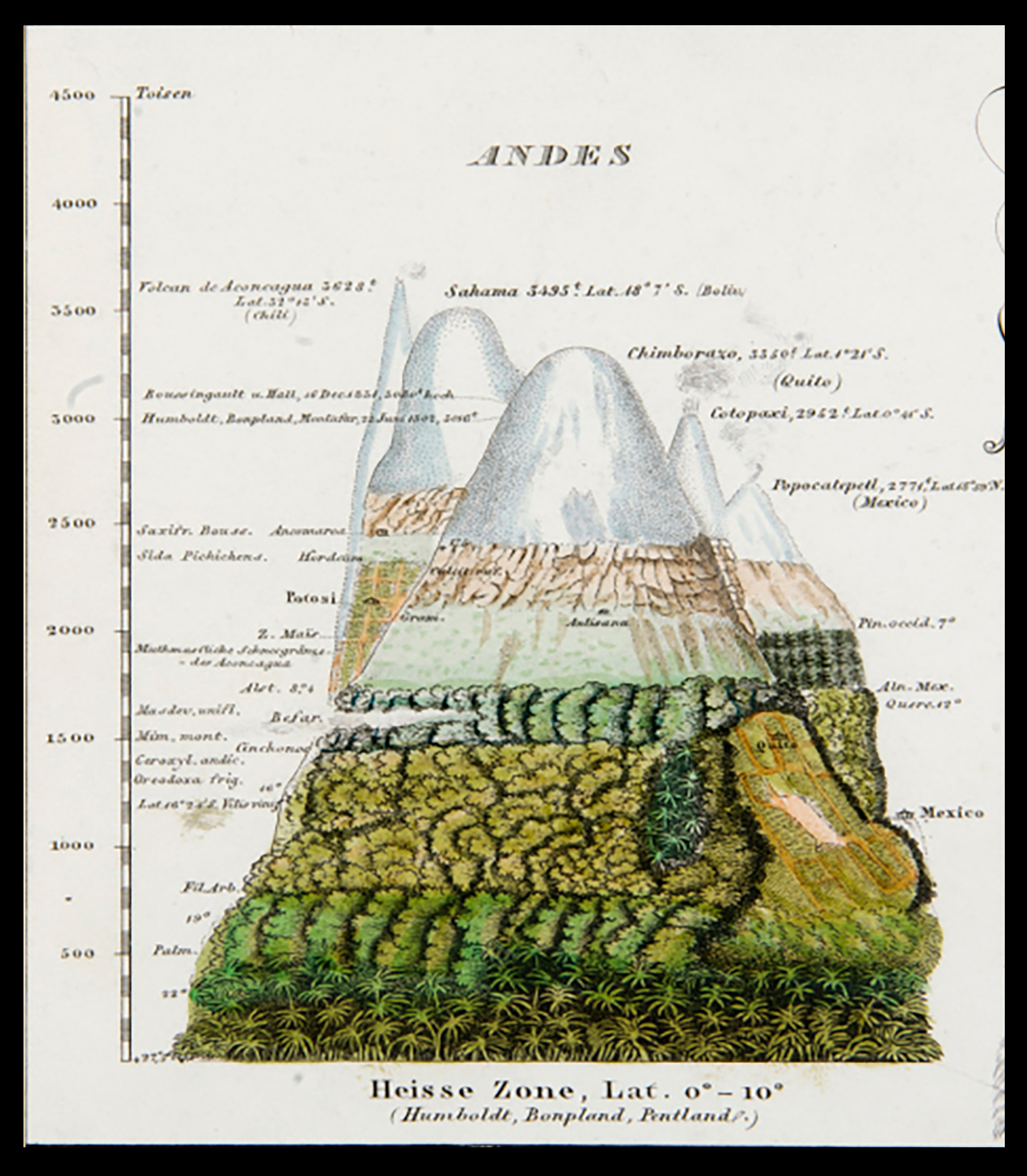 journals
journals
II.2. Anna Atkins, précurseur de la photographie botanique
Anna Atkins (1799–1871) était une botaniste et illustratrice scientifique d’origine anglaise, pionnière de la photographie appliquée aux livres de botanique. Elle fut formée au dessin et aux sciences naturelles par son père, le naturaliste John George Children (1777–1852).
Elle collabora avec son père pour publier en 1825 Genera of Shells, une traduction de l’œuvre L’histoire naturelle des animaux sans vertèbres de Jean-Baptiste de Lamarck, paru en 1822. Elle réalisa plus de deux-cent cinquantes dessins de coquillages pour cet ouvrage.
En 1839, elle intégra la Botanical Society of London et constitua un herbier qui se trouve aujourd’hui au British Museum. Suite à la publication en 1841 du Manual of British Algae de William Henry Harvey (1811–1866), publié sans illustrations, elle procède à la collecte des différentes espèces d’algues britanniques décrites dans l’ouvrage afin d’en faire des reproductions10.
La même année, Anna Atkins utilisa la technique du cyanotype dans la réalisation de l’ouvrage Photographs of British Algae, cyanotype impressions, publié entre 1843 et 1853. Cette technique, mise au point par Henry Fox Talbot, permet d’obtenir des images en négatif sur papier d’objets posés sur une surface photosensible. Ce fut le premier livre utilisant le cyanotype mais aussi le premier livre de botanique illustré par des photographies. L’ouvrage présente trois-cent-quatre-vingt-neuf planches numérotées et autant de spécimens d’algues sous-marines, dont une nouvelle espèce que l’artiste découvrit sur les côtes britanniques.
Les compositions d’Atkins ont toujours été perçues comme poétiques et
harmonieuses11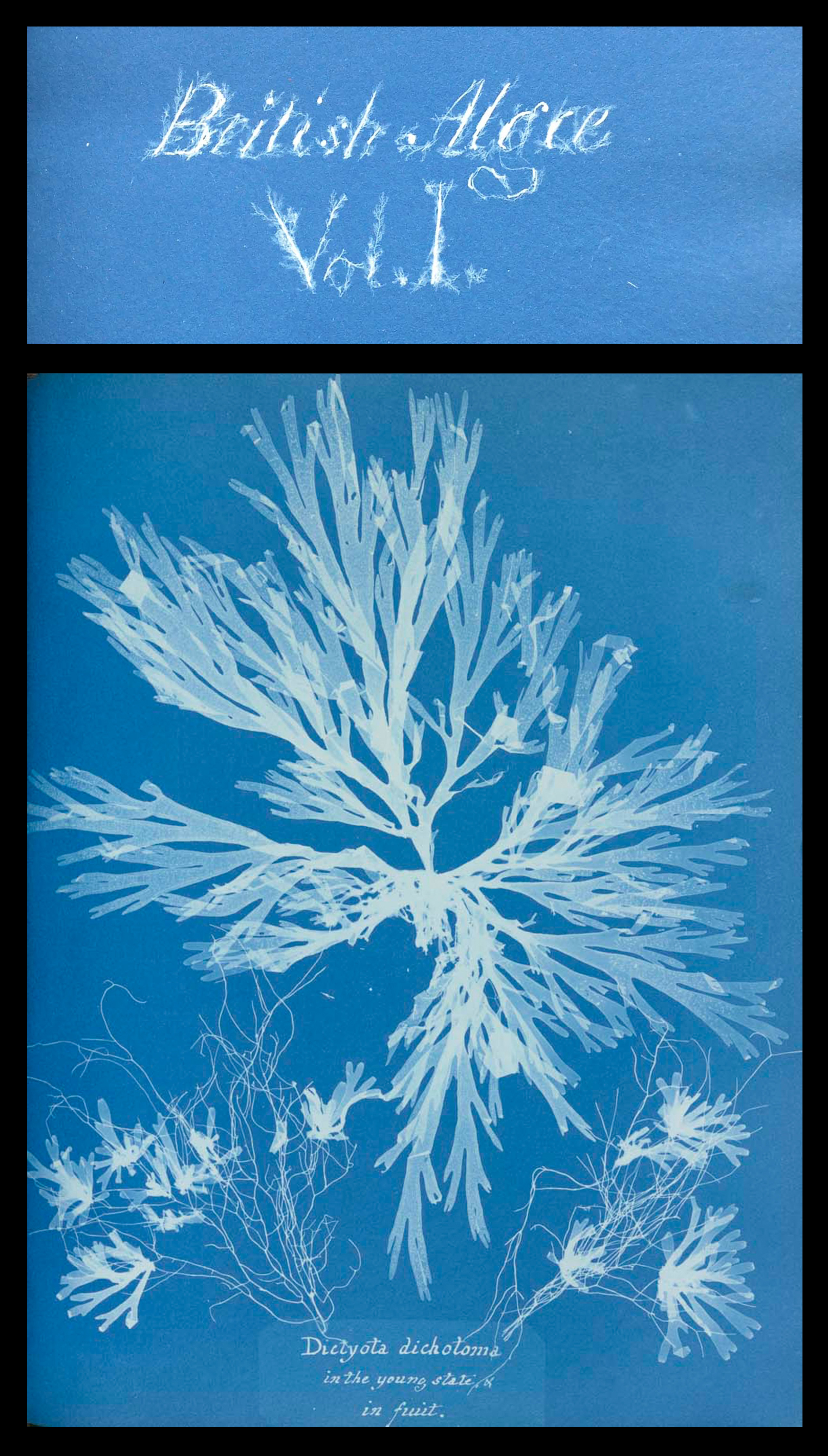 museumcrush
museumcrush
Ces planches témoignent de la détermination de la photographie botaniste à tendre vers l’esthétisme et à rendre l’observation scientifique plus agréable et mémorisable. Le style abstrait d’Atkins continue d’inspirer de nombreux artistes aujourd’hui.
II.3. Marianne North, une vision avant-gardiste de l’illustration scientifique
Marianne North (1830—1890) était une illustratrice et une artiste anglaise qui est devenu la première femme à organiser une exploration scientifique et illustrative au XIXe siècle. Au cours de ses expéditions, elle visita seize pays sur les cinq continents et elle conçut plus de huit-cent œuvres. Elle fut une des premières personnes à reconnaître et à représenter un grand nombre d’espèces de la flore autochtone du monde, nouvelles pour la science. La collection de ses œuvres, actuellement exposée dans la Galerie Marianne North des jardins botaniques royaux de Kew à Londres, est considérée comme une contribution importante tant sur le plan scientifique qu’artistique.
Son style artistique dépasse les règles établies de l’illustration
botanique traditionnelle. Ses œuvres, tout en documentant la diversité
végétale avec la rigueur scientifique requise de l’illustration
botanique, ne se contentent pas de représenter des espèces isolées, mais
les illustrent au sein de leur écosystème complet. Ainsi, les
illustrations exposent des paysages dans leur ensemble incluant faune et
flore. Dans certaines de ses œuvres, elle a également dépeint les
cultures qu’elle a découvertes, les peuples indigènes et leurs tribus.
Sa vision écosystémique est un élément caractéristique de son style
graphique.
La technique d’illustration botanique qu’elle utilisa était également innovante puisque ses œuvres ont été peintes à l’huile et non à l’aquarelle, technique officiellement admise à l’époque pour ce type d’illustration. Elle a appris de manière autodidacte la technique de la peinture à l’huile lors d’un voyage avec son père.
Ainsi, son œuvre est devenue une référence pour les documentalistes contemporains en tant qu’exemple d’art botanique. La vision écosystémique présente dans ses illustrations s’inscrit dans les courants de pensée modernes de l’écologie, où l’on considère que l’équilibre mutuel entre la faune et la flore est indispensable pour maintenir la biodiversité. Par ailleurs, son audace artistique, ses expéditions menées en autonomie et son indépendance font d’elle une source d’inspiration du féminisme.
II.4. Ernst Haeckel, aux sources de l’écologie et de l’art nouveau
Ernst Haeckel (1834–1919) était un célèbre biologiste, zoologiste, philosophe, illustrateur et professeur d’anatomie allemand. Il a donné naissance au terme écologie et il a contribué par ses travaux scientifiques et artistiques à la diffusion de la théorie de l’évolution de Darwin.
Il fut le premier auteur à utiliser le terme écologie, qui vient des mots grecs oikos « maison, habitat » et lógos, « discours » et qui signifie littéralement la science de l’habitat. Il énonça que les notions « sciences » et « habitat » étaient interdépendantes, de sorte qu’il n’était plus possible de vouloir étudier un animal ou une plante sans s’intéresser à ses interactions et interdépendances avec son milieu de vie. Il est pertinent de signaler que cette idée est fondatrice de la discipline de l’écologie mais qu’elle ne correspond pas à sa définition actuelle12.
D’autre part, Ernst Haeckel a été un pionnier dans la diffusion de la théorie darwinienne de l’évolution des espèces. Il a étudié et analysé le darwinisme et l’a agrémenté de schémas visuels illustrés. Ses représentations graphiques ont franchi les frontières, rendant la théorie de Darwin appréciée dans le monde entier.
Il s’est également intéressé au monde marin lors de l’expédition Challenger de 1887 qui étudia des organismes et microorganismes du fond de l’océan allant des mers du Nord à celles des Tropiques. Ces recherches en matière de zoologie et biologie marine l’ont conduit à classer plus de quatre-mille nouvelles espèces de l’océan et à illustrer plus de six-cent espèces de méduses, ainsi que de nombreux autres organismes marins, tels que les éponges, les kératoses, les siphonophores et les radiolaires.
Haeckel a regroupé les dessins du l’expédition Challenger en
compositions illustratives sous forme de planches naturalistes, en
partie reproduites à l’aide des techniques d’impression lithographiques.
Parmi ses œuvres graphiques d’édition les plus emblématiques, nous pouvons
citer, Monographie der Medusen (1879) et Formes Artistiques de la
Nature (1899). 
Les œuvres graphiques et scientifiques de Haeckel témoignent d’une
grande précision scientifique et d’un style artistique original, élégant, méticuleux et réaliste. À travers ses représentations, l’artiste mit en valeur les formes organiques et parfaitement
symétriques d’organismes marins d’une grande complexité. Selon ses
propres termes : « Jamais je n’oublierais le ravissement qui me saisit
lorsque j’observais pour la première fois [les méduses] et que je tentais
de reproduire leurs sublimes formes et couleurs avec mon pinceau13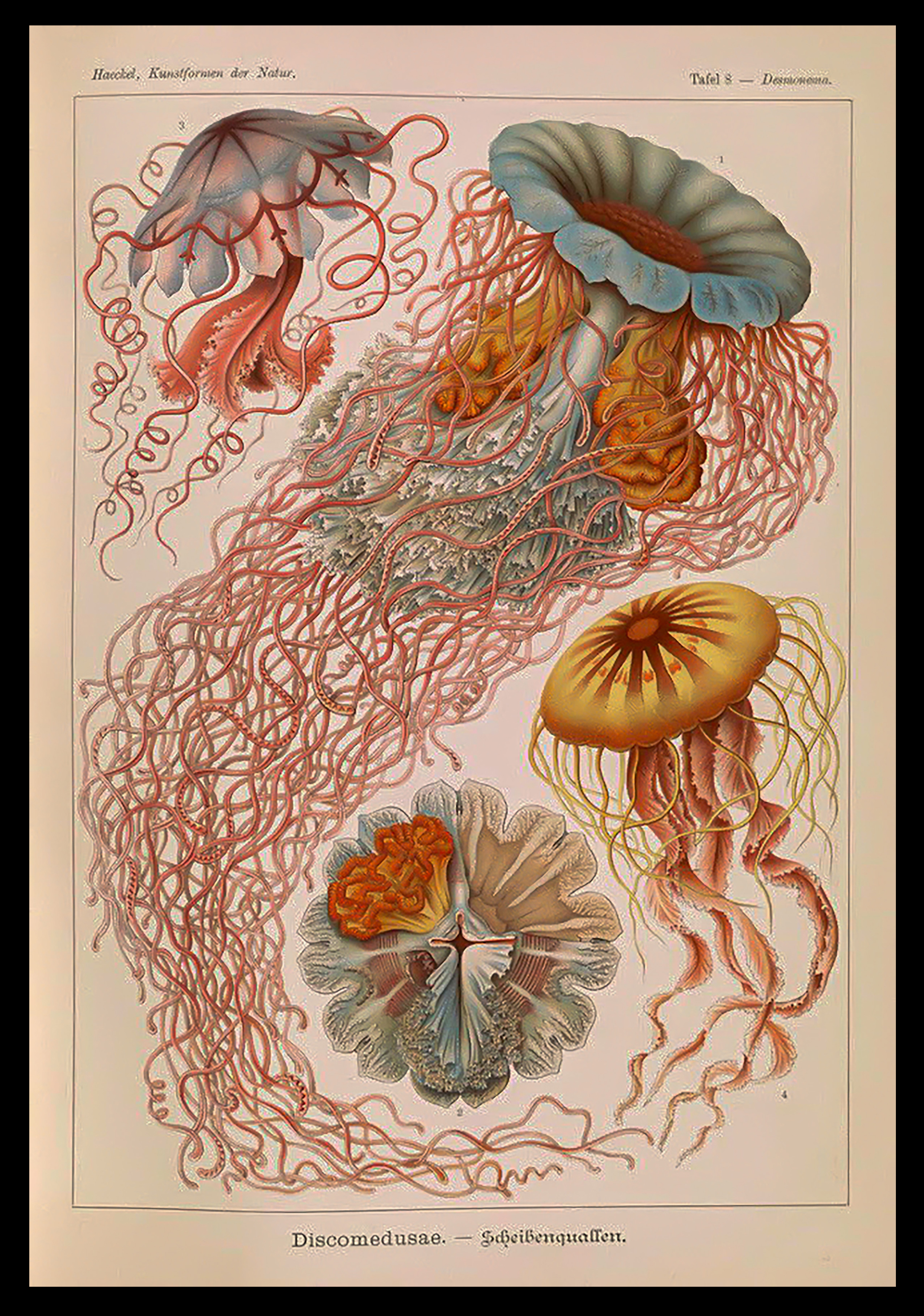 pdimagearchive
pdimagearchive
Ses œuvres méticuleuses ont inspiré le travail des artisans et des artistes qui développèrent le mouvement de l’Art nouveau à la fin du XIXe siècle, caractérisé par des formes organiques et ornementales. Outre l’importance de son héritage artistique, il est primordial de relever son rôle dans la diffusion du concept d’écologie au cours du XXe siècle et dans la transformation de la notion du monde vivant.
III. Évolution de la vulgarisation scientifique
III.1. Deyrolle : planches musé scolaire
Deyrolle est une entreprise fondée en 1831 qui est reconnue comme une institution dans le domaine des sciences et de la pédagogie et qui a eu pour vocation de transmettre aux enfants tout le savoir qui a été découvert par les explorateurs de l’Histoire. A partir de 1866, sous la direction d’Émile Deyrolle, l’entreprise commence à développer des supports pédagogiques pour l’enseignement des sciences naturelles, notamment les célèbres Planches Musée Scolaire Deyrolle. Ces planches illustrent avec une grande précision scientifique la faune et la flore. Elles ont été largement utilisées dans les écoles en France et ont commencé à se diffuser à l’international à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, devenant un outil incontournable dans l’enseignement de l’histoire naturelle14.
En familiarisant les enfants avec la représentation graphique, Deyrolle joua un rôle novateur dans les défis de l’éducation environnementale contemporaine. Instruire à travers le dessin scientifique permet aux enfants d’aiguiser leur sens de l’observation mais aussi de développer la perception des émotions, de la beauté, et plus largement de le rendre sensible à l’art.
Une planche de Deyrolle datant du XIXe siècle reste pertinente dans une
salle de classe, aujourd’hui encore. En effet, l’illustration est
toujours d’actualité car elle permet de présenter des caractéristiques
et des comportements rares ou difficiles à observer dans le milieu
naturel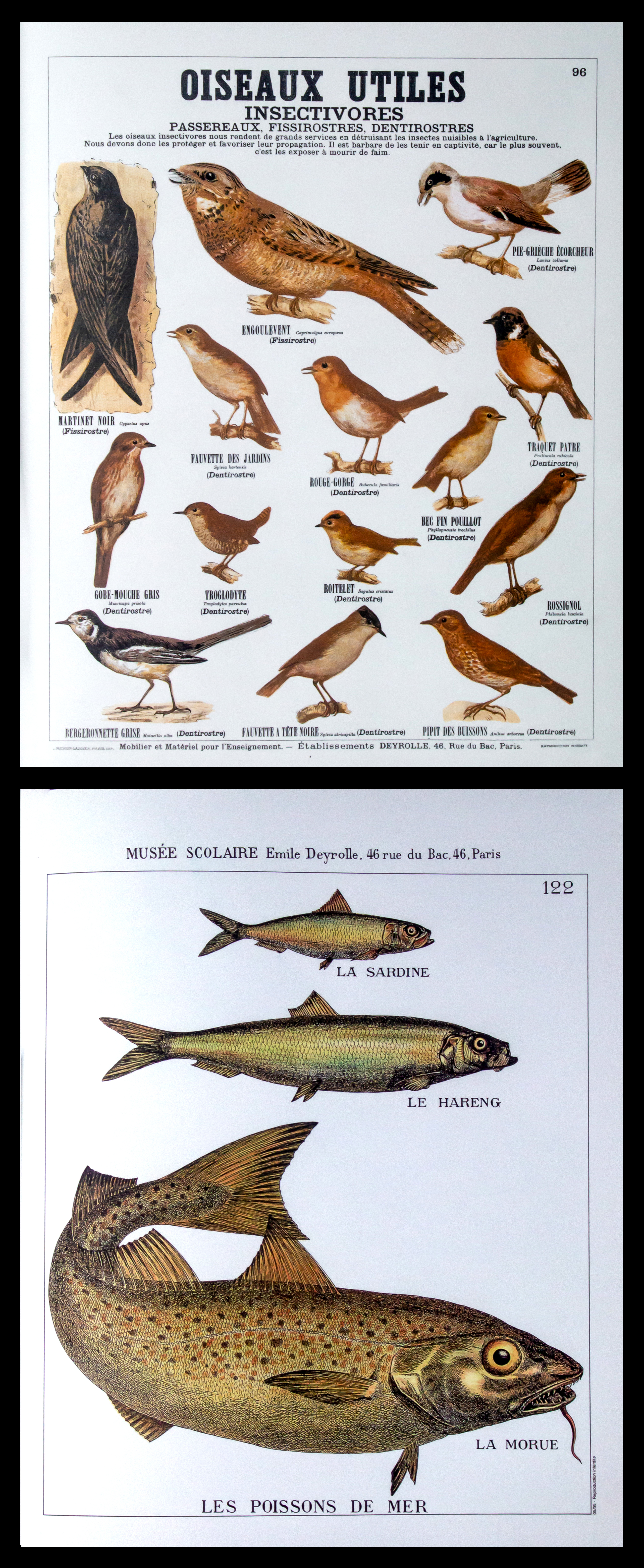 Planches de Deyrolle. Musée scolaire.. L’exactitude du dessin garde également une place importante au
sein des livres naturalistes : les guides d’authentification de la faune
et la flore préfèrent toujours les illustrations aux photographies, car
elles reproduisent plus fidèlement certains aspects et mettent en
évidence les caractéristiques les plus importantes de l’espèce pour une
meilleure compréhension. Elles gagnent ainsi leur place dans les livres
naturalistes en tant qu’illustrations didactiques.
Planches de Deyrolle. Musée scolaire.. L’exactitude du dessin garde également une place importante au
sein des livres naturalistes : les guides d’authentification de la faune
et la flore préfèrent toujours les illustrations aux photographies, car
elles reproduisent plus fidèlement certains aspects et mettent en
évidence les caractéristiques les plus importantes de l’espèce pour une
meilleure compréhension. Elles gagnent ainsi leur place dans les livres
naturalistes en tant qu’illustrations didactiques.
Au début du XXe siècle, grâce au travail des naturalistes, des établissements d’enseignement et des institutions comme Deyrolle, les connaissances scientifiques sur le monde naturel ont commencé à être vulgarisées en Europe. Les représentations graphiques illustrées d’espèces vivantes ont été au cœur de ce mouvement de vulgarisation car les images ont l’avantage de voyager plus vite qu’un texte. Sans elles, le savoir n’aurait pas pu franchir les frontières avec le même succès et, surtout, n’aurait pas pu assumer les responsabilités pédagogiques du nouveau siècle.
III.2. Les livres pour la jeunesse en tant que médiateurs éducatifs : les premier documentaires
En parallèle à la diffusion des planches naturalistes et pédagogiques dans les années 1930, les albums jeunesses commencèrent également à occuper une place importante dans l’enseignement. En France, Paul Faucher est le premier à introduire ce support pédagogique dans la littérature de jeunesse avec la collection pour enfants « Le Père Castor », publiée chez Flammarion en novembre 193115.
Paul Faucher, éditeur chez Flammarion, était un défenseur passionné du mouvement de l’éducation nouvelle. En étroite synergie avec les plus grands pédagogues de l’époque, il a révolutionné la représentation de la littérature jeunesse et il fonda en 1946 l’Atelier du Père Castor, un centre de recherche biblio-pédagogique. Le développement des projets éducatifs était fondé sur la collaboration entre chercheurs, écrivains, illustrateurs et designers graphiques. Un an plus tard, il créa au même endroit une école expérimentale permettant aux graphistes de tester leurs images auprès des élèves de l’école. Paul Faucher l’appelle l’Atelier du Père Castor Présent. Le centre développa des méthodes de pédagogie sensorielles, d’expression corporelles fondées sur la psychologie des enfants.
L’atelier du Père Castor Présent créa les premiers livres documentaires-éducatifs pour enfants en France, dont certains consacrés au vivant.
L’album documentaire La vie cachée des fleurs publiée de 1947 à 1958 en dix volumes avait pour objectif de décrire la vie des plantes.
Jean-Michel Guilcher rédigea les textes de vulgarisation sur la vie des
plantes dans un style incisif, poétique et rythmé. La photographie en
noir et blanc de Robert‑Henri répond également à ces styles. Les plantes
sont montrées en gros plan et sous différentes perspectives, les
compositions de différentes séquences, les comparaisons et
superpositions des images accompagnées d’indications montrent
l’utilisation de la macrophotographie comme un ressource graphique
didactique, somptueuse et étonnante qui a été soigneusement conçue pour
susciter l’admiration du lecteur pour les espèces. 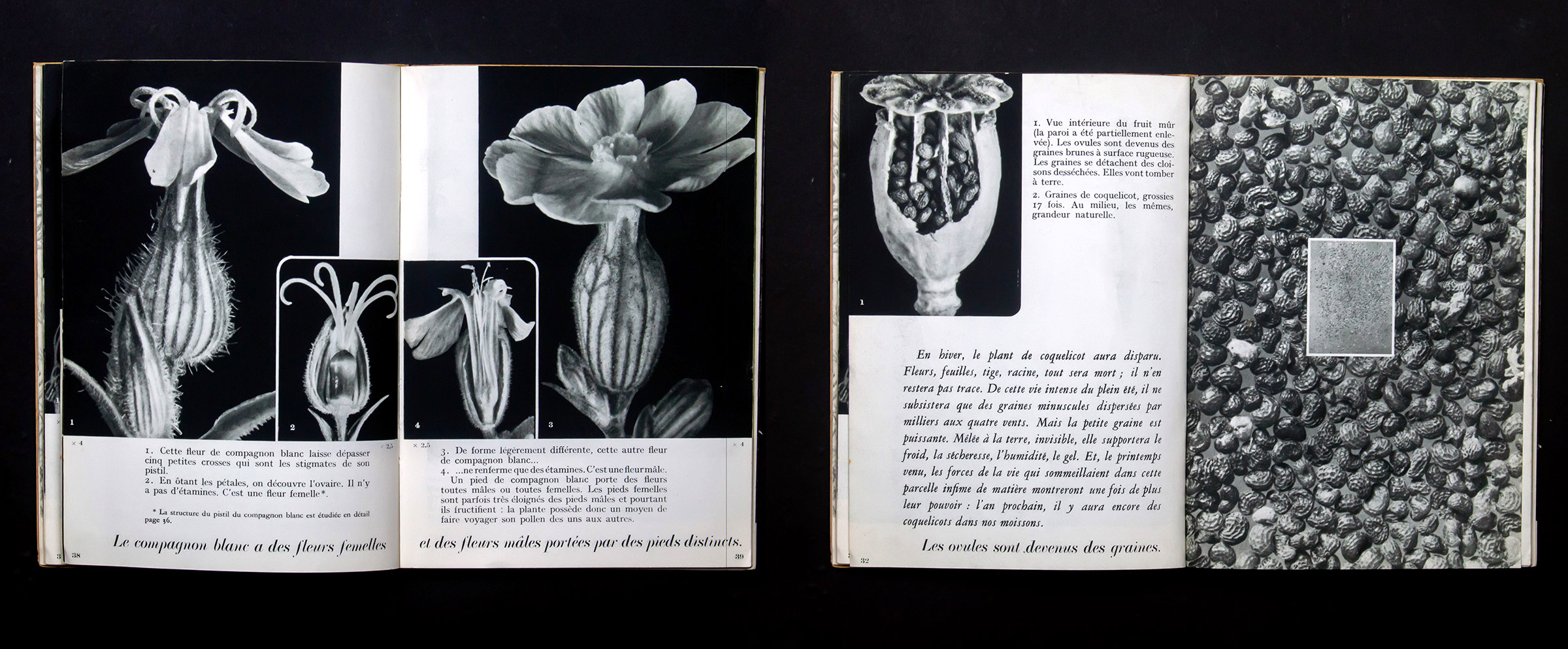
La collection d’albums documentaires ethnologiques Enfants de la Terre
(sept ouvrages publiés entre 1948–1955) a eu pour but de montrer les
modes de vie dans les différents pays du monde aux enfants. L’ouvrage
Apoutsiak le petit flocon de neige (1948), illustré et écrit par
l’ethnologue Paul-Émile Victor est considéré comme un chef-d’œuvre de
vulgarisation scientifique et de poésie16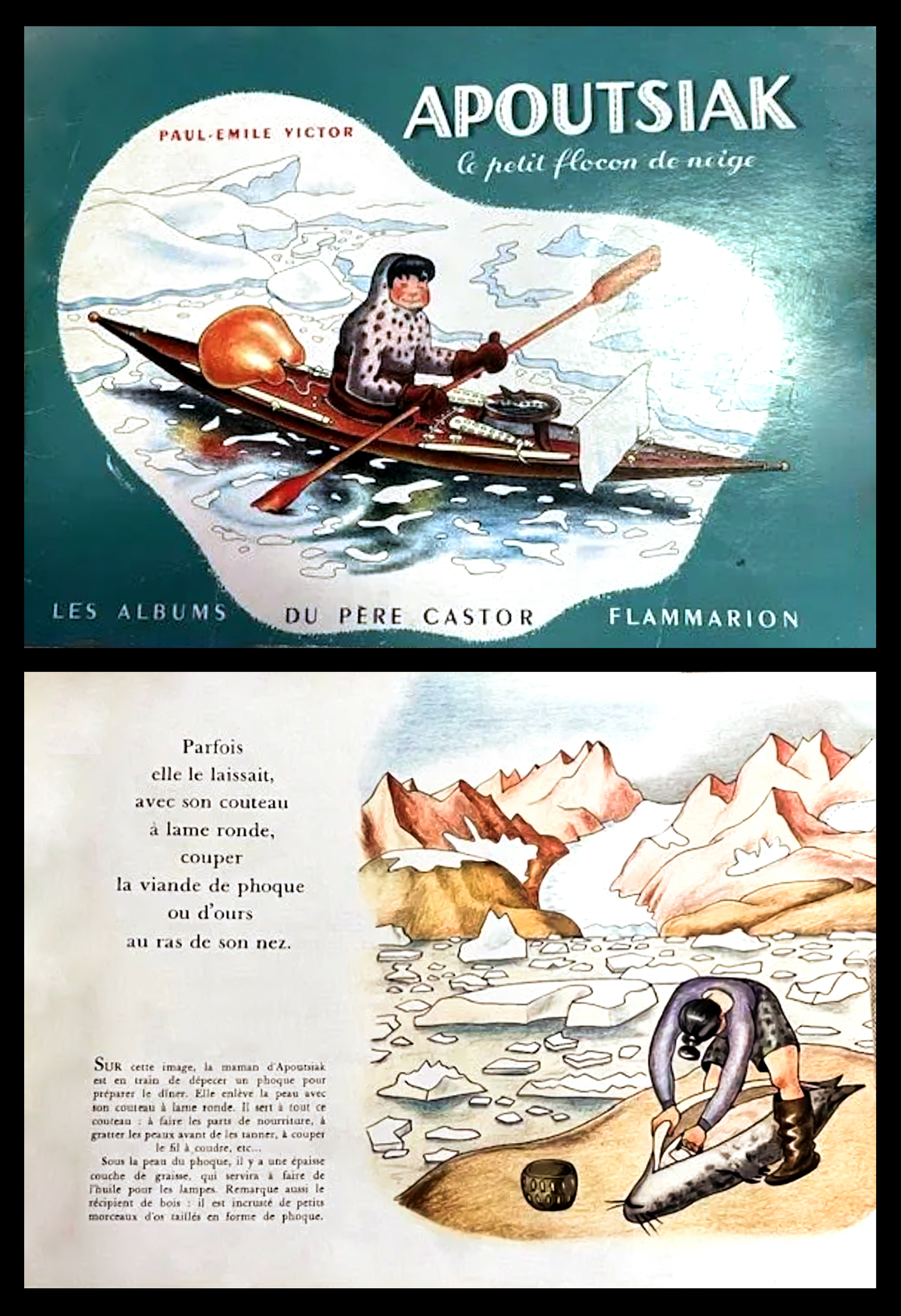 Apoutsiak le petit flocon de neige.. Cette
œuvre marque le début d’une collaboration littéraire entre l’Atelier du
Père Castor et des scientifiques de grande renommée. La collection a été
récompensée en 1962 par le prix européen du livre pour enfants, décerné
par la ville de Caorle, en Italie et par l’université de Padoue17.
Apoutsiak le petit flocon de neige.. Cette
œuvre marque le début d’une collaboration littéraire entre l’Atelier du
Père Castor et des scientifiques de grande renommée. La collection a été
récompensée en 1962 par le prix européen du livre pour enfants, décerné
par la ville de Caorle, en Italie et par l’université de Padoue17.
Dans ces deux collections de livres documentaires, les enfants sont invités à découvrir la réalité scientifique du monde à travers des éléments narratifs et graphiques propice à l’imagination et l’émerveillement. C’était à travers la sensibilité, la connivence et l’identification des personnages, sans recourir à un didactisme moralisateur, que Paul Faucher souhaite éduquer les enfants18. Donc, bien qu’elles ne visent pas explicitement à sensibiliser à l’écologie, elles ont tout de même pour objectif de susciter un sentiment d’altérité chez les lecteurs. En effet, prendre connaissance de l’existence des différents êtres, c’est la base pour les accepter et ultérieurement reconnaître leurs droits.
III.3. Evolution de la représentation graphique du vivant
À partir des années 1950, la représentation graphique du monde vivant a évolué et les livres pour enfants sont devenus un élément moteur de l’éducation. L’illustration américaine du mouvement Mid-Century Modern a exploré de nouvelles techniques graphiques et styles visuels pour représenter le vivant, introduisant des formes organiques épurées et rationalisées, dépouillées de tout ornement inutile.
Charley Harper est un artiste états-unien, connu pour ses illustrations
sur la faune et la flore. Son œuvre graphique figure parmi les premiers
livres sur le vivant pour la jeunesse, à mi-chemin entre les
encyclopédies19 et les documentaires avec une intention
didactique. Parmi elles, les illustrations dans The Giant Golden Book
of Biology, de Gerald & Rose Wyler, Golden Press (1961), The
Animal Kingdom, Golden Press de George S. Fisher (1968), Birds and
Words (également auteur), the Frame House Gallery (1974)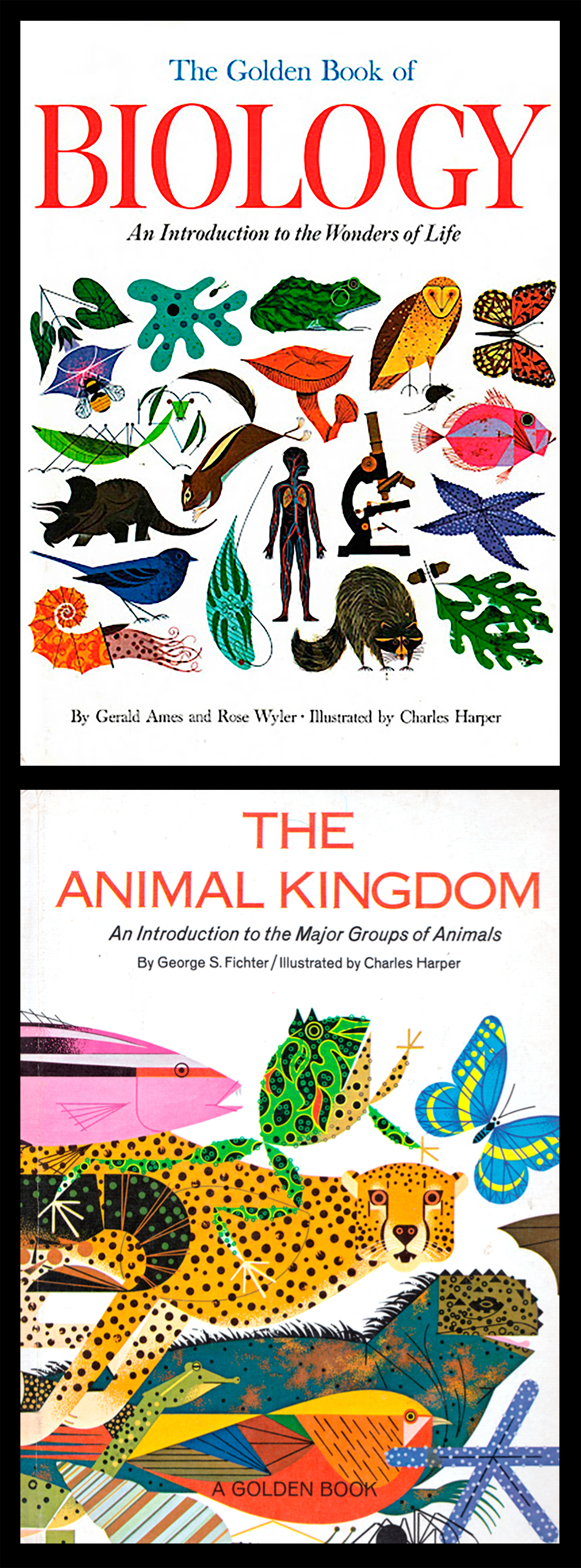 Les premières de couverture The Giant Golden Book of Biology, deuxième édition, 1968 et The Animal Kingdom, 1968..
Les premières de couverture The Giant Golden Book of Biology, deuxième édition, 1968 et The Animal Kingdom, 1968..
Son style est qualifié de « réalisme minimaliste » car il essayait de saisir l’essence de son sujet avec le moins d’éléments possibles tout en restant fidèle à la réalité des espèces ; il omettait des détails pour aller à l’essentiel. L’artiste cherchait à représenter graphiquement la nature dans le respect de la rigueur scientifique, d’une manière à la fois didactique, distinctive et instructive.
Harper est célèbre pour son originalité artistique et sa créativité. Sa
représentation graphique, minimaliste, stylisée, épurée et vibrante de
couleurs cherche aussi à donner aux illustrations une touche d’humour et
de fantaisie, qui incite le lecteur à imaginer. Lorsqu’il peignait des
oiseaux, « il disait qu’il ne comptait pas le nombre de plumes mais
seulement le nombre d’ailes20 ».
Charley Harper, parallèlement à son travail éditorial a également réalisé d’autres œuvres graphiques, telles que des affiches environnementales pour des organisations telles que l’Audobon Society, le Cape May Bird Observatory, le Cincinnati Nature Center, le Hamilton County Park District, le US National Park Service et les zoos de Cincinnati, Louisville et San Diego. Dans ce contexte, l’artiste s’est fait connaître pour son activisme écologique. Sa façon de simplifier les concepts complexes du monde naturel, en ajoutant une touche d’humour à ses illustrations visait à encourager une sensibilisation à l’environnement.
« Plus je m’implique dans ce domaine, plus je suis troublé par des questions sans réponse concernant notre exploitation des plantes et des animaux et notre supposition désinvolte que le monde naturel n’est là que pour servir l’homme. Je me demande comment l’homme, le prédateur doté d’une conscience, peut vivre sans porter le fardeau de la culpabilité de son existence aux dépens d’autres créatures21 ».
En 1970, le thème de l’écologie devient davantage à la mode et il s’intègre dans les livres documentaires pour la jeunesse. Nous voyons apparaître des contenus qui mettent en évidence les problèmes environnementaux, qualifiés par la littérature d’éco‑thèmes. Dans ce contexte d’évolution, la notion de lecteur engagé voit le jour, rendant le thème de l’écologie plus militant jusqu’à devenir parfois le sujet principal d’un ouvrage.
IV. Eco-graphies dans le documentaire jeunesse
IV.1. Les différents registres de sensibilisation à l’environment
Dans les livres documentaires jeunesse consacrés au vivant, la sensibilisation à l’environnement s’inscrit dans différents types de registres contenant une narration textuelle et graphique. Cette association texte‑image est connue en littérature sous le nom d’éco‑graphies.
Afin de mieux comprendre comment la sensibilisation à l’environnement s’inscrit dans des différents registre tant au Chili qu’en France, cette analyse se concentrera sur trois formes éco‑graphiques : la forme didactique, la forme poétique et la forme mixte.
Dans la forme didactique, la sensibilisation fait appel principalement à la rationalité, liée à la connaissance. Le lecteur est informé de manière factuelle et méthodologique et il peut même être invité directement à prendre des actions concrètes d’écologie pour préserver le vivant. Dans la narration, le texte et l’image se correspondent. Le représentation graphique privilégie la clarté et la compréhension.
Dans sa forme poétique, la sensibilisation fait appel principalement aux sentiments, souvent liées à l’histoire culturelle qui entourent les espèces du monde vivant22. Le lecteur peut être aussi invité à prendre des actions concrètes d’écologie pour préserver le vivant, mais d’une manière indirecte. L’auteur informe le lecteur en donnant en même temps un espace important à la poésie. Dans la narration, le texte et l’image se correspondent. La représentation graphique est souvent épurée et parfois moins réaliste, afin de laisser une plus grande place aux émotions.
Dans sa forme mixte, la sensibilisation fait appel à la rationalité et aux sentiments de manière équitable et s’inscrit à la fois dans les registres éco‑graphiques didactique et poétique. Ce métissage de registre peut se faire à différents niveaux au sein d’un livre : sur une même page ou dans des parties séparées du livre. Par exemple, le registre didactique pourrait utiliser parfois du texte, parfois des images, ou quelquefois les deux jusqu’à mi-parcours du livre, et vice-versa pour le registre poétique.
Les différents registres de sensibilisation à l’environnement abordent à leur tour différents thèmes écologiques, liés principalement aux problèmes environnementaux, les éco‑thèmes. Les différents livres documentaires analysés dans ce mémoire peuvent aborder un ou plusieurs de ces éco‑thèmes en même temps.
Conjointement aux évolutions de la représentation graphique dans le domaine de l’album documentaire jeunesse, la notion d’éco‑conception d’un livre est devenue un élément important à prendre en compte. Les éditeurs s’engagent à minimiser l’impact environnemental des phases liées à la création d’un livre tels que : la pollution engendrée par la fabrication, la durée de vie du livre, le type de papier utilisé, la relocalisation du lieu de production, l’extension numérique d’une œuvre, le nombre d’exemplaires imprimés par année. Ces préoccupations permettent à un ouvrage de faire sens non seulement par son contenu, mais aussi par sa forme. Cependant, ces démarches environnementales sont souvent difficiles à mettre en œuvre car elles ne doivent pas compromettre la rentabilité du livre alors que cette industrie connaît actuellement une situation économique incertaine (Cf. entretiens VII.2. Question 6).
V. Corpus de livres : la sensibilisation à l’environnement auteur du vivant
V.1. Registre didactique
V1.1. La co-création : diviser pour mieux regarder
Le livre documentaire de Christian Staebler, Vision d’animaux pour mieux comprendre le monde a été publié par les éditions Biscoto en 2024. L’auteur est graphiste, illustrateur, critique de bande dessinée, scénariste et a écrit et illustré plusieurs livres éducatifs pendant sa carrière.
Le livre a été créé à partir des rubriques sur les animaux que l’auteur a publié mensuellement dans le journal Biscoto, par les Editions Biscotto (Cf. entretiens VII.1. Question 1). Ce livre documentaire explique d’une manière didactique et attractive, les bases essentielles pour mieux comprendre la vie sur Terre, à travers l’étude des animaux. Les jeunes lecteurs sont invités à éveiller leur curiosité et à agir pour la planète à travers une quinzaine de thèmes liés à la protection de l’environnement.
Le design graphique et la mise en page sont le travail de Catherine
Staebler. Pour les illustrations des animaux, il s’agit de la
collaboration d’une vingtaine d’illustrateurs contemporains différents
23 et une illustration du naturaliste Ernst Haeckel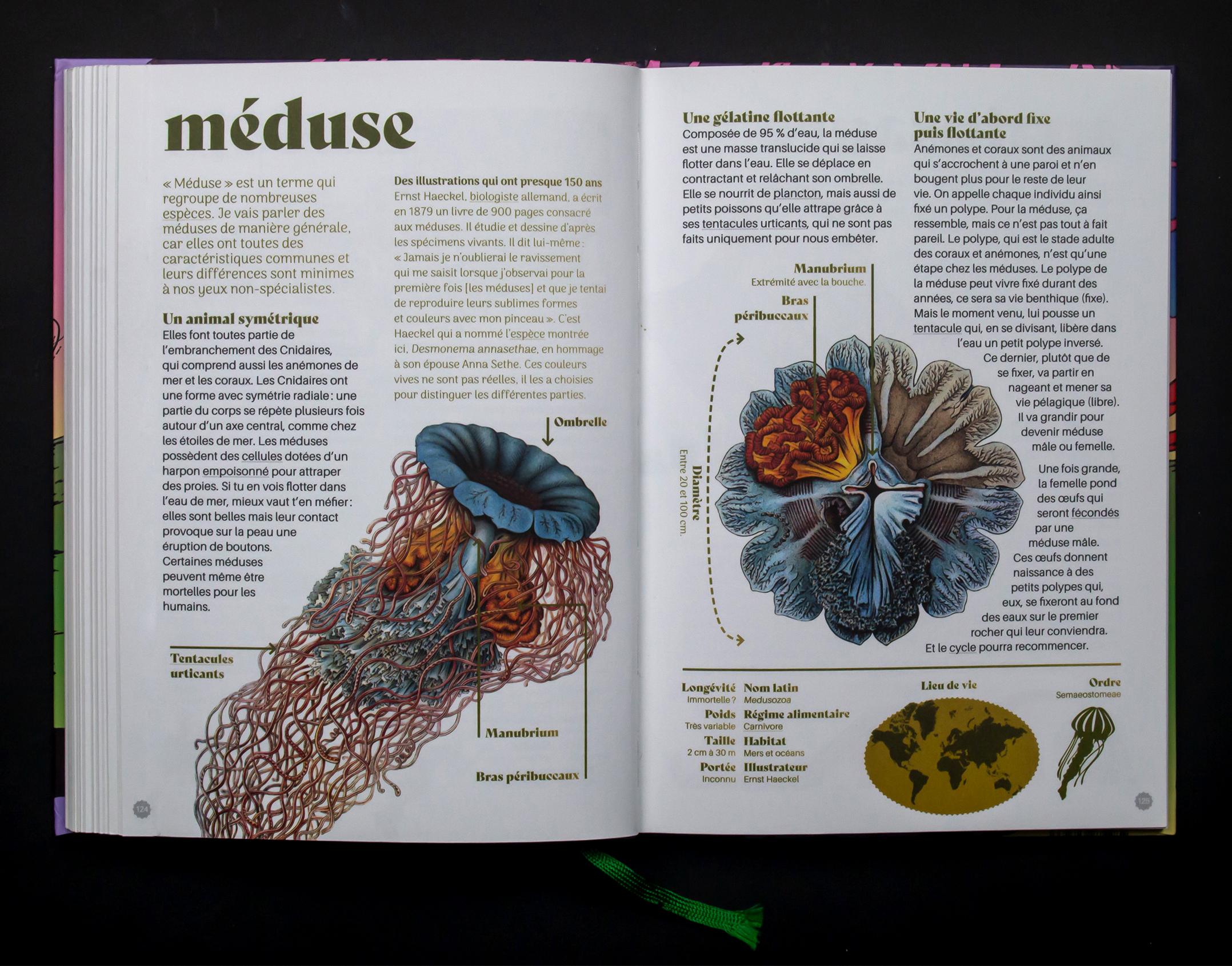 Illustration Ernst Haeckel. Vision d’animaux.. A chaque début de chapitre l’auteur réalise lui-même les illustrations.
Toutes les données scientifiques contenues dans l’ouvrage ont été
contrôlées par Anne-Cécile Dagaeff, docteur en écologie comportementale.
Illustration Ernst Haeckel. Vision d’animaux.. A chaque début de chapitre l’auteur réalise lui-même les illustrations.
Toutes les données scientifiques contenues dans l’ouvrage ont été
contrôlées par Anne-Cécile Dagaeff, docteur en écologie comportementale.
À propos de la forme du livre, celui-ci compte cent-soixante-et-onze
pages, reliées dos cousu collé (otabind). Le format est rectangulaire, de petite taille, la couverture cartonnée est recouverte d’un papier
laminé mat, sur laquelle est imprimée une illustration représentant des
animaux. La première de couverture est une illustration de Corentin
Garrido, montrant un écosystème rempli d’animaux dans un style
caricatural et surréel. Le trait de contour épais des sujets accentue la
vivacité des couleurs pastels en dégradé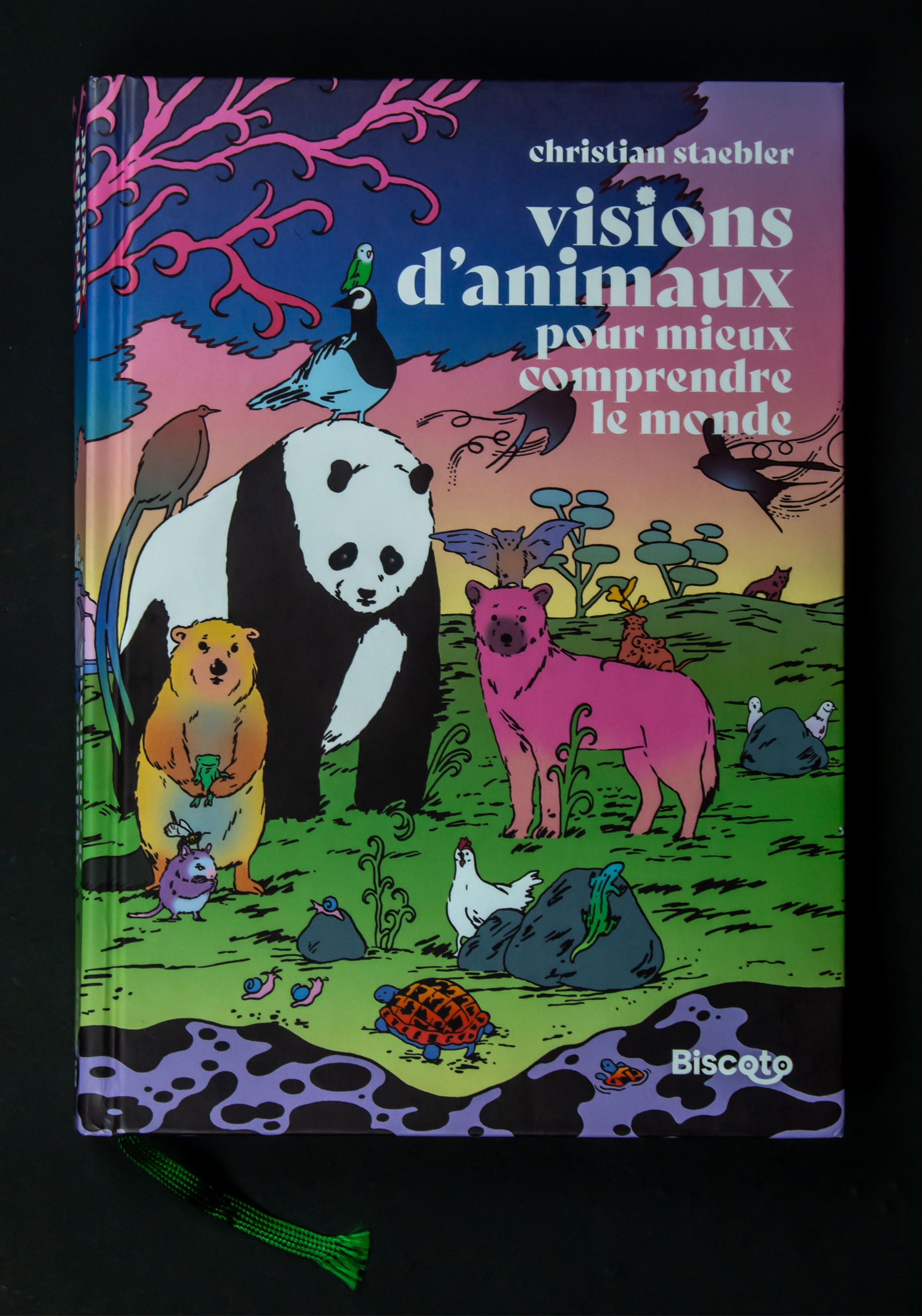 Première de couverture. Vision d’animaux..
Première de couverture. Vision d’animaux..
Dans la mise en page du corpus, nous pouvons identifier principalement deux types de doubles pages, la première concernant l’annonce des chapitres et la seconde dédiée à la description des animaux.
La première catégorie de double page expose les thèmes des chapitres. La
mise en page est composée de deux colonnes centrales de texte en fer à
gauche. Chaque chapitre s’ouvre sur une palette chromatique différente, choisie en fonction du thème abordé. Les couleurs dégradées et nuancées
des titres, des colonnes de texte et des illustrations, unifient la
composition visuelle de ces pages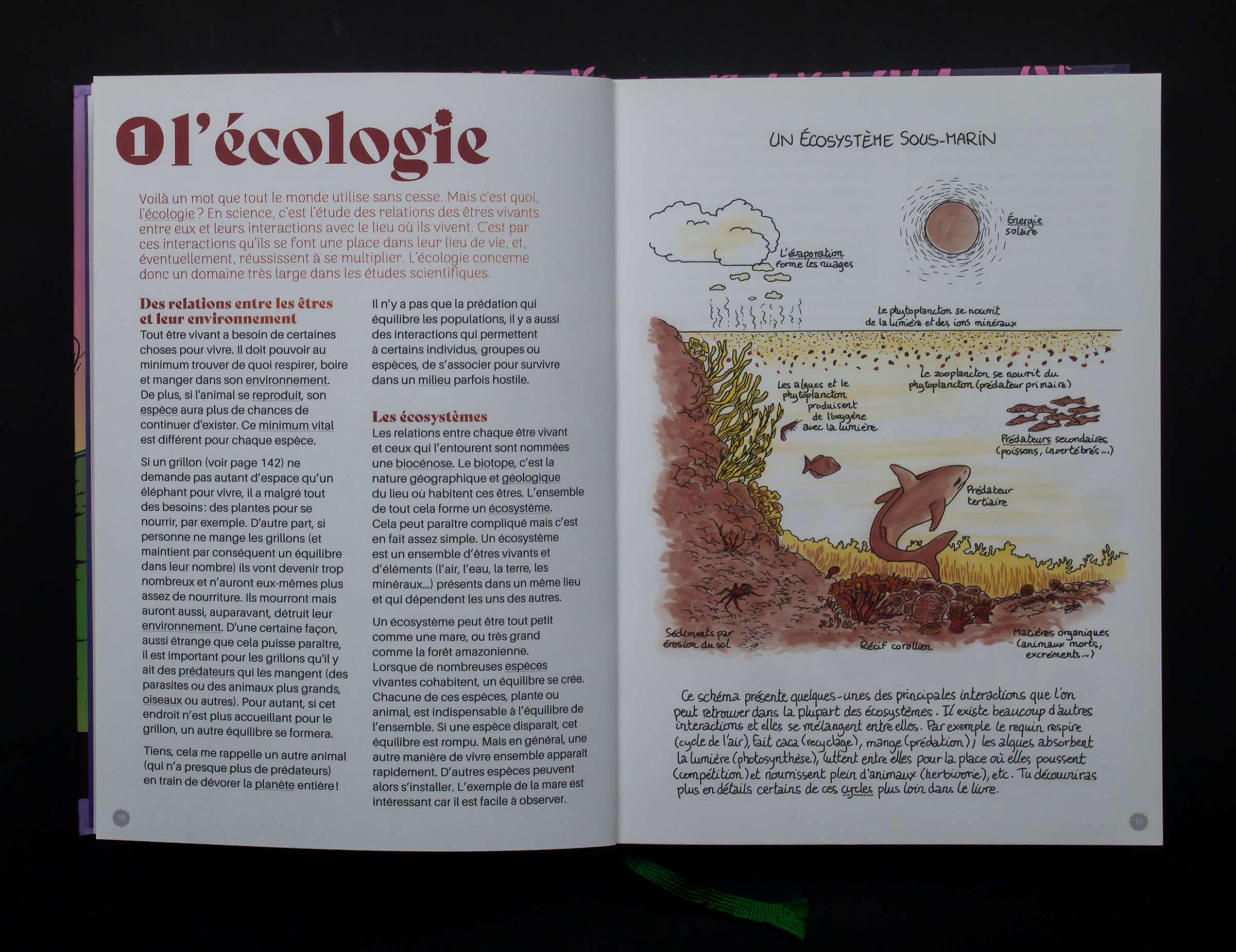 Mise en page. Vision d’animaux..
Mise en page. Vision d’animaux..
Le titre de chapitre utilise la police de caractère Bely display dans un corps typographique qui s’étend sur la largeur des deux colonnes, dans la même couleur que celle attribuée au chapitre. Pour l’accroche, la police Arima Madurai est utilisée dans la même couleur que le titre du chapitre, mais en dégradé. Les sous-titres utilisent la même police de caractères du titre, également en dégradé, mais dans un corps typographique plus petit. Le texte principal utilise une typographie linéale, sans empattement, en couleur noire.
Ces pages thématiques sont illustrées par l’auteur, la technique utilisée est le dessin à main levée et l’aquarelle. La palette de couleurs joue sur les mêmes nuances que le dégradé des textes. Les illustrations s’inscrivent dans un registre didactique, avec de petits textes explicatifs écrits à la main, faisant écho au style graphique propre de la bande dessinée.
Le deuxième type de double page consacré à la description des animaux
est composé de la même manière que les pages thématiques, tant pour les
titres, colonnes de texte et palette de couleur. Dans cette partie, une
petite carte infographique est incorporée avec des informations
scientifiques et géographiques sur les espèces, en bas de la page de
droite, qui synthétise et unifie visuellement la double page.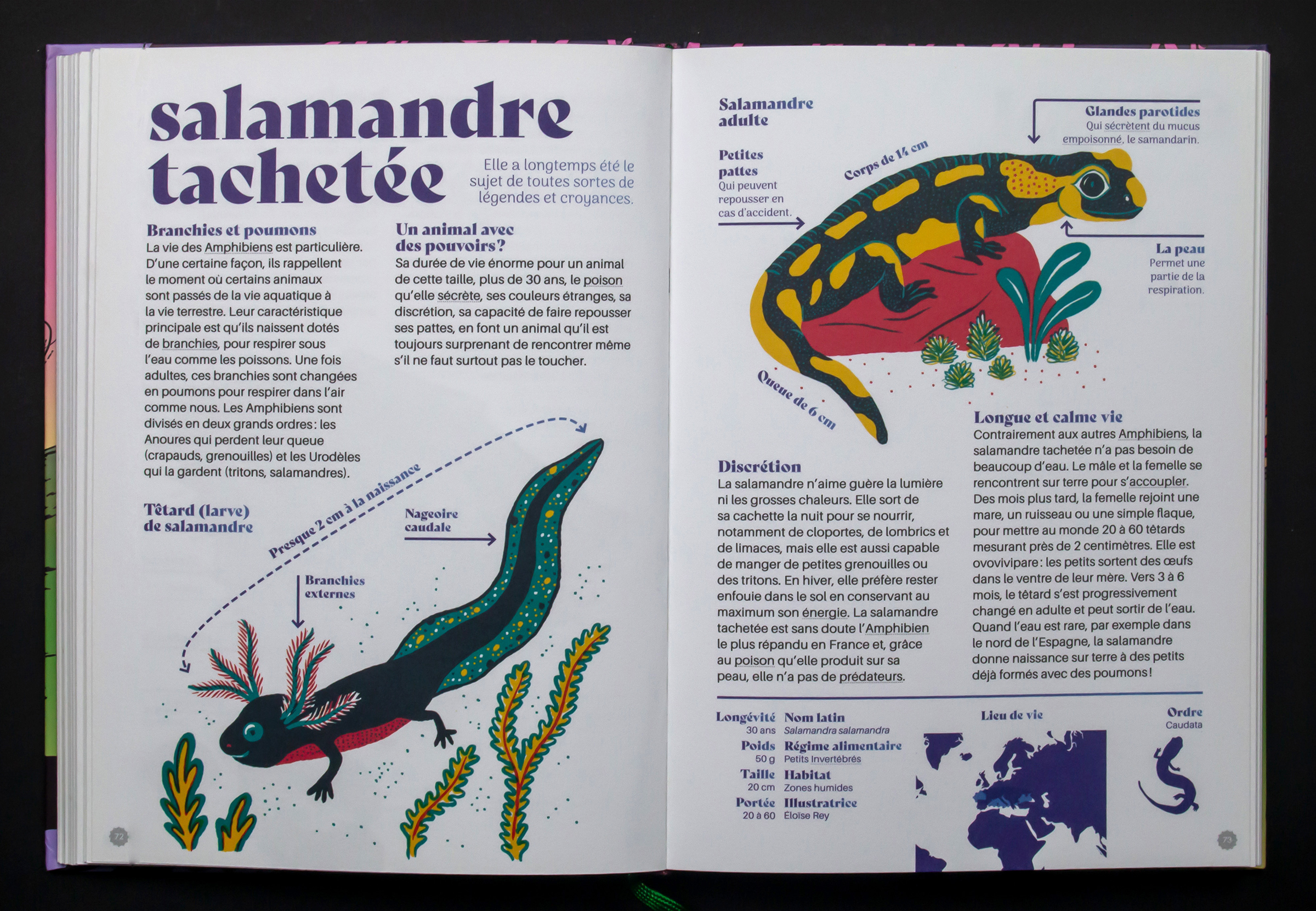
Chaque double page est illustrée par des artistes différents. Les styles
visuels, les techniques d’illustration et les palettes de couleurs
diffèrent, certains sont plus réalistes et d’autres plus caricaturaux
mais ils tous sont didactiques24. La volonté de l’auteur est de
montrer la force expressive du dessin pour représenter le réel à travers
un regard sensible et unique de chaque illustrateur (Cf. entretiens VII.1.
Question 7). Dans ce livre, l’illustration didactique prend une place aussi importante que celle des textes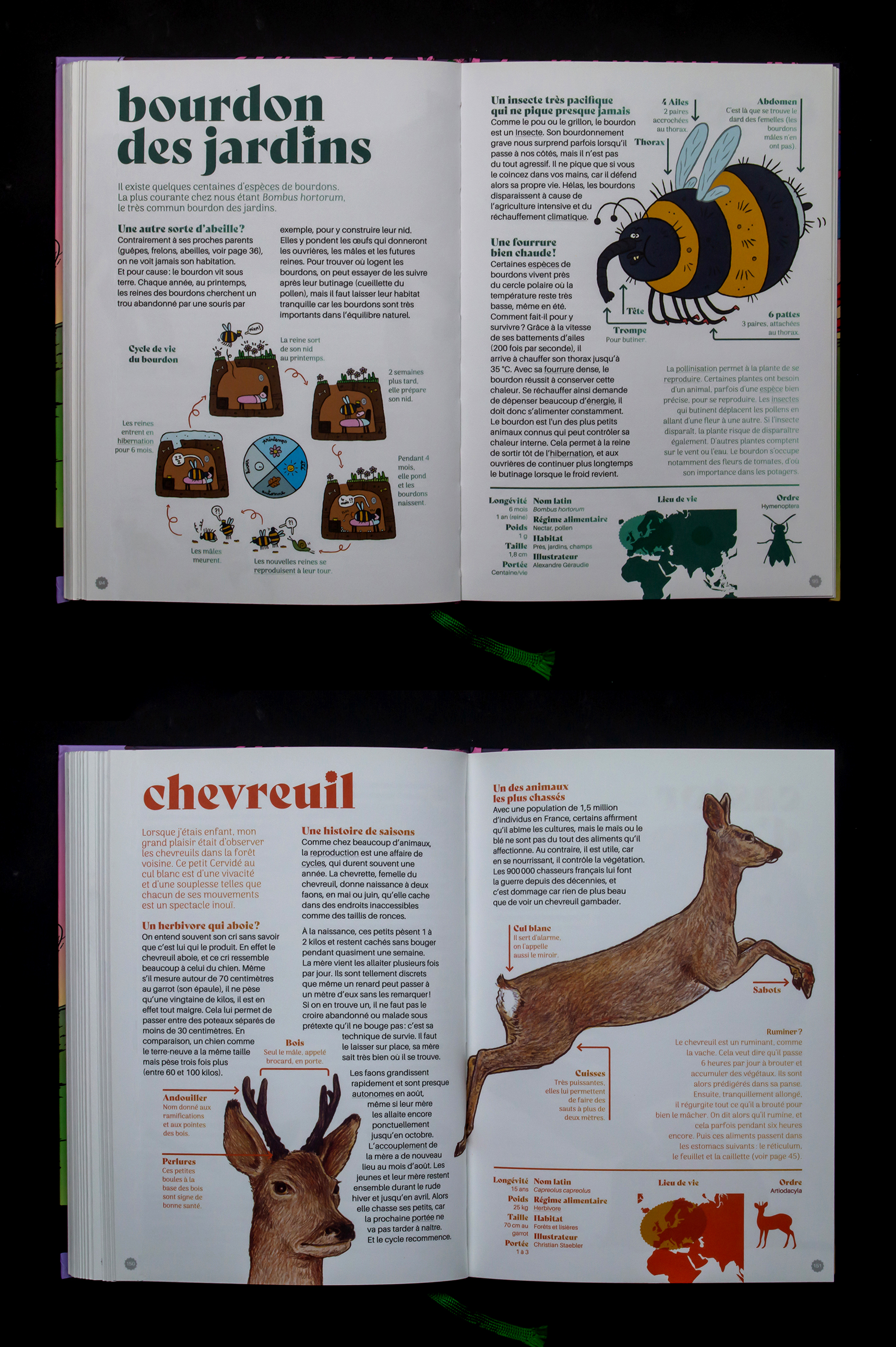 Mise en page. Vision d’animaux..
Mise en page. Vision d’animaux..
Un regard original du vivant est donné à travers une quinzaine
d’éco‑thèmes présentés dans le livre dont : les liens du monde vivant, l’intelligence chez les animaux, la domestication des animaux, la
pression humaine sur le monde animal et la diversité des écosystèmes.
Dans cette partie au ton engagé, les lecteurs sont invités à prendre
conscience de la nécessité de protéger l’environnement et in fine éviter
de se nuire. Il explique également le lien entre la politique et
l’écologie en illustrant certains logos d’associations environnementales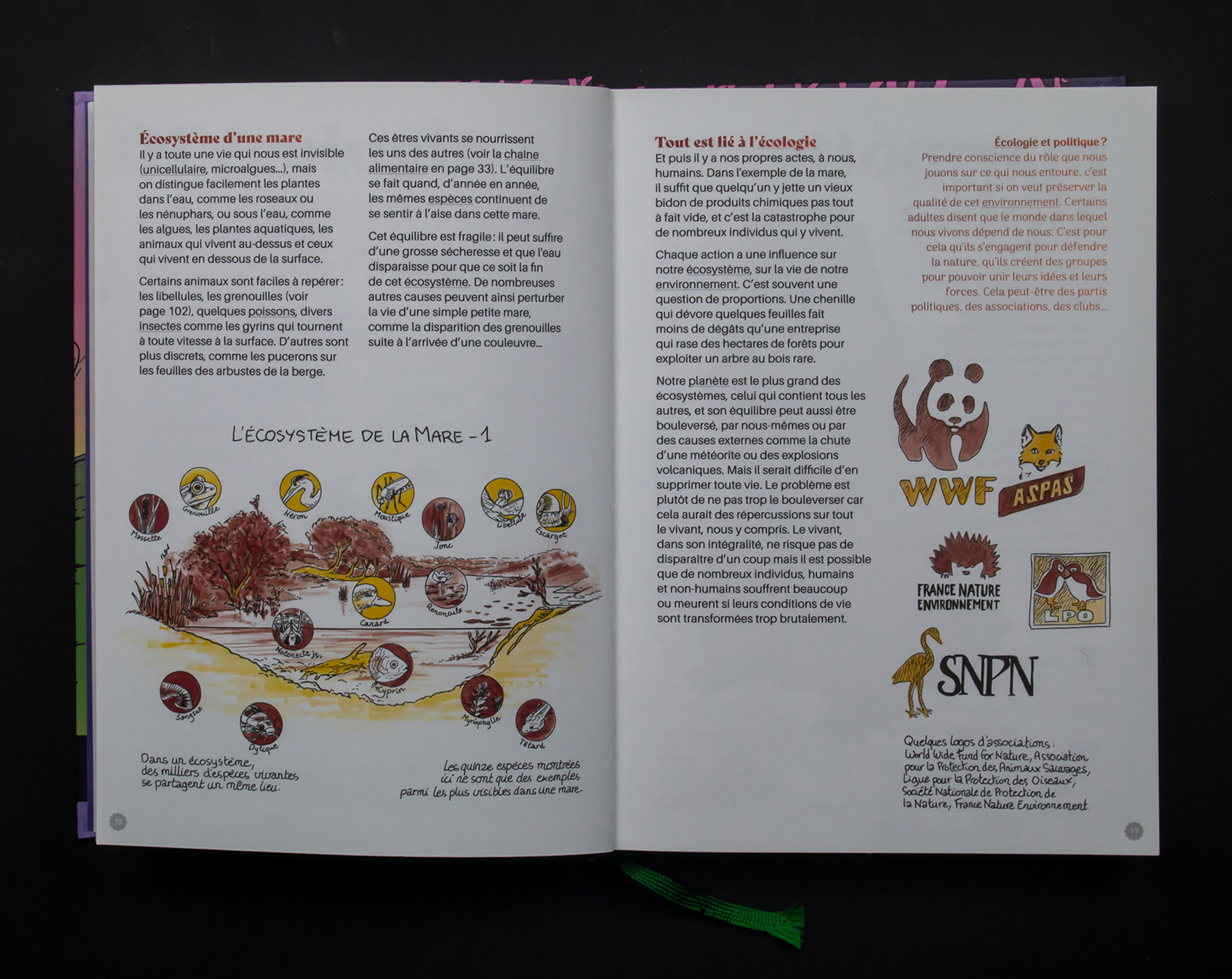 Mise en page. Vision d’animaux..
Mise en page. Vision d’animaux..
En somme, le registre éco‑graphique utilisé dans ce livre est majoritairement didactique. La représentation graphique vise à instruire et à expliquer les faits de manière claire, amusante, agréable et sensible. Les textes cherchent à éduquer les jeunes lecteurs en faisant appel à la raison.
V.1.2 Révéler l’essentiel par les détails
Le livre, Reino Fungi25, publié en 2024, par la maison
d’édition chilienne Amanuta, est un ouvrage d’Octavia Mosciatti, journaliste et de Loreto Salinas, illustratrice et autrice de plusieurs
livres documentaires jeunesse concernant le vivant chiliens et
latino-américains.26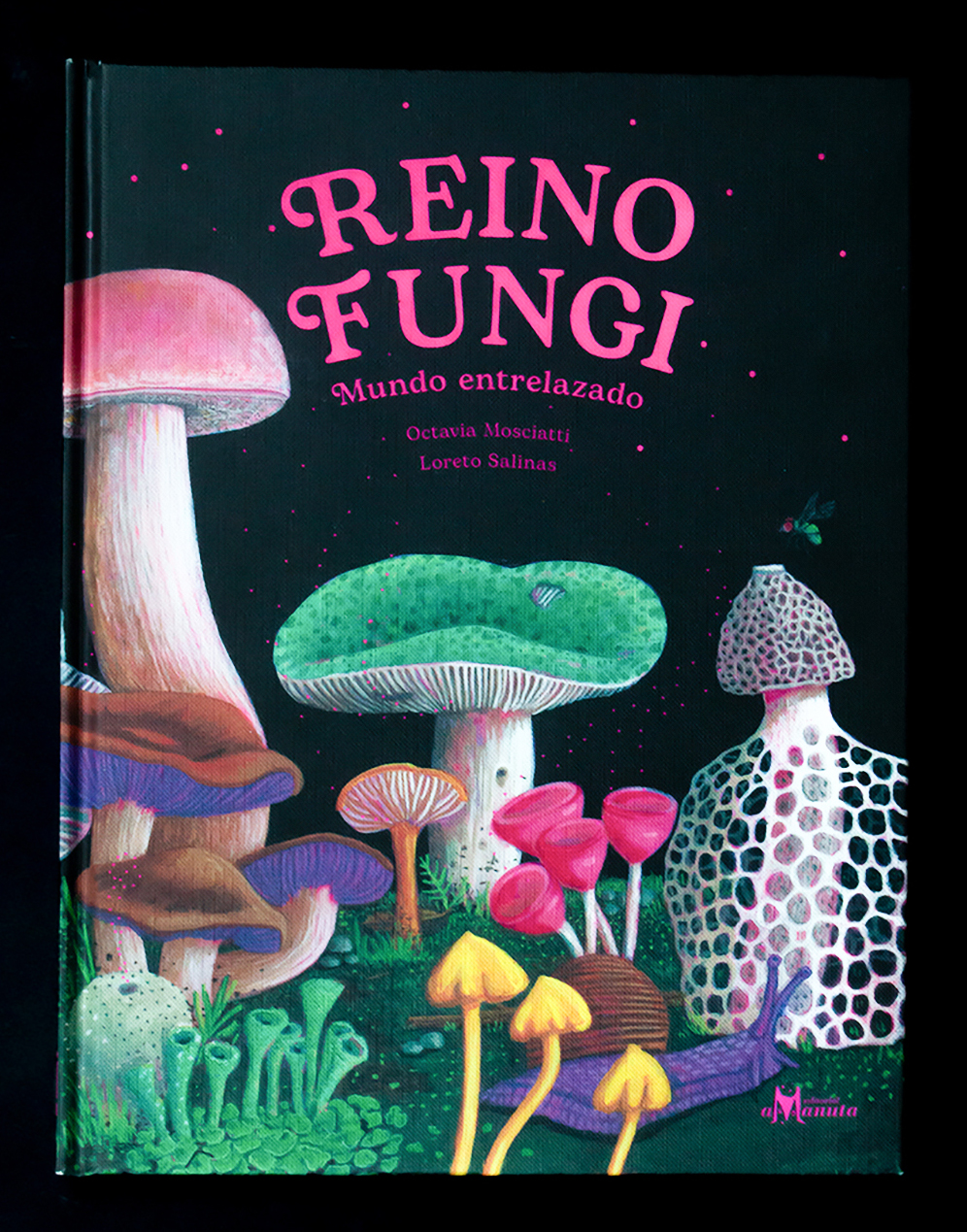 Première de couverture. Reino Fungi.
Première de couverture. Reino Fungi.
Ce livre explore le règne des champignons, expliquant ce qu’ils sont, comment ils sont classés, leurs fonctions écologiques fondamentales au
sein de l’écosystème et leur impact sur la vie humaine, depuis leurs
utilisations ancestrales jusqu’au rôle qu’ils jouent dans notre vie
actuelle (alimentation, médecine, agriculture). 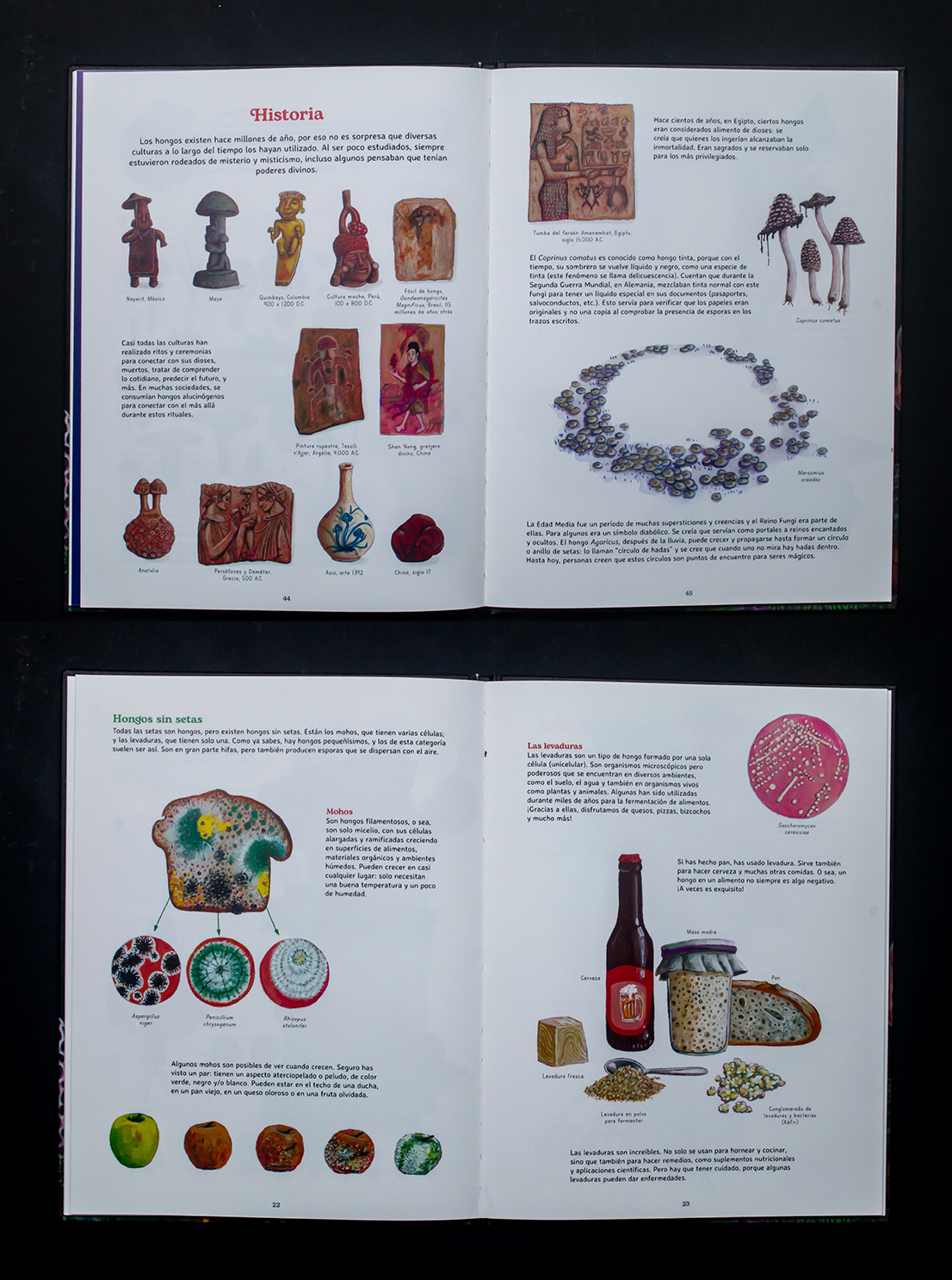 Mise en page. Reino Fungi. Le livre se termine en donnant quelques pistes sur la manière dont nous pourrions les utiliser pour améliorer le monde.
Mise en page. Reino Fungi. Le livre se termine en donnant quelques pistes sur la manière dont nous pourrions les utiliser pour améliorer le monde.
La conception graphique et la mise en page du livre ont été réalisées par Philippe Petitpas. En termes de mise en forme, l’ouvrage se compose de cinquante-cinq pages avec une reliure dos carré cousu. Le format est rectangulaire d’une largeur considérable (presque carré), de taille moyenne-grande, la couverture est cartonnée, enduite de toile (texturée), sur une impression d’une illustration de champignons.
La représentation graphique de l’artiste se caractérise par l’utilisation de la technique de la gouache et dans style précis et détaillé et aux couleurs vibrantes, d’une grande expressivité. Les dessins cherchent à transmettre l’essence des espèces vivantes.
Sur les pages de garde, nous pouvons voir à gauche une illustration de
feuilles d’arbres mortes, recouvrant le sol des nuances automnales et à
droite, une illustration (sur fond de papier) d’une feuille en cours de
décomposition sur laquelle poussent des champignons.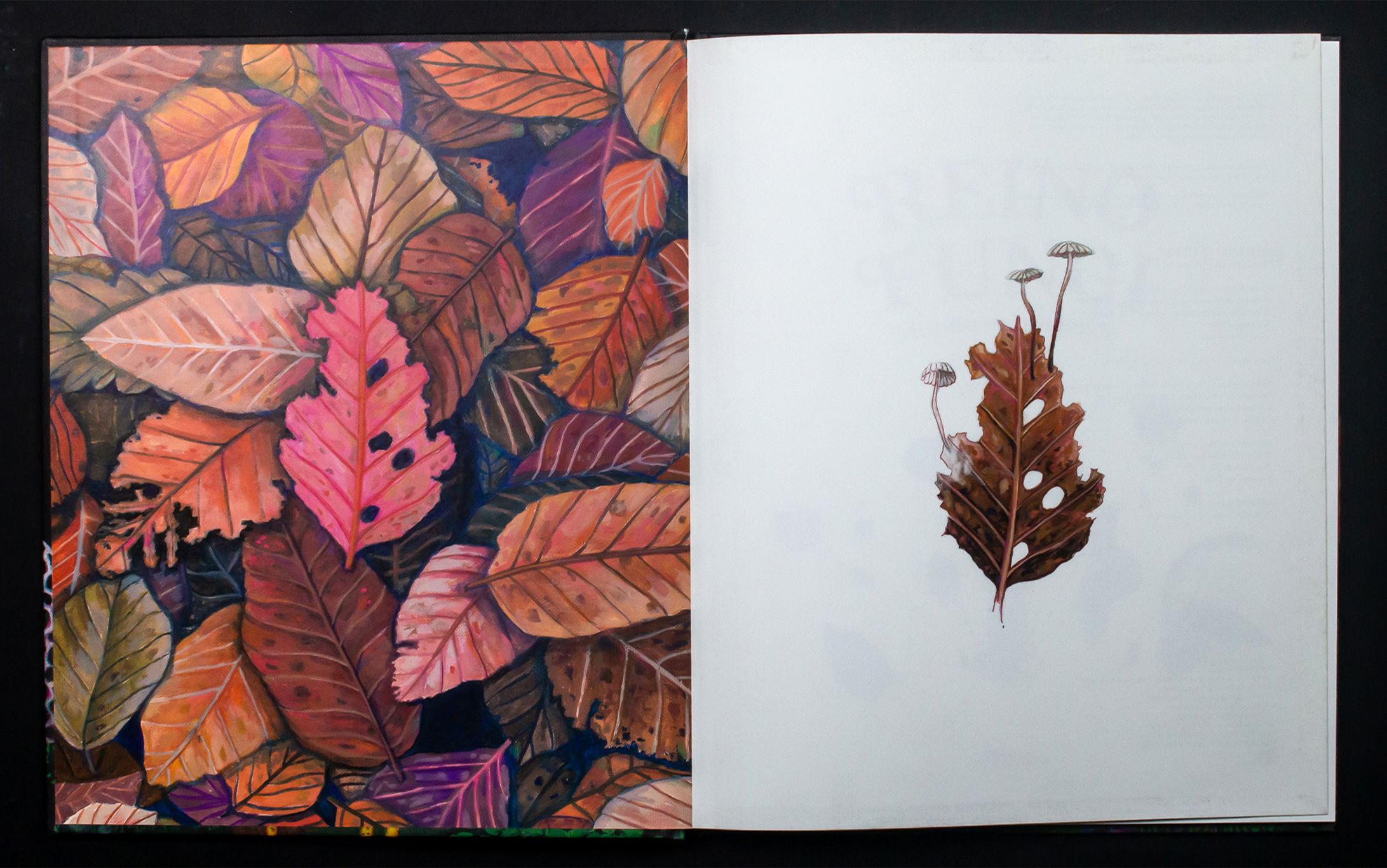
Ce livre est divisé en quinze parties, à chaque fois présentée par un titre, la police de caractères utilisée est Bogart de zetafonts oldstyle fat faces (2020)27.
Le titre utilise un corps de taille moyenne de couleur rouge puis est suivi d’un accroche centrée dans une colonne qui utilise toute la largeur de la page, la police de caractères utilisée est sans empattement, de caractère informel, dans cette partie elle utilise un corps de grande taille.
La logique de la composition visuelle des doubles pages suit une certaine flexibilité. Les titres des parties donnent lieu à d’autres sous-titres, de même typographie (Bogart), dans un corps vert plus petit et ceux-ci donnent lieu à leur tour à d’autres sous-niveau de sous-titre (Bogart) mais du même couleur rouge que le titre principal et dans un corps encore plus petit. La largeur des colonnes varie, la typographie des textes explicatifs est toujours la même que celle de l’accroche et le texte explicatif est généralement présenté en fer à gauche, parfois centré.
Les illustrations relèvent du registre didactique et visent à décrire
fidèlement les informations descriptives du texte, avec l’aide de
flèches pour indiquer certaines sections des dessins. 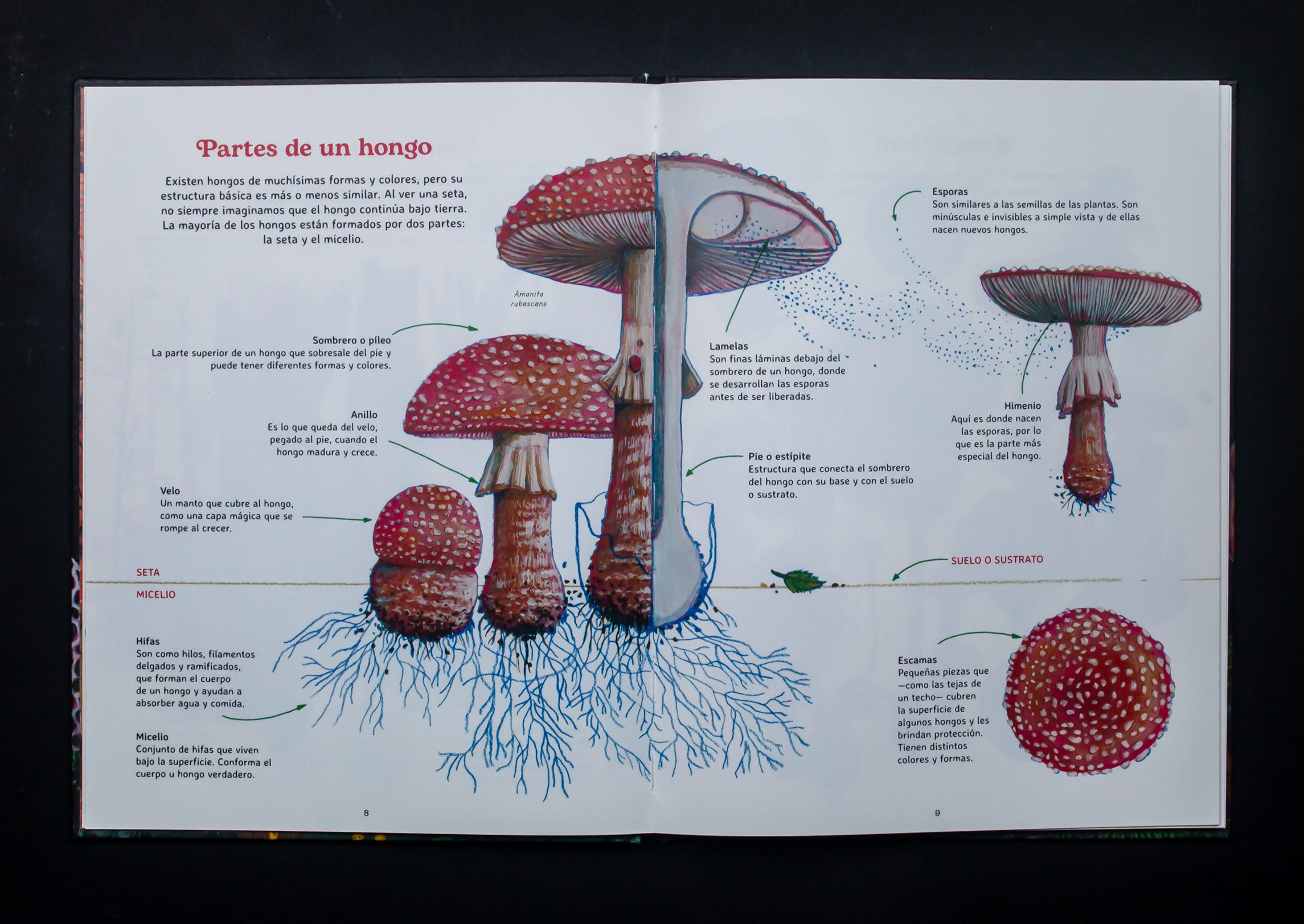 Mise en page. Reino Fungi.
L’illustration attire visuellement l’attention dans la page, les détails
sont exhaustifs, les couleurs vibrantes et les perspectives sont bien
marquées et nettes. Des petits schémas abstraits en forme de mycélium28 organisent visuellement l’information (les sous-niveaux et les explications). Dans la mise en page du livre, l’auteur semble
vouloir reprendre de manière imagée la structure organique du mycélium
des champignons.
Mise en page. Reino Fungi.
L’illustration attire visuellement l’attention dans la page, les détails
sont exhaustifs, les couleurs vibrantes et les perspectives sont bien
marquées et nettes. Des petits schémas abstraits en forme de mycélium28 organisent visuellement l’information (les sous-niveaux et les explications). Dans la mise en page du livre, l’auteur semble
vouloir reprendre de manière imagée la structure organique du mycélium
des champignons.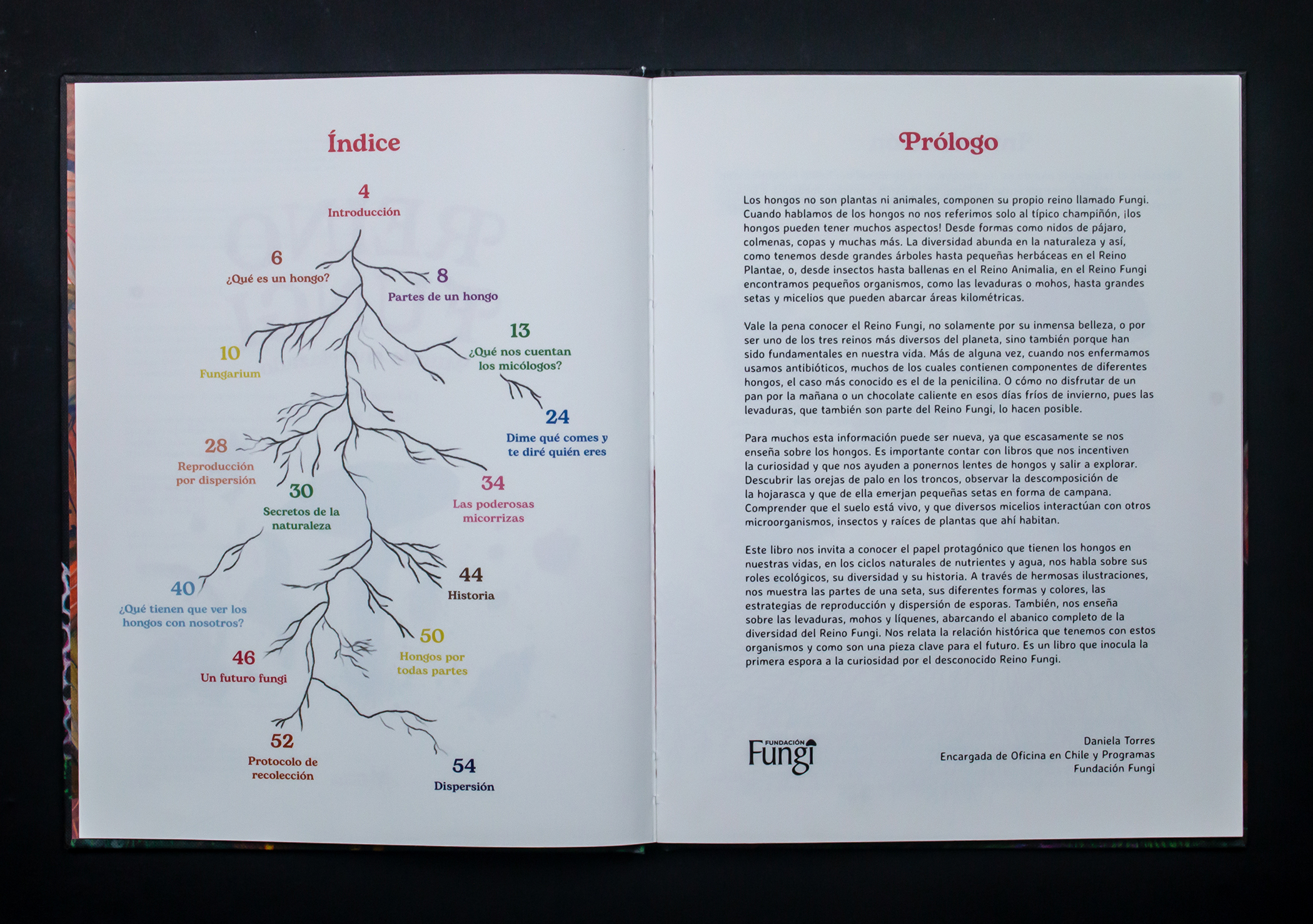 Mise en page. Reino Fungi.
Mise en page. Reino Fungi.
Dans les pages de garde finales, la page de gauche contient une
illustration de trois champignons amanites29 (sur fond de
papier) et un escargot sur le chapeau de la plus grande. Sur la page de
droite, nous trouvons une illustration du même terrain recouvert de feuilles
d’automne, avec les trois amanites de la page de gauche, mais il manque
un morceau au chapeau du plus grand champignon. Dans cette séquence
d’illustrations, l’auteur met en lumière le cycle de la vie et montre
que la mort dans la nature n’est pas une fin30.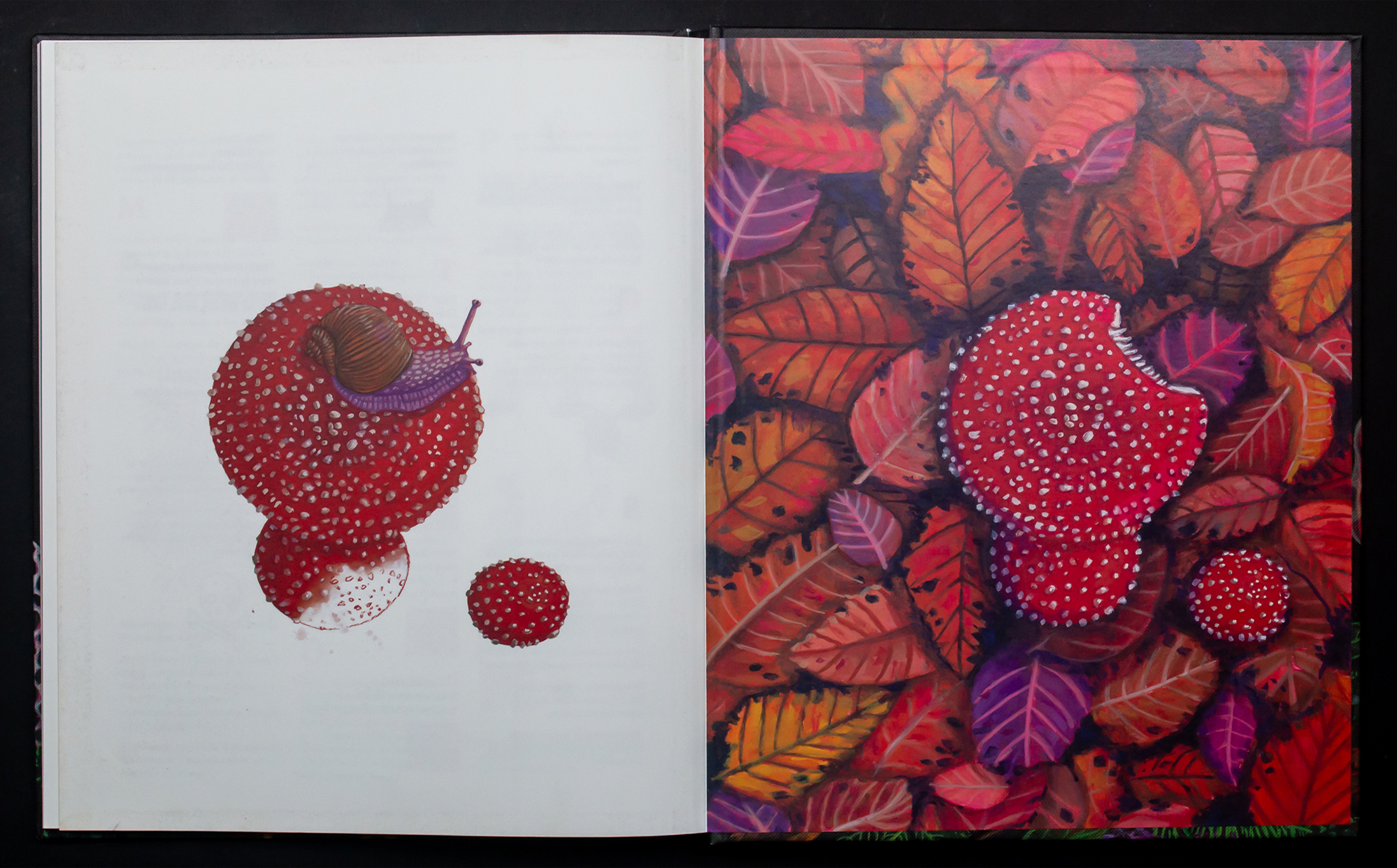
En examinant les éco‑thèmes, nous pouvons identifier, les compétences
non humaines des champignons, la biodiversité, l’importance de
l’écosystème, le biomimétisme et la bioinspiration. Il est important de
souligner que les certitudes et les connaissances que nous avons du
règne des champignons sont relativement nouvelles et font l’objet de
débats scientifiques. Dans les dernières pages du livre, nous trouvons un
glossaire, dans lequel les auteurs précisent une série de termes
utilisés dans le livre et permettent aux jeunes lecteurs de comprendre
les informations et les encourager à étudier le règne des champignons.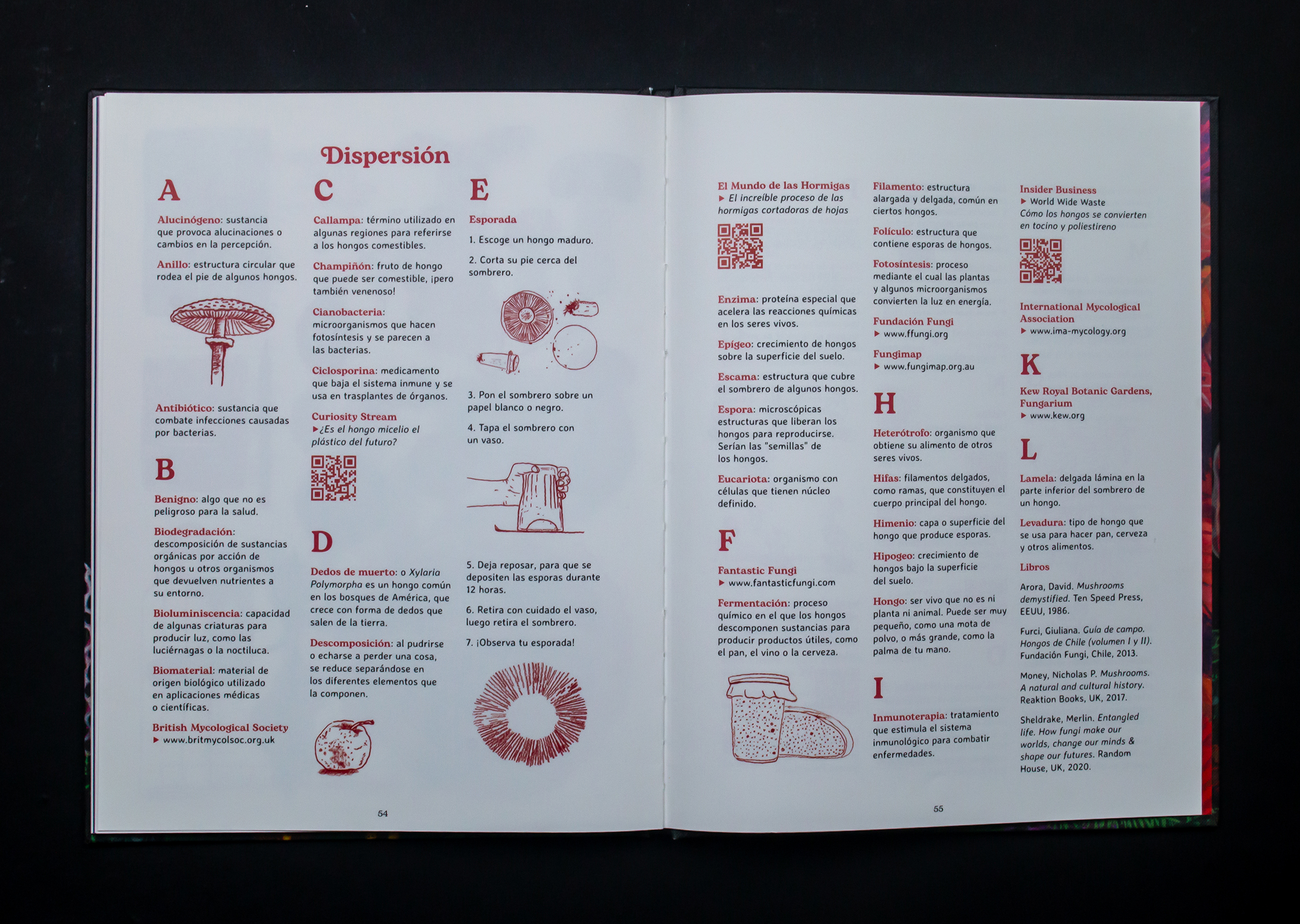 Glossaire. Reino Fungi.
Glossaire. Reino Fungi.
En définitive, nous pouvons dire que le livre adopte un registre majoritairement didactique pour sensibiliser les lecteurs à l’environnement. Les illustrations de Loreto Salinas cherchent à décrire et à mettre en valeur les informations essentiellement scientifiques présentées dans les textes, faisant ainsi appel à la raison et aux connaissances empiriques sur les champignons.
V.2. Registre poétique
V.2.1. Emerveiller pour convaincre
Le livre documentaire L’odyssée des graines a été publié en 2024 chez Gallimard Jeunesse a été conçu par Marie-laure Cruschi, autrice-illustratrice et designer graphique, fondatrice de l’atelier créatif Cruschiforme.
Après avoir fait un travail de recensement et de prélèvement minutieux de graines dans la région des Cévennes, l’autrice montre comment les plantes ont développé des stratégies intelligentes de dispersion des graines pour assurer leur reproduction. En expliquant la forme et la morphologie des graines, elle décrit l’influence des différents facteurs climatiques et la symbiose avec les animaux. Parallèlement, l’autrice retrace le rapport culturel que nous entretenons avec les graines dans notre société et met en valeur leur importance.
Dans le livre, l’autrice favorise une description narrative et poétique pour transmettre les informations au lecteur. Une description poétique est attribuée à chaque graine en fonction de ses caractéristiques, de son parcours, de son histoire culturelle et de l’inspiration de l’autrice. Toutefois, des informations précises sur les graines sont présentes31.
« J’ai choisi de les illustrer ici dans toute leur diversité et de me détacher du vocabulaire scientifique afin d’offrir mon regard sensible et poétique au plus grand nombre. Que les spécialistes me pardonnent cette privauté d’artiste !32 ».
En ce qui concerne la forme du livre, le documentaire compte
cent‑cinquante‑et‑une pages divisées en dix sections, avec une reliure
dos carré collé dans un format rectangulaire. Le livre contient une
jaquette laminée avec découpe sur couverture qui laisse entrevoir la
couverture dans un papier non laminé. Cette fenêtre permet d’entrevoir
une illustration de paysage à travers la silhouette découpée d’une
graine de chêne (gland)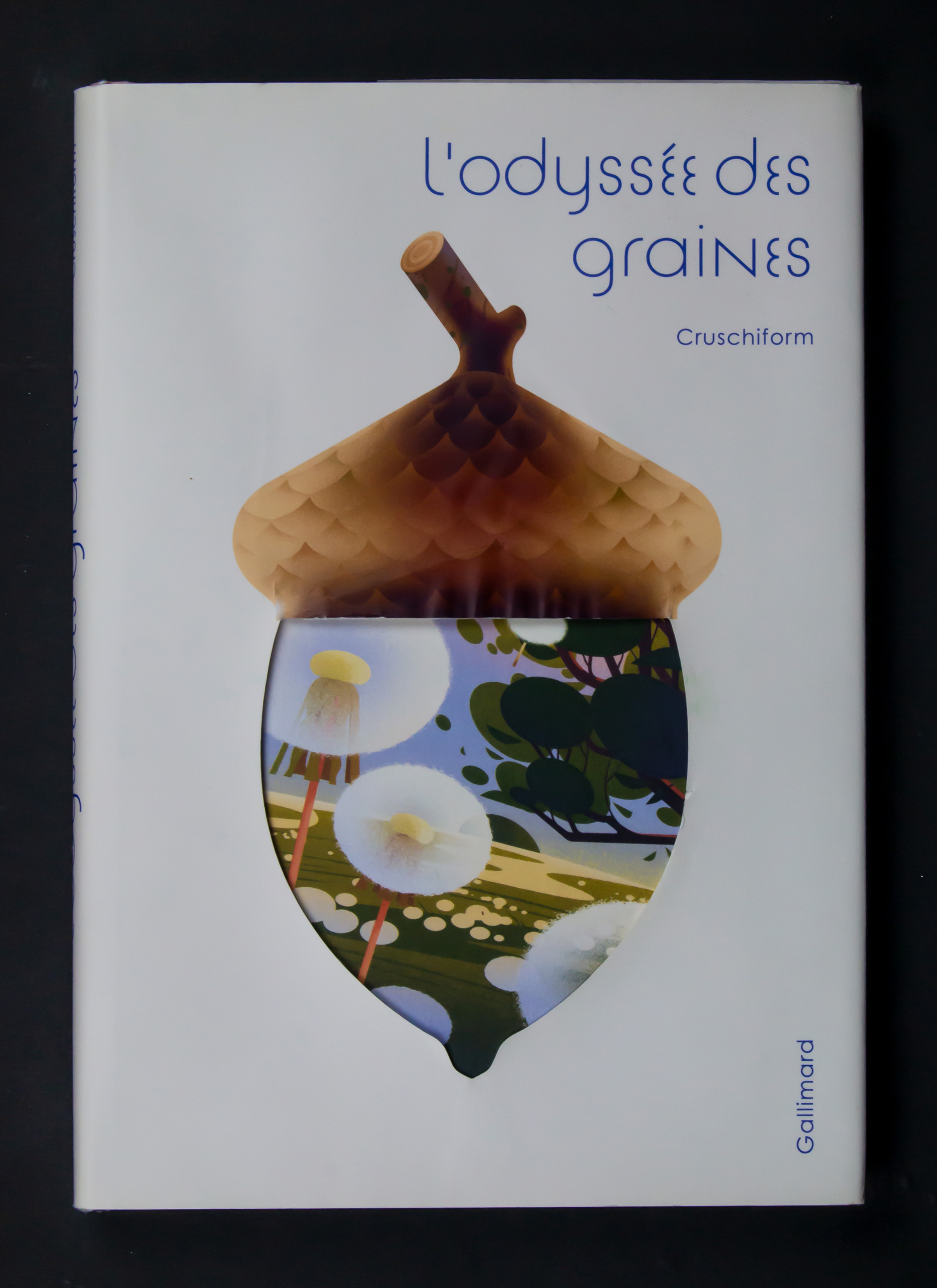 Première de couverture. L’odyssée des graines..
Première de couverture. L’odyssée des graines..
Le livre utilise des polices de caractères sans empattement, Architype
(Jan Tschichold, 1929) pour les titres et Century Gothic (Sol Hess, 1991) pour les textes introductifs des sections. La police Neutraface
(Christian Schwartz, 2002) est utilisée pour les textes explicatifs et
les sous-titres. Ces polices de caractères ajoutent à l’œuvre un style
géométrique, stylisé et moderne. D’ailleurs, l’autrice
explique ses choix typographiques à la fin de l’ouvrage. Le choix
typographique de l’autrice, le fait de vouloir sortir des canons
graphiques classiques pour représenter le vivant (police de caractères
avec empattements) en proposant une représentation différente, et la
volonté de rendre ce choix transparent à la fin du livre, témoignent du
regard artistique de l’autrice qui confère une valeur poétique et
expressive important aux choix de polices de caractères de l’ouvrage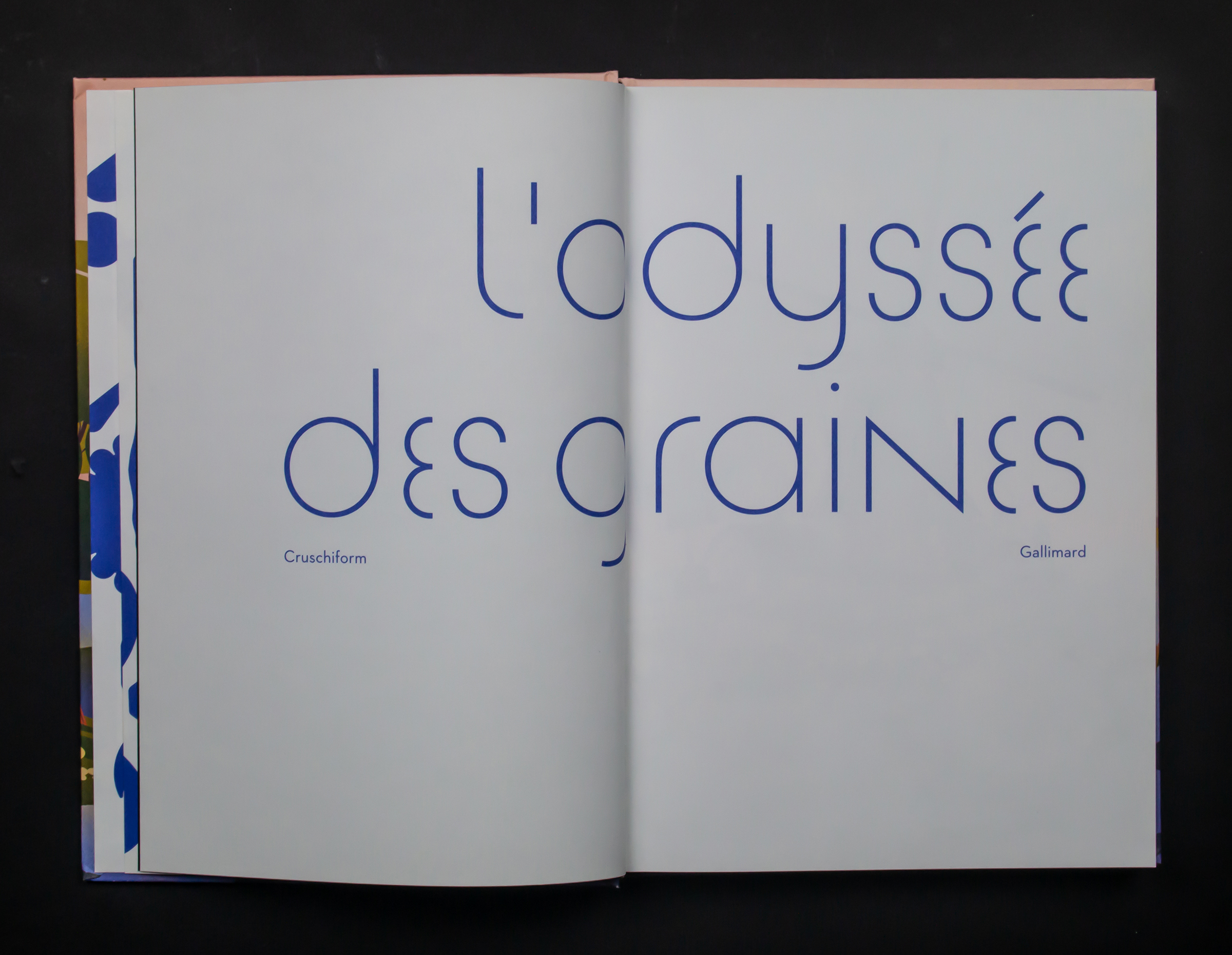 Polices de caractères. L’odyssée des graines..
Polices de caractères. L’odyssée des graines..
Le corpus du livre commence par les pages de garde, contenant un motif
graphique figuratif de graines (icônes) en monochrome bleu cobalt.
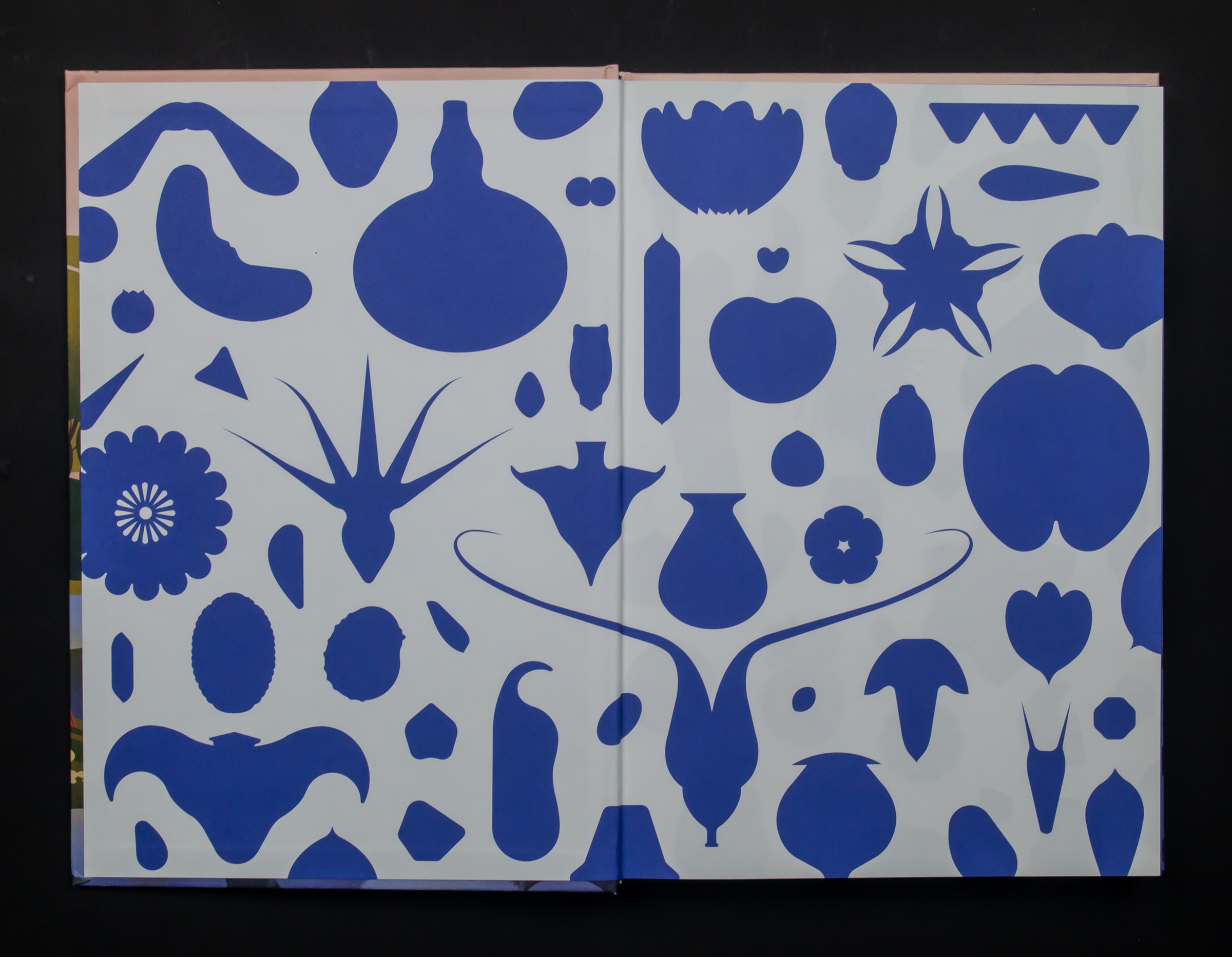 Garde. L’odyssée des graines. En termes de mise en page, nous pouvons distinguer dans le livre trois types principaux de doubles pages.
Garde. L’odyssée des graines. En termes de mise en page, nous pouvons distinguer dans le livre trois types principaux de doubles pages.
Le premier type de double page contient une illustration vectorielle du
paysage/écosystème d’où proviennent les graines qui sont étudiées dans
la section suivante. Cette vue d’ensemble abstraite accorde un temps de
contemplation au lecteur avant de l’amener vers l’étude plus intime de
chaque graines. 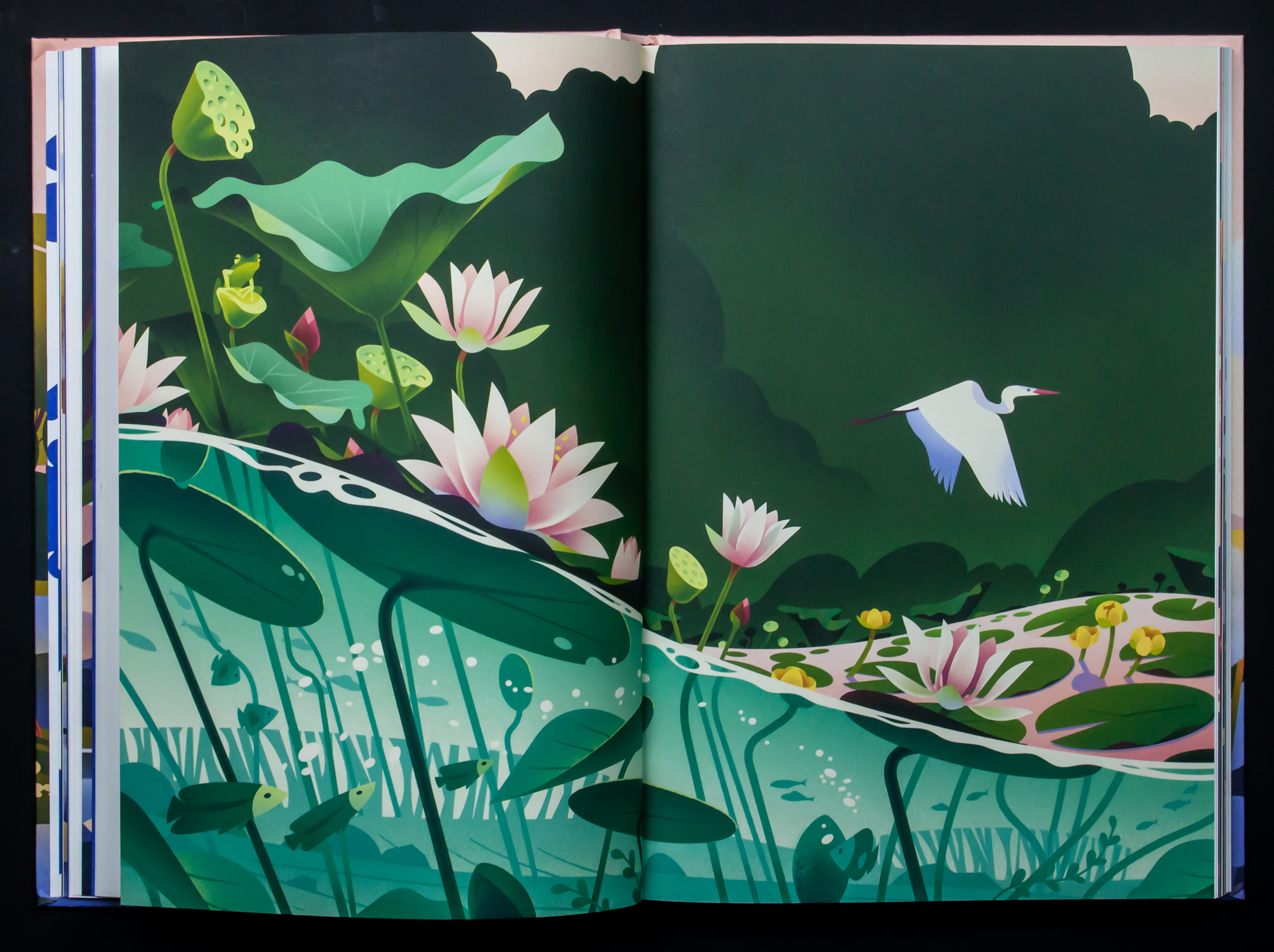
La deuxième typologie de double page suit l’image de paysage et
introduit les sections. Elle est composée à gauche d’une page imprimée
dans le même monochrome bleu cobalt que les pages de garde, avec un
texte expliquant le type de voyage des graines et des exemples de
graines. La page de droite contient les illustrations de graines
décrites sur la page de gauche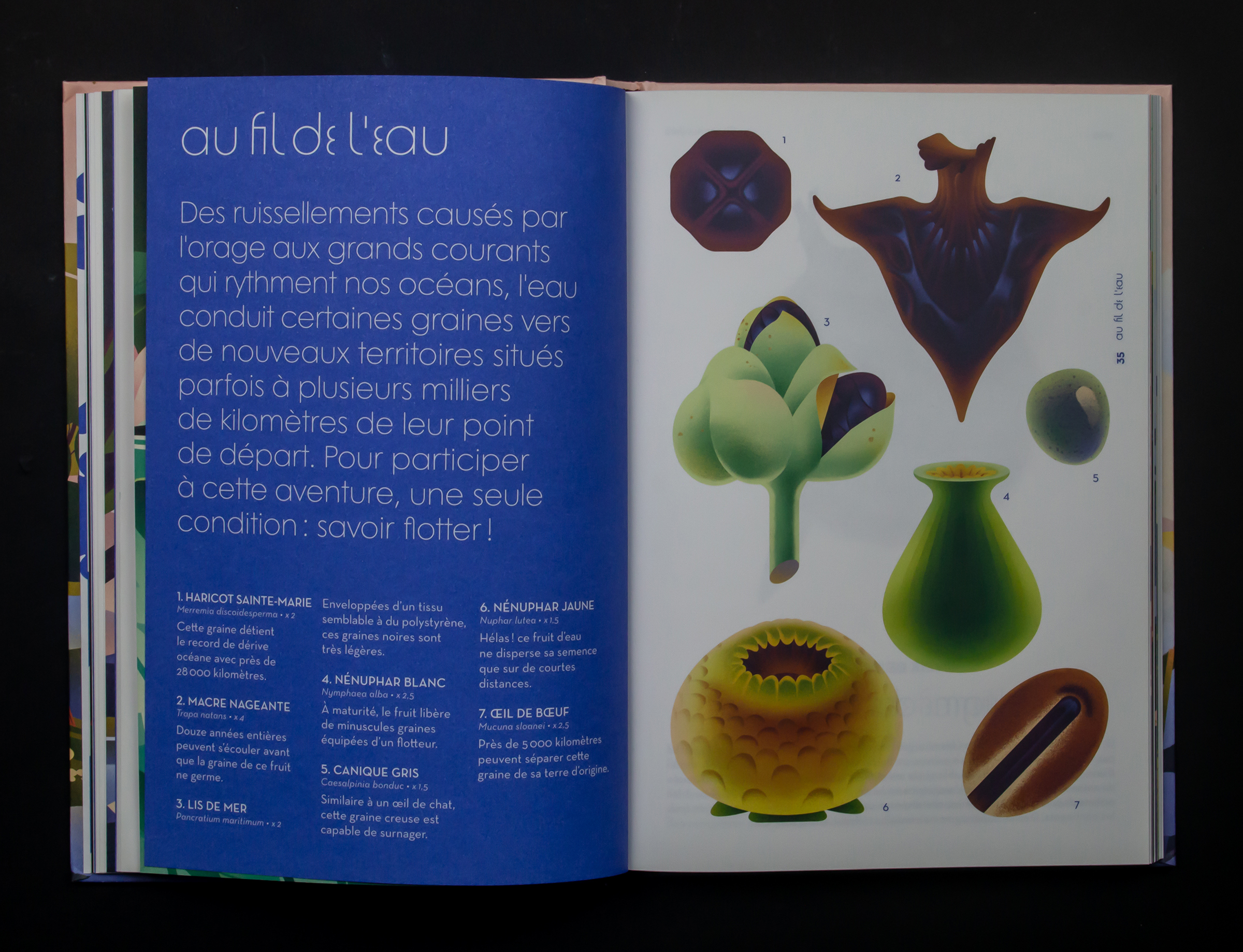 Mise en page. L’odyssée des graines..
Mise en page. L’odyssée des graines..
Le troisième type de double page est celui qui contient l’étude détaillée des graines. Chaque illustration est centrée au milieu de la page, occupant les deux premiers tiers de la page mais il y a parfois une seule graine centrée sur la double page. Les informations relatives aux espèces sont placées en bas de page. La composition visuelle de la double page est symétrique. Le choix des polices de caractères et le gris justifié du texte témoignent de la ligne graphique élégante et équilibrée de l’ouvrage.
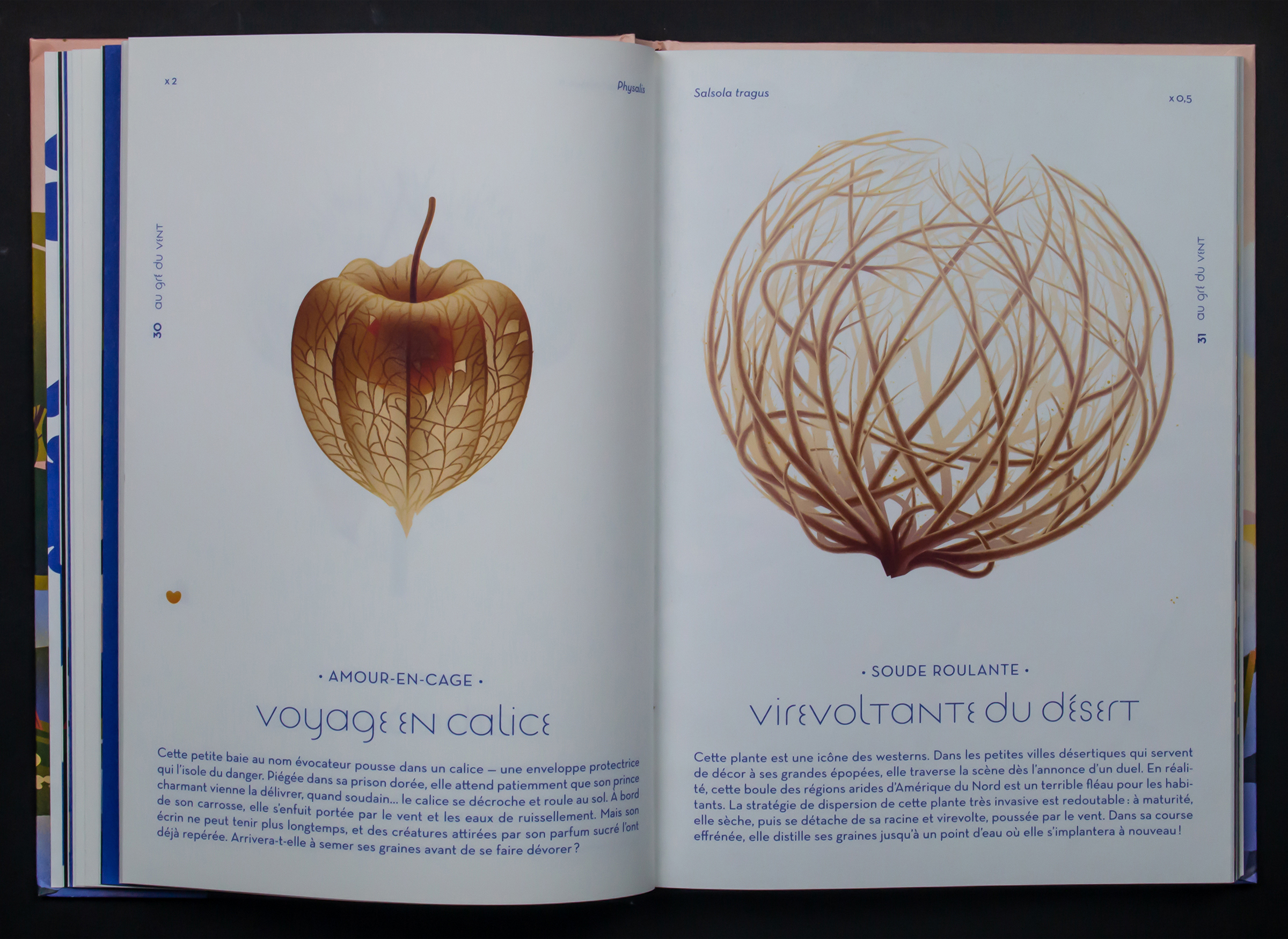
De manière générale, la représentation graphique du livre accorde une place importante à l’image illustrée. Plus de cent-trente espèces et treize paysages sont représentés par des illustrations vectorielles, qui synthétisent visuellement les formes des graines et mettent en évidence leurs caractéristiques essentielles, que l’auteur prend soin de souligner. La palette de couleurs oscille entre la froideur du bleu cobalt et la chaleur des tons verts, jaunes et bruns des graines.
Ici, le choix de recourir à l’illustration vectorielle paraît judicieux car elles subliment les formes naturellement proportionnées des graines, les grains sont représentés comme des objets de design modernes, répondant ainsi aux codes esthétiques contemporains (Cf. entretiens VII.2. Question 4). Les textures des illustrations et la palette de couleurs s’inscrivent dans une esthétique graphique stylisée, élégante et poétique, rendant l’observation des graines originale, captivante et dynamique.
En termes d’engagement environnemental, l’autrice conclut la narration en évoquant la plus grande banque de semences du monde, située au Svalbard, dans les terres gelées de l’Arctique33. Cet exemple montre aux jeunes lecteurs l’importance des graines dans notre environnement et les invite s’investir dans l’écologie34.
Parmi les éco‑thèmes abordés dans le livre, nous pouvons principalement en identifier deux : l’intelligence végétale et l’importance de la biodiversité. En mettant en évidence les caractéristiques physiques de chaque graine, l’autrice montre comment elles ont développé une stratégie de déplacement et de reproduction (intelligence végétale)35.En ce qui concerne la biodiversité, l’autrice explique comment les différents êtres vivants, les ressources naturelles et les conditions climatiques favorisent le cycle de vie des graines. Par ces explications, elle cherche à éveiller la curiosité et l’émerveillement des jeunes lecteurs pour les encourager à préserver notre planète.
La conception écologique du livre a été une préoccupation de l’autrice. Il a été produit dans une imprimerie européenne à Vicence, au pied des Alpes italiennes, sur du papier Natural Smooth 140 g. Cette approche durable de la production en adéquation avec le message écologique que le livre transmet (Cf. entretiens VII.1. Question 6).
Pour conclure, nous pouvons dire que ce livre s’inscrit dans un registre éco‑graphique poétique car la sensibilisation à l’environnement du lecteur repose davantage sur l’émerveillement, l’imagination et la beauté plutôt que des démonstrations scientifiques exhaustives. La direction artistique et la ligne graphique raffinées permettent de connecter émotionnellement les jeunes lecteurs aux éco‑thèmes abordés.
V.2.2. Une pratique culturelle dans la représentation graphique
Los secretos del Foye (les secrets du Foye36) est un livre documentaire qui aborde le sujet du vivant, d’un point de vue ethnologique, sous la forme d’un album photographique37 qui a été publié en 2024 par l’éditeur chilien Ocho Libros Editores et conçu par deux auteurs chiliens. Il s’agit d’Ana Lagos, diplômée en design et économie sociale, dédiée au développement de l’artisanat traditionnel textile et artistique et de Lorena Eyzaguirre, designer graphique, diplômée en appréciation esthétique de livres pour la jeunesse, investie dans la promotion de littérature dans les zones d’éducation moins favorisées du pays.
Pour réaliser cet ouvrage, les auteurs ont réalisé une étude ethnographique sur le patrimoine culturel matériel et immatériel38 lié à la nature, propre au peuple autochtone mapuche39 dans la région de l’Araucanie, au sud du Chili.
A l’aide d’un récit séquentiel, le livre présente l’importance
environnementale et culturelle de l’arbre Foye ou Canelo40
originaire de la région d’Araucanie, qui est considéré comme sacré par
les mapuches. Première de couverture. Los secretos del Foye.
Il décrit également la menace que représente
l’industrie forestière pour sa conservation. Finalement, dans la
dernière partie du livre, présentée sous forme de glossaire, les auteurs
introduisent les personnages et apportent des informations factuelles
sur les espèces, tout en exposant la vision du monde vivant du peuple
mapuche.
Première de couverture. Los secretos del Foye.
Il décrit également la menace que représente
l’industrie forestière pour sa conservation. Finalement, dans la
dernière partie du livre, présentée sous forme de glossaire, les auteurs
introduisent les personnages et apportent des informations factuelles
sur les espèces, tout en exposant la vision du monde vivant du peuple
mapuche.
Les images de ce livre sont des photographies de compositions
séquentielles, rappelant la méthode narrative visuelle d’une bande
dessinée. Ana Lagos a créé toutes les figurines et les décors pour
illustrer la narration du livre à partir de laine feutrée et teintée
avec la feuille du Foye selon la méthode traditionnelle des mapuches Scène photographiée, conçue en laine feutrée. Los secretos del Foye., qui donne un rendu visuel proche de celui du stop-motion.
Scène photographiée, conçue en laine feutrée. Los secretos del Foye., qui donne un rendu visuel proche de celui du stop-motion.
Le format du livre est en paysage et de taille moyenne. La reliure est en dos carré collé et le matériau de la couverture est un carton couché mat souple, contenant une illustration de paysage. La couleur du papier à l’intérieur du livre varie entre le blanc du papier et un vert mousse pâle.
La mise en page du livre est assez conventionnelle et suit la logique de
l’album jeunesse. Dans la partie narrative séquentielle, le graphiste
alterne l’ordre de la composition visuelle des deux pages en vis-à-vis
(texte-image). Tantôt l’image se trouve sur la page de droite, tantôt
sur la page de gauche, et inversement pour le texte.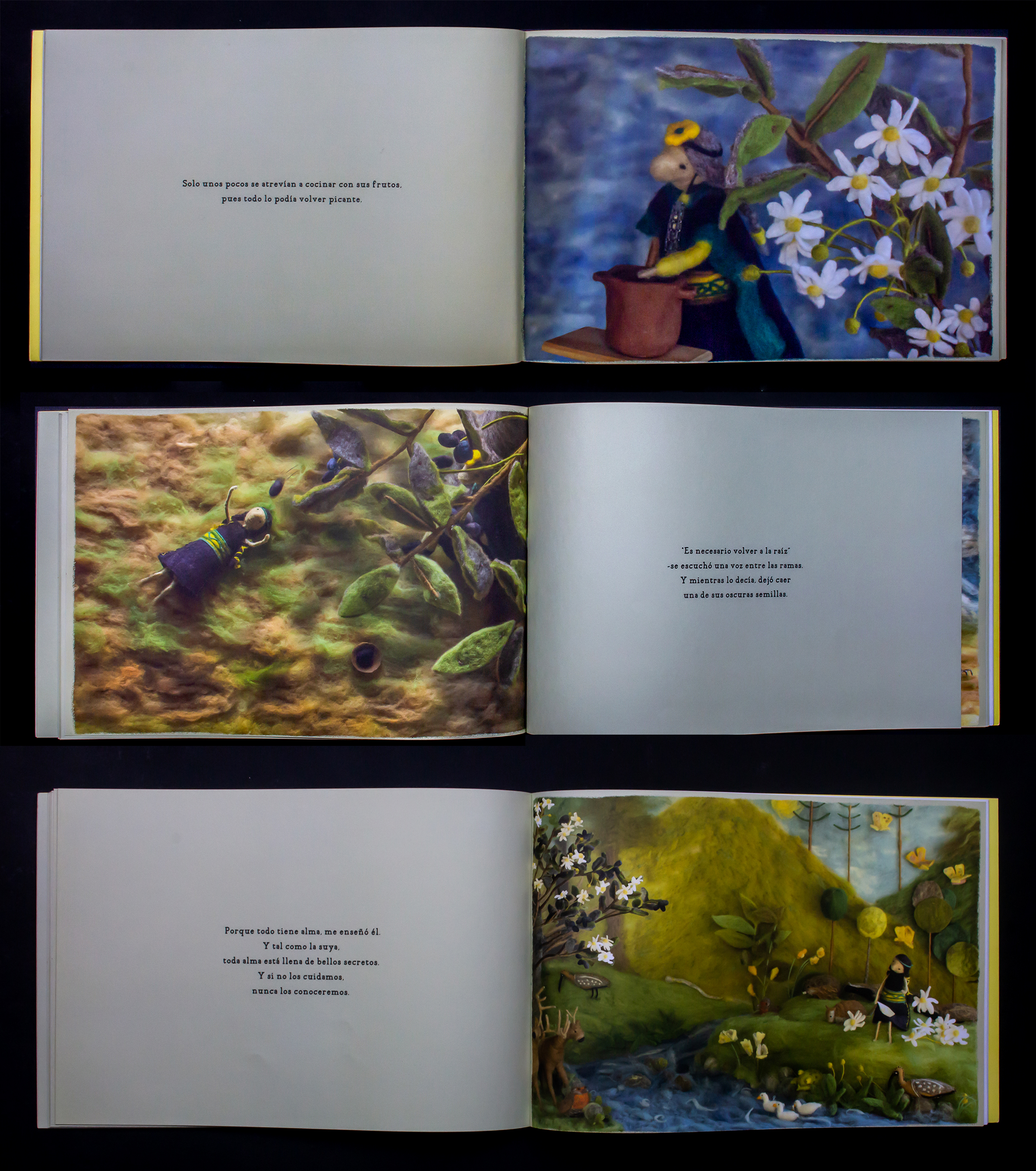
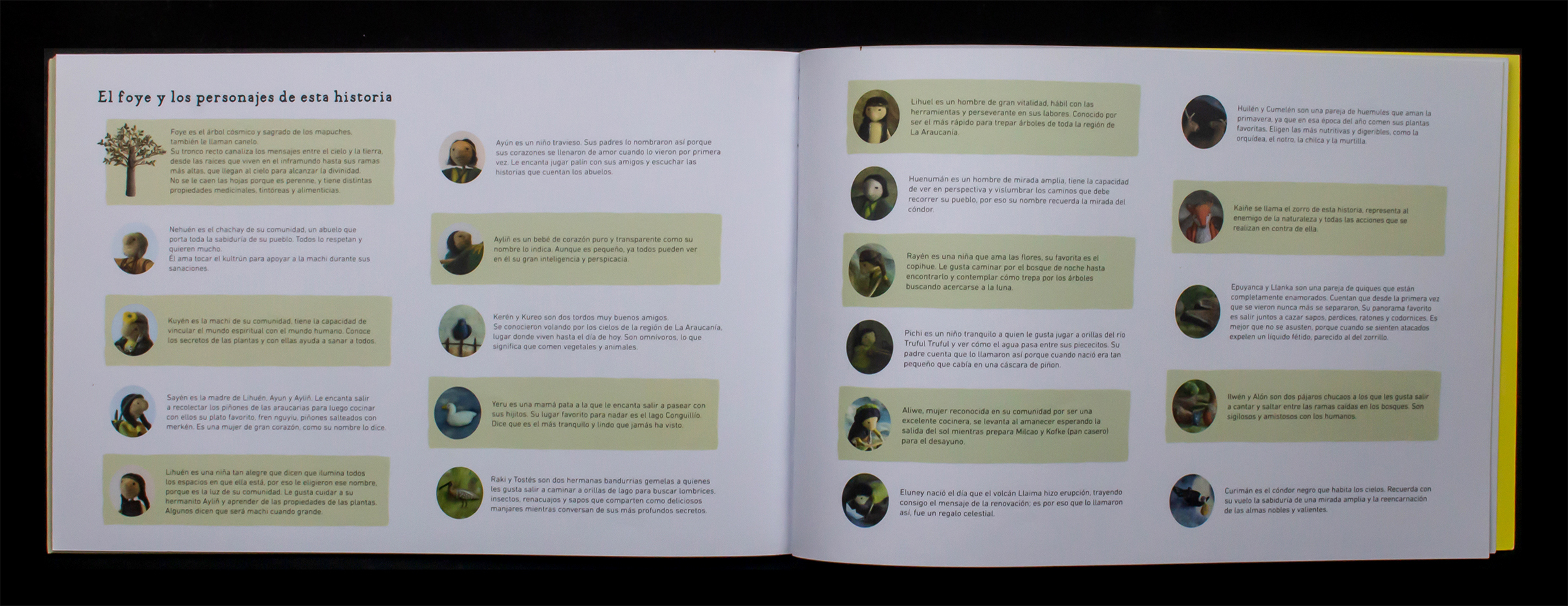
L’éco-graphie de ce livre contient trois éco‑thèmes : la protection de la faune et de la flore endémique, la pression humaine sur la nature et le réensauvagement de la nature41. De plus, par la composition des visuels, ce livre vise à mettre en valeur un artisanat qui fait partie de l’identité culturelle du peuple mapuche. Ainsi, ce livre véhicule un message activiste qui incite les jeunes lecteurs à agir pour aider l’environnement à retrouver un équilibre souvent menacé.
Outre la mise en valeur des éco-thèmes et de l’identité culturelle, ce livre documente la cosmovision42 du monde vivant du peuple mapuche. Il vise à sensibiliser les jeunes lecteurs à l’interprétation de l’écosystème depuis un point de vue critique et émotionnel. En documentant la cosmovision mapuche, il semble que les auteures cherchent à restaurer les toponymies originelles et à reconstruire des histoires et significations culturels oubliées éloignées d’une vision anthropocentrique tout en expriment de nouvelles formes eco-graphiques sensibles qui permettent aux jeunes lecteurs se situer en tant que partie intégrante de l’écosystème.
Par ailleurs, l’imaginaire occupe une place importante dans la culture mapuche, c’est à travers lui que le peuple perçoit le monde réel, le définit et lui donne un sens. Donc, en documentant la manière dont le peuple mapuche perçoit le monde réel, cet ouvrage montre que l’imaginaire n’est pas seulement l’apanage de la fiction, mais qu’il peut également être présent dans le documentaire, car il est constamment présent dans le monde réel.
La conception graphique et le récit de ce livre sont en accord avec le registre poétique lorsqu’il s’agit de la représentation d’une cosmovision du vivant propre au peuple mapuche. La sensibilisation à l’environnement de ce livre relève du registre poétique en raison du recours à une conception graphique artistique et une narration au ton mystique.
V.3. Registre mixte
V3.1 L’information claire sous l’apparence poétique
Le livre documentaire Le Retour des Loups, publié en 2022 par Saltimbanque Éditions, a été écrit par Nadja Belhadj, traductrice et autrice pour la jeunesse, et conçu par Marc Majewski, illustrateur et créateur de livres et d’images.
Ce livre documentaire retrace l’histoire de la réintroduction des loups dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis, d’une manière narrative dans une première partie et informative dans la deuxième.
La première partie du livre raconte l’histoire de la réintroduction du loup dans l’écosystème qui lui correspondait autrefois et montre ses bienfaits. Le récit décrit comment, étape par étape, l’écosystème commence à se régénérer, d’abord la végétation se rétablit, puis d’autres animaux arrivent et l’écosystème retrouve son équilibre.
Dans la deuxième partie, des textes informatifs expliquent le concept du réensauvagement et comparent la biodiversité avant et après l’arrivée des loups dans le Yellowstone.
À première vue, le format du livre semble ordinaire. Il est
rectangulaire, ses proportions se distinguent par une verticalité plus
accentuée et sa couverture cartonnée est recouverte d’un papier
laminé.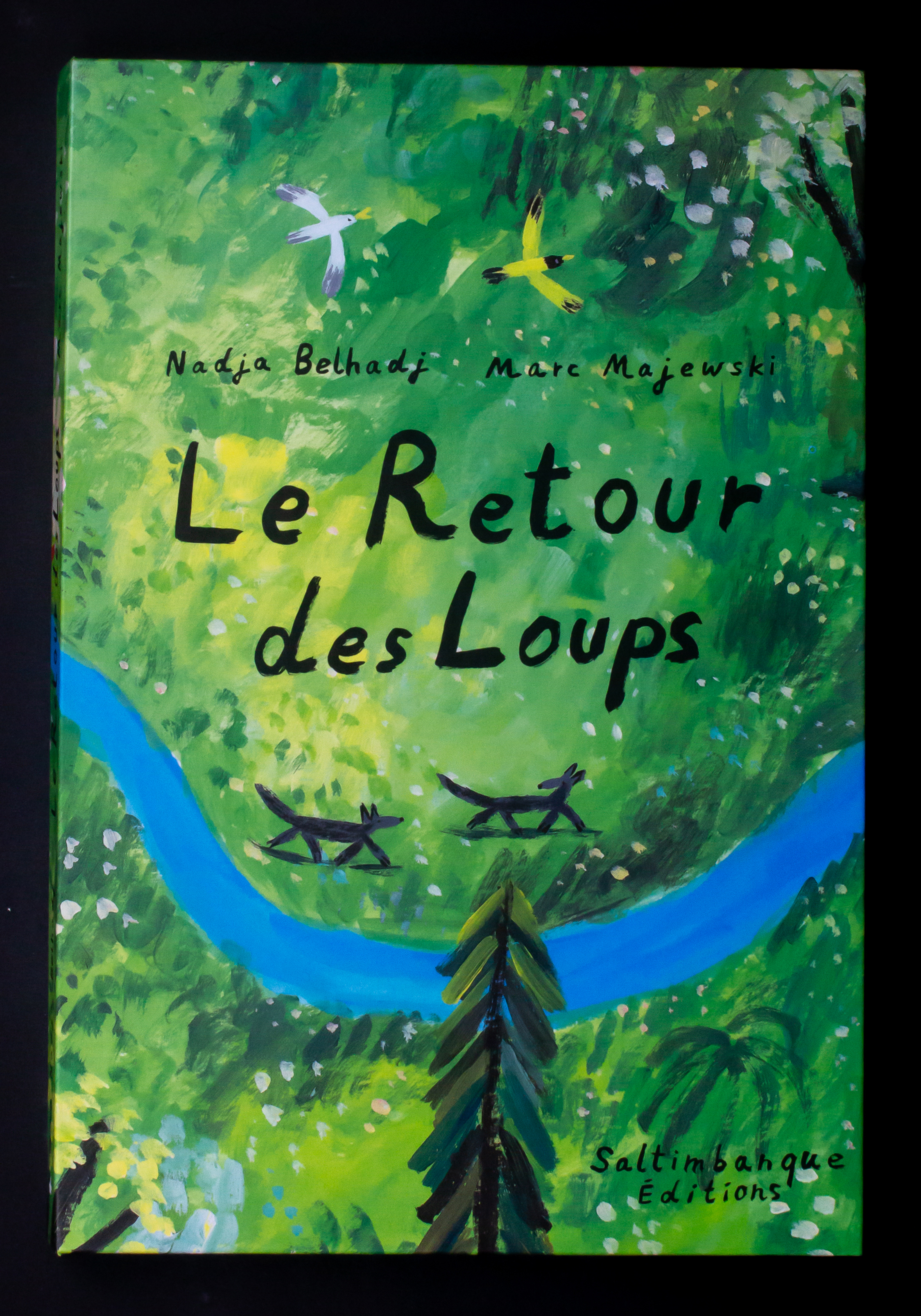 Première de couverture. Le Retour des Loups. Cependant, une fois ouvert, il révèle son originalité : le livre
est conçu sous la forme d’un leporello, déplié dans sa totalité, présente une linéarité remarquable, sa longueur totale dépasse les
trois-cent centimètres. Il est imprimé recto‑verso et chaque face du
leporello contient une partie du livre, la première correspond au récit
et la deuxième à la documentation.
Première de couverture. Le Retour des Loups. Cependant, une fois ouvert, il révèle son originalité : le livre
est conçu sous la forme d’un leporello, déplié dans sa totalité, présente une linéarité remarquable, sa longueur totale dépasse les
trois-cent centimètres. Il est imprimé recto‑verso et chaque face du
leporello contient une partie du livre, la première correspond au récit
et la deuxième à la documentation.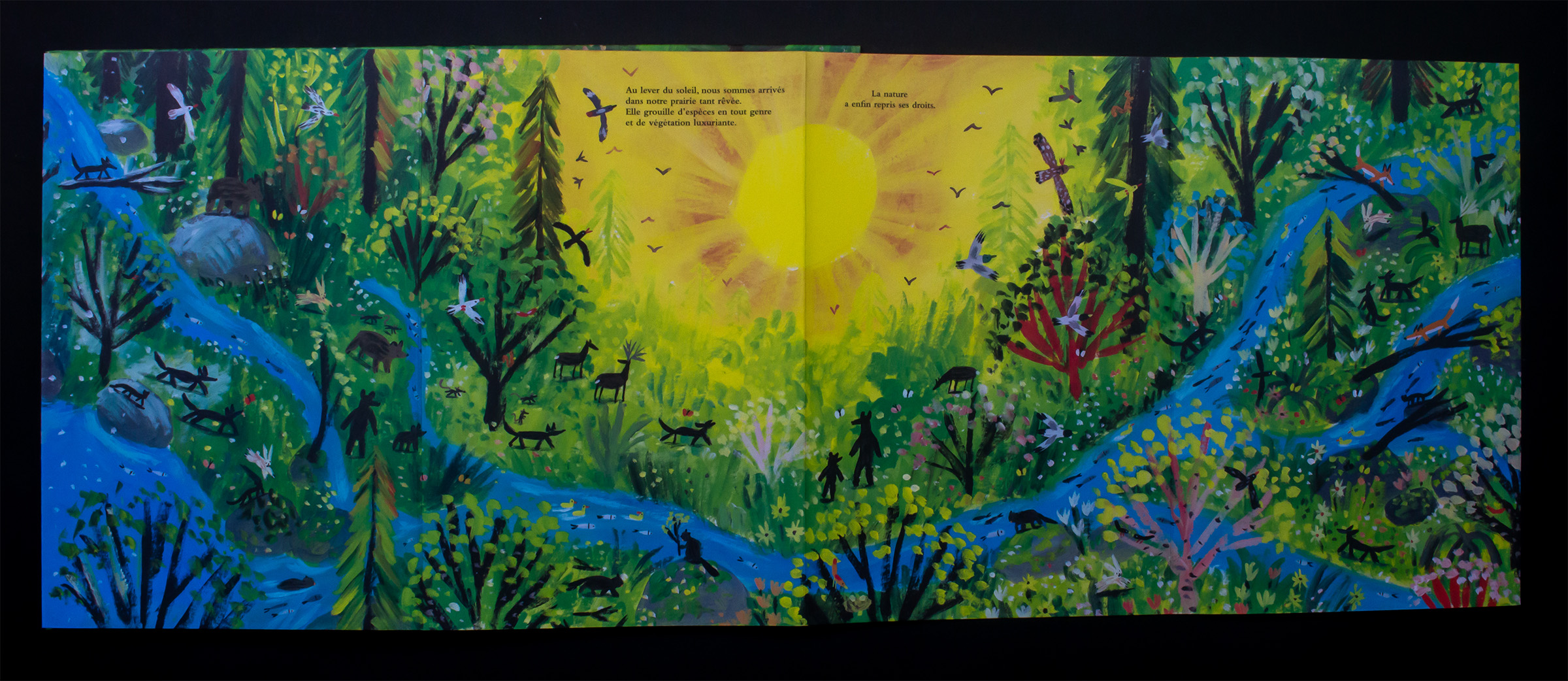
Le design graphique et les illustrations à l’acrylique de l’ouvrage ont été réalisés par Marc Majewski. En général, le travail de l’artiste est fortement inspiré par la nature43. Son style visuel est caractérisé par des coups de pinceau et des couleurs vives, avec des influences impressionnistes. Ses tirages sont réalisés sur du papier de qualité par des imprimantes de haute précision, calibrées individuellement.
Quant aux polices de caractères, Marc Majewski a dessiné tous les titres de l’ouvrage avec un travail de lettrage manuel au pinceau. Pour le texte principal, il utilise une police de caractère très traditionnelle de la famille des garaldes, donc avec empattement.
Dans la conception du corpus de livre, la mise en page et la représentation graphique diffèrent un peu de chaque face du leporello du livre.
Dans la première partie, l’illustration du leporello utilise toutes les
pages du livre, d’un bord à l’autre. Chaque page contient un court
paragraphe de texte narratif, au ton poétique. La police de caractère à
empattement, de taille moyenne, est placée dans une partie de
l’illustration qui contient peu d’informations visuelles. En somme, dans
cette partie du livre, il semble que les auteurs de l’œuvre aient voulu
que l’histoire soit racontée par les images dans un logique séquentielle
et que le texte occupe une place secondaire. Prise à part, cette partie
pourrait appartenir à un album jeunesse44 non documentaire car
ici le style de Majewski cherche à émouvoir à travers l’image.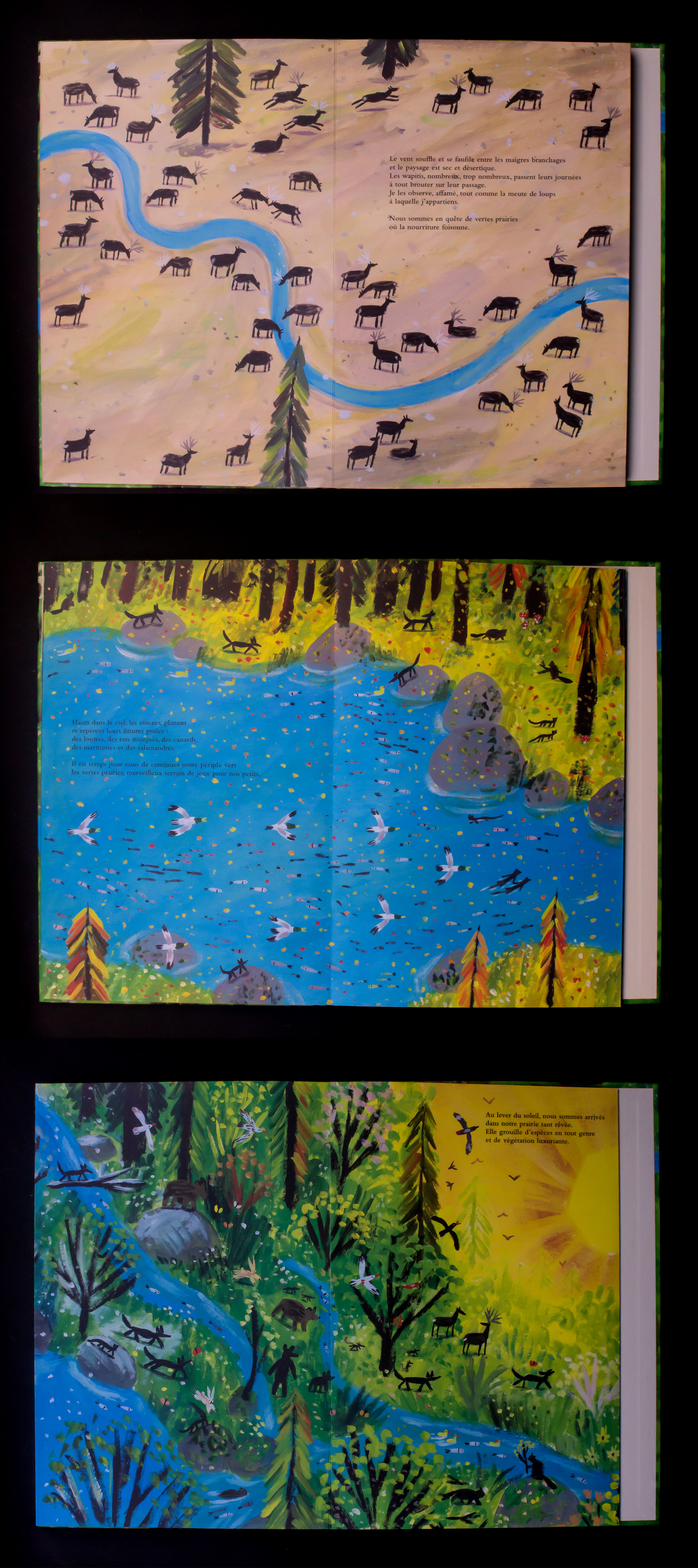 Mise en page. Le Retour des Loups.
Mise en page. Le Retour des Loups.
Le verso du leporello en deuxième partie, commence par une page
contenant à nouveau le titre du livre, comme si le livre recommençait
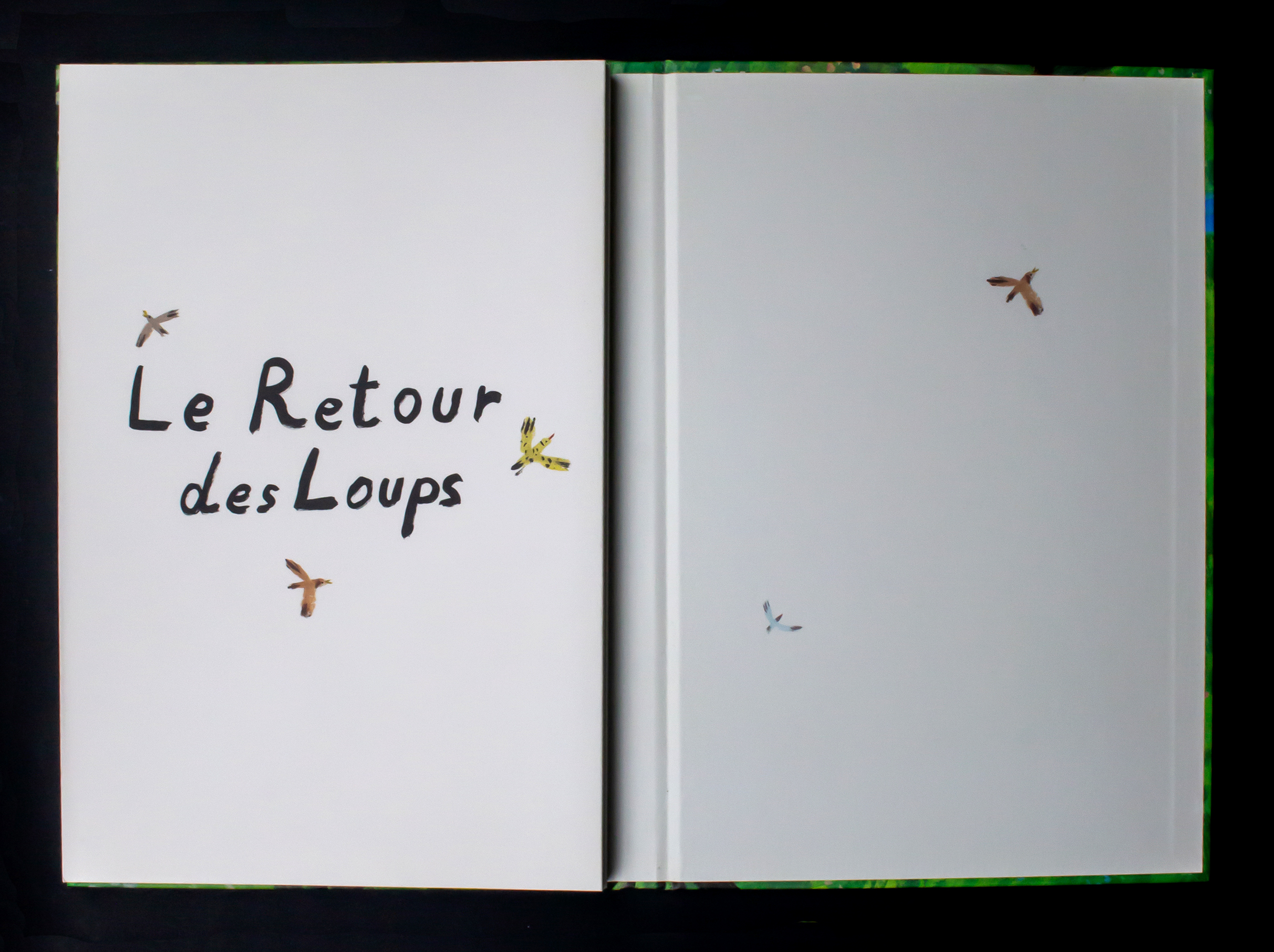 Première page du verso. Le Retour des Loups.. Le titre est également en lettrage manuel mais cette fois sur
le fond du papier (blanc). Le parcours visuel de cette partie se fait
page après page. La mise en page est simple, avec une seule colonne de
texte sur toute la largeur de la page, et les textes informatifs sont
centrés. Le designer compose la page en combinant les titres en lettrage
manuel, les boîtes de texte principales (geralde‑serif) et les
illustrations des espèces. En ce qui concerne les illustrations, la
technique est la même mais elles sont plus détaillées. Il semble y avoir
une volonté de didactisme dans le dessin, pour correspondre au texte
explicatif, bien que le style soit richement expressif et
poétique. Ici les lecteurs sont invités non seulement à s’informer mais
aussi à imaginer.
Première page du verso. Le Retour des Loups.. Le titre est également en lettrage manuel mais cette fois sur
le fond du papier (blanc). Le parcours visuel de cette partie se fait
page après page. La mise en page est simple, avec une seule colonne de
texte sur toute la largeur de la page, et les textes informatifs sont
centrés. Le designer compose la page en combinant les titres en lettrage
manuel, les boîtes de texte principales (geralde‑serif) et les
illustrations des espèces. En ce qui concerne les illustrations, la
technique est la même mais elles sont plus détaillées. Il semble y avoir
une volonté de didactisme dans le dessin, pour correspondre au texte
explicatif, bien que le style soit richement expressif et
poétique. Ici les lecteurs sont invités non seulement à s’informer mais
aussi à imaginer.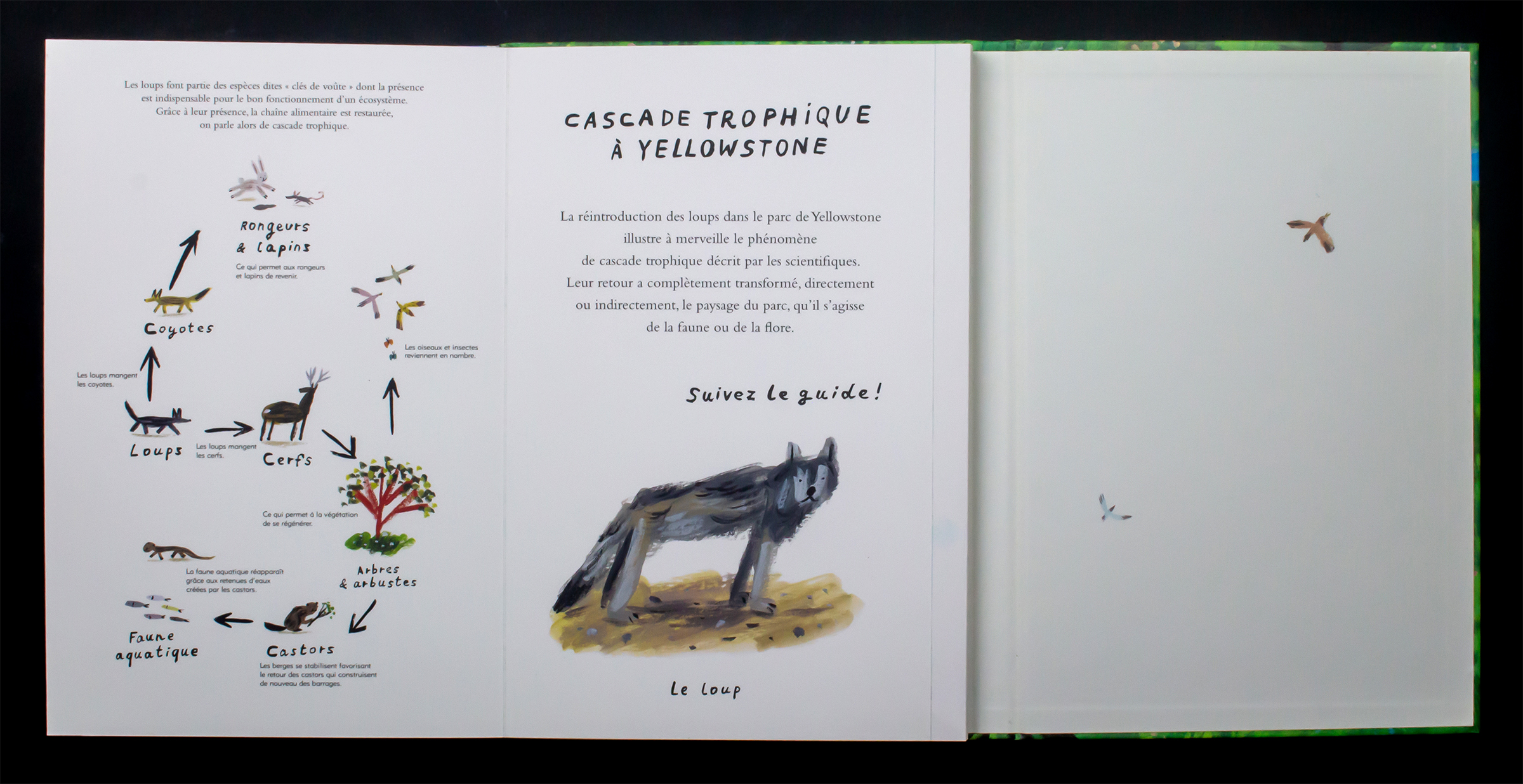
Le concept de réensauvagement au rewilding est le principal éco-thème de l’ouvrage. Nous y découvrons également l’importance de l’écosystème, la relation entre les espèces et la résilience. Ce livre montre aux lecteurs que le monde vivant est capable de se régénérer lui-même si nous le comprenons. Le livre se termine par la phrase suivante : « C’est en regardant, en écoutant la nature faire, que les idées d’aujourd’hui feront le monde de demain45 ».
En définitive, à travers une narration visuelle à la fois littéraire et documentaire, ce livre fait appel à la raison et aux sentiments. Les éco‑graphies, les formes narratives et le style de représentation graphique suivent ce même équilibre. Nous pouvons donc dire que la sensibilisation à l’environnement s’inscrit dans un registre mixte.
VI. Conclusion
L’enjeu essentiel de ce mémoire était de comprendre pourquoi la sensibilisation à l’environnement dans les livres documentaires pour la jeunesse consacrés au vivant revêt différentes formes de représentations graphiques. Pour cela, une analyse en deux temps a été réalisée.
Tout d’abord, une analyse historique a révélé les œuvres artistiques et scientifiques des naturalistes européens du XVIIIe siècle, illustrant les premières définitions de la notion du vivant. Les œuvres des naturalistes ont servi de point de départ de cette analyse car elles se sont imposées dans l’histoire de la représentation graphique comme des pièces fondamentales de la vulgarisation scientifique du vivant.
L’analyse historique s’est concentrée sur le monde de la littérature jeunesse pour comprendre la naissance du livre documentaire jeunesse consacré au vivant, comme un outil pédagogique porteur d’une identité graphique expressive qui est devenu la vitrine des éco‑thèmes au cours du XXIe siècle.
Dans un deuxième temps, une analyse d’un corpus international d’œuvres, classées dans trois registres éco‑graphiques distincts a révélé les différentes facettes de la sensibilisation à l’environnement et de la notion d’activisme écologique dans les livres documentaires jeunesse publiés ces dernières années.
Cette analyse réalisée en deux temps a permis de comprendre, d’une part, comment les représentations graphiques ont interprété la notion du vivant établie par les naturalistes, autrefois appelé nature, et d’autre part, comment l’approche contemporaine et les nouvelles representations graphiques ont remis en question ce concept établi à l’époque et l’ont remplacé par celui du vivant .
Après l’analyse du corpus de d’œuvres de France et du Chili, iI ressort que les différents registres de sensibilisation à l’environnement ont recours à des représentations graphiques parfois différentes et parfois similaires. Toutefois, chaque forme éco‑graphique de traitement des éco‑thèmes est authentique.
Dans les deux œuvres étudiées appartenant au registre didactique, la sensibilisation à l’environnement est traduite de manière directe par une représentation graphique précise. Dans Visions d’animaux pour mieux comprendre le monde, il est primordial pour l’auteur que les dessins soient instructifs (Cf. entretiens VII.1. Question 3). Dans Reino Fungi également, les illustrations sont là pour apporter un complément à l’explication décrite dans le texte tout en préservant l’impact expressif de la représentation graphique.
Dans le registre poétique, les deux œuvres analysées visent à faire rêver le lecteur par le biais des émotions et donc le sensibiliser à l’environnement de manière indirecte (Cf. entretiens VII.2. Question 3 et 7). Dans le livre Los secretos del Foye, la représentation graphique est abstraite et cherche à révéler la relation étroite qu’il existe entre l’art et la nature. Dans l’œuvre L’odyssée des graines, l’autrice s’efforce de représenter les graines sans compromettre l’originalité de son style et sa capacité à émerveiller le lecteur.
Dans le registre mixte, les deux formes de sensibilisation s’entremêlent de manière confuse ou distincte. Le Retour des Loups de Nadja Belhadj et Marc Majewski est un exemple qui illustre clairement la présence des deux registres (didactique et poétique), puisque le livre est divisé en deux parties, chacune répondant à une forme narrative différente, ce qui démontre une correspondance entre le texte et l’image. Cependant, cela ne signifie pas que c’est la seule façon d’aborder le registre mixte.
Tous les ouvrages présents dans le corpus abordent les éco‑thèmes d’un point de vue critique, qualifié par la littérature d’écocritique46 ou d’écopoétique47. Nous constatons que l’acception contemporaine de la notion du vivant est partagée par des ouvrages français et chiliens. Cependant la sensibilisation à l’environnement d’une population se construit en fonction des interactions existantes entre son patrimoine culturel et son rapport avec l’environnement. Donc, elle peut varier d’une région à l’autre du monde.
En comparant les ouvrages chiliens et français, nous pouvons conclure quíls accordent tous une place considérable à la sensibilité à l’environnement, mais dans le cas chilien, elle est formulée dans une perspective qui pourrait être perçue comme plus abstraite que celle de la France, tant dans l’image que dans la narration.
Le caractère abstrait des ouvrages chiliens pourrait trouver son origine dans l’histoire culturelle du pays qui a été bouleversée par l’arrivée des colons. Cela pourraient être interprété comme une tentative de déconstruire la vision du vivant venue de l’Occident, étayée par les sciences et le rationalisme. Il apparait une volonté de restaurer un rapport à l’environnement qui a été perdu et de d’intégrer des définitions du monde vivant qui ont été atténués. Ce caractère abstrait revêt une fonction protestative et montre que l’art a une place importante dans la sensibilisation environnementale.
L’intégration de la notion du vivant vise précisément à redéfinir et à interroger la place de l’homme au sein du monde vivant. Aujourd’hui, la sensibilisation des jeunes lecteurs à l’environnement intègre la notion d’écocritique et les invite à prendre conscience que même au sein d’une société, ils font aussi partie du vivant. Les liens entre l’histoire naturelle et les différentes formes de représentation artistique sont profonds et anciens, alors que les éco‑thèmes liés à la notion du vivant sont d’une grande actualité. Il est donc essentiel de remettre en question nos origines pour renouveler l’image que nous projetons du vivant.
Ainsi, nous pouvons constater que le concept de sensibilisation à l’environnement varie considérablement dans sa forme, selon les registres et les parties du globe. Cependant, sa finalité est partagée de tous : prendre conscience de l’importance du vivant. Loreto Salinas, co-autrice et illustratrice de Reino Fungi, déclare dans une interview pour la fondation chilienne la Fuente dédiée à la promotion de la littérature pour enfants :
« La sensibilisation croissante à l’importance de la préservation de l’environnement a suscité un nouvel intérêt pour la nature. Les gens cherchent à se reconnecter à l’environnement naturel, à le regarder de plus près et à repenser leur relation avec lui, et donc avec eux-mêmes48 ».
La sensibilité à l’environnement peut être analysée à partir de différents contextes culturels qui encadrent les œuvres, mais aussi sous différentes perspectives, telles que l’activisme écologique ou la poésie. Dans l’œuvre Visions d’animaux pour mieux comprendre le monde, l’invitation directe à prendre conscience du rôle que nous jouons en tant que société dans la conservation de notre écosystème, montre la notion du vivant à travers le prisme de l’écologie. Les jeunes lecteurs sont même initiés à certains logos d’associations environnementales afin d’élargir leurs horizons et à douter de leurs certitudes.
Dans l’œuvre chilienne Los secretos del Foye, le registre poétique est choisi car il correspond davantage aux codes culturels de la cosmovision des mapuches. La narration fait beaucoup appel aux sentiments, dépasse les frontières du documentaire et se rapproche de la fiction. Cette sensibilisation à l’environnement, bien qu’en partie mystique, intègre complètement la notion contemporaine du vivant.
La co-autrice de Reino Fungi mentionne dans la même interview pour la fondation La Fuente :
« Nous nous rendons compte que les genres littéraires deviennent flous, nous pouvons voir de la fiction dans un livre de non‑fiction et vice-versa. Cette fusion des genres enrichit le contenu, rendant l’information scientifique plus accessible et plus attrayante, et la narration imaginative bénéficie de la richesse de la connaissance factuelle49 ».
Nous pouvons comprendre que le registre didactique puisse également prétendre faire appel à des représentations graphiques diversifiées, à travers la poésie ou à l’émotion (Cf. entretiens VI.1. Question 7). Dans la même logique, nous pouvons également voir que le registre poétique cherche un point d’ancrage dans la documentation scientifique ou dans les sciences écologiques, comme par exemple dans Le retour des loups.
Cette observation déroge aux normes, nous voyons que les limites des registres ne sont pas si claires. Les registres didactique et poétique, bien qu’ils reflètent des formes narratives différentes, à la fois littéraires et visuelles, ne sont pas hermétiques l’un à l’autre : ils peuvent se mêler. Ce constat interroge les idéaux classiques de la littérature, comme le fait que lorsqu’il y a du didactisme, il n’y a pas de littérature. Il remet également en cause une incompatibilité entre la politique et la poésie, que la littérature environnementale et l’écocritique tentent précisément de combler. Cela est très bien illustré dans le livre de Nathalie Prince et Sébastien Thiltges : Éco-graphies, écologie et littératures pour la jeunesse :
« La question de l’écologie dans la littérature de jeunesse invite donc à repenser certaines distinctions dualistes entre didactisme et littérature, entre connaissance et émotion, entre instruction et plaisir50
Analyse. Schéma expliquant l’interrelation entre les différents registres de sensibilisation à l’environnement. ».
Enfin, faire face aux problèmes environnementaux, sur la base d’une approche holistique, doit impliquer le dynamisme de différents secteurs et la participation de tous les acteurs, tels que les organisations non gouvernementales, les associations écologiques, les sciences participatives, le système scolaire et les actions de diffusion innovantes. Le livre documentaire jeunesse sur le monde vivant est l’une des milliers de formes de médiation culturelle destinées à sensibiliser à l’environnement mais il s’agit d’une voie claire. Cette voie cherche, à travers différentes formes de représentations éco‑graphiques (didactiques, poétiques et mixtes) à permettre aux jeunes lecteurs de se placer à l’avant-garde de l’éducation, de la science, de la culture et de la politique contemporaine.
VII. Entretiens
VII.1. Christian Staebler, auteur de « Visions d’animaux pour mieux comprendre le monde » Maison d’édition Biscoto (2024)
Entretien réalisé le 09/01/2025 à 11h par visioconférence.
Dominga Rodríguez 1. Quels critères avez-vous utilisés pour choisir les différents thèmes environnementaux que vous abordez dans votre œuvre ?
Christian Staebler Avant la conception du livre, j’écrivais des pages sur les animaux qui paraissait chaque mois dans un journal qui s’appelle Biscoto. Chaque numéro avait un thème donc je présentais un texte et un animal qui y correspondait.
Pour faire le livre, qui est peut-être un premier tome, j’ai regroupé ces pages sous différents thèmes et chapitres et j’ai réfléchi à ce qu’il fallait compléter, donc évidemment l’écologie et d’autres thèmes qui sont évidents comme la reproduction ou l’intelligence par exemple. Il y a une quinzaine de thèmes et environ cinquante animaux au total. J’ai déjà de nouveaux sujets en tête, au cas où un tome deux devrait se faire, que je n’ai pas abordé dans le premier comme la forêt ou l’agriculture.
DR 2. Avez-vous bénéficié du soutien d’un chercheur scientifique pour l’élaboration de ces contenus ?
CS Une fois que tout était écrit, nous avons fait appel à une scientifique, docteur en écologie comportementale qui s’appelle Anne-Cécile Dagaeff. Elle a fait un important travail de contrôle scientifique sur les espèces et elle nous a proposé de réorganiser l’ordre des thèmes abordés, en fonction de critères scientifiques.
DR 3. Dans votre livre, vous avez conçu un registre graphique et narratif propice à la sensibilisation à l’environnement. Peut-on dire que ce registre fait appel à la rationalité ou aux sentiments ? Ou les deux ?
CS Pour moi c’est vraiment les deux, c’est à la fois rationnel et sensible. Il me semble que l’esthétique joue sur la sensibilité mais c’est très important pour moi que l’esthétique réponde aussi au côté factuel et scientifique.
On essaie de faire quelque chose de beau et d’agréable à l’œil pour que le lecteur ait envie de lire. La graphiste qui a fait la mise en page, Catherine Staebler, a aussi beaucoup contribué à l’aspect agréable de la lecture. Elle a cherché à rendre disponibles tous les éléments tels que les légendes, les dessins, les petits tableaux en bas de page ou la carte. Finalement, ils interagissent très bien entre eux. La mise en page est quelque chose qui joue aussi sur les sentiments je trouve aussi.
DR 4. Dans quelle mesure les illustrations didactiques et les textes explicatifs dialoguent-ils dans votre livre ? Y a-t-il une volonté de donner plus d’importance à l’une qu’à l’autre ?
CS Les textes explicatifs sont primordiaux surtout sur les pages thématiques. Sur les pages relatives aux espèces animales c’est peut-être un peu différent, les illustrations sont là pour pour donner de la profondeur. Comme disait Napoléon (même si ce n’est pas une source que j’admire) un bon dessin vaut mieux qu’un long discours. C’est moitié moitié, les deux se complètent.
DR 5. De manière générale dans vos travaux, de quelle manière pensez-vous que la représentation graphique favorise la sensibilisation et l’engagement à l’environnement du jeune lecteur ?
CS Pour les enfants en général, un texte seul, c’est difficile. L’image sert à accompagner un texte et à le rendre plus facile à aborder. Donc notamment pour ce livre, c’était évident qu’il fallait des images. C’est aussi vrai pour les livres pour les adultes mais encore plus pour les enfants parce qu’ils ne maîtrisent pas tout à fait la lecture.
En tout cas, quand on parle d’un animal, si on ne fait que le décrire avec des mots, on ne sait pas vraiment de quoi il s’agit. Donc l’illustration était primordiale.
DR 6. L’illustration didactique est un élément important de votre ouvrage.
CS Je suis un passionné de dessin et de bande dessinée, je suis moi-même illustrateur. A la fin du livre, j’explique pourquoi utiliser des illustrations plutôt que des photos. L’illustrateur met le point sur ce qu’il veut dire et quand le lecteur voit un dessin, il comprend. Dans une photo, il faut déchiffrer l’information, il y a beaucoup d’éléments perturbateurs, un angle de vue, une ombre.
DR 7. Pourquoi avez-vous fait intervenir différents illustrateurs ?
CS Une vingtaine d’illustrateurs en tout, il y a un côté poétique, quelque chose de plus diversifié et sensible. C’est comme si plein de gens donnaient aux enfants leur façon de voir le monde. Il y a des illustrateurs qui sont presque abstraits et d’autres qui sont très réalistes, donc ça permet d’avoir plein de regards différents, je trouvais ça intéressant. Et puis au départ, ce fut la volonté des éditrices de la rubrique que je tiens tous les mois, de permettre à des jeunes illustrateurs et illustratrices de s’essayer au dessin documentaire.
DR 8. Aujourd’hui, du point de vue de l’éco-critique, la notion de nature est remplacée par celle du vivant. Pensez-vous qu’il est plus cohérent de mettre en avant cette dernière notion dans les documentaires jeunesse ?
CS Alors concernant la nature oui, c’est un terme que j’essaie d’éviter mais ce n’est pas toujours facile. Il fait trop la division entre humains et le reste du vivant, comme si dans l’environnement il y avait l’être humain et la nature. On fait partie de la nature, c’est un ensemble. Baptiste Morizot, un philosophe scientifique, a écrit deux livres qui pour moi sont très importants. Dans le premier, Manière d’être vivant, l’auteur piste les loups et essaie de se mettre dans la peau d’autres animaux. Dans Raviver les braises du vivant, il nous donne des pistes pour que la vie puisse reprendre ses droits autour de nou. C’est celui-ci qui m’incite à ne pas utiliser le mot nature.
VII.2. Marie-laure Cruschi (Cruschiforme) autrice de « L’odyssée des graines » Gallimard jeunesse (2024).
Entretien réalisé le 18/01/2025 à 10h par téléphone.
Dominga Rodríguez 1. Vous concentrez de nombreux rôles dans la conception du livre, comment avez- vous relevé ce défi ?
Marie-laure Cruschi J’ai fait les écoles d’art donc l’image est mon premier moteur. J’ai travaillé l’ensemble des corps de métier du graphisme, parfois même la typographie, l’illustration, les choix de papier, les choix d’impression. L’avantage des grandes écoles d’art, c’est leur approche transversale et pluridisciplinaire qui permet de se sensibiliser autant à l’illustration qu’au graphisme. À l’époque où j’étais étudiante, il y avait des frontières très marquées entre les deux malheureusement.
Le travail d’écriture est venu seulement ensuite. Au début, j’avais un style quasiment encyclopédique et progressivement, j’ai développé un style plus narratif et poétique. Pour les livres documentaires, j’écris des récits qui cherchent un équilibre entre la documentation scientifique et une forme plus poétique et sensible.
Pour ce livre, Gallimard m’a donné beaucoup de liberté et m’a permis d’être complètement autonome. J’essaie de continuer à entretenir ce fonctionnement dans mes propres livres.
DR 2. Qui est votre lectorat ?
MLC Un lectorat le plus ouvert et le plus transversal possible, aussi bien les enfants que les parents qui accompagnent la lecture. Il y a cette volonté de pouvoir prendre le livre pour son aspect purement graphique pour s’éveiller visuellement à un sujet si on ne sait pas lire. Puis pour la lecture, cela commence avec des entrées simples avec juste le titre, afin de s’éveiller à la finesse du langage.
Aussi, je vise les spécialistes ainsi que le grand public. Donc, l’écriture vise un jeu d’équilibre entre science et art, c’est de la vulgarisation. C’était le gros défi de l’Odyssée des graines car c’est un sujet très spécialisé. Dans notre vie citadine, même si on mange des graines tous les jours, nous ne sommes pas entouré d’un environnement végétal et c’est difficile d’entretenir cette curiosité là.
DR 3. Quelle est la place de la poésie dans votre livre ?
MLC Dans ce livre, mon rôle n’est pas de pointer du doigt des dysfonctionnements dans la société mais de rappeler que nous perdons le lien avec la biodiversité. Je cherche à émerveiller, réenchanter, sensibiliser les lecteurs sur ce qu’on est en train de perdre. Pour moi, la question de l’émerveillement est centrale. Donc les formes plus poétiques, plus sensibles sont certes moins percutantes mais elles peuvent avoir un effet plus profond qu’une approche factuelle dans la sensibilisation du public.
DR 4. Quels choix graphiques avez-vous fait pour véhiculer au mieux votre propos ? (mise en page,illustrations, palette de couleur, police de caractère par exemple)
MLC Dans la mise en page du livre, il y un parti pris fort pour des textes très courts. C’est un ouvrage qu’on peut grignoter, il y a une certaine profusion de sujets autour de la thématique et il n’y a pas vraiment de début ni de fin.
Dans l’illustration de l’Odyssée des graines, le défi était de d’être le plus réaliste possible pour rendre hommage à la créativité du monde végétal. J’aborde chaque graine comme un objet de design, le travail de retranscription synthétise et renforce les spécificités de chaque graine et magnifie le réel. L’idée était de valoriser au maximum la créativité qui ne vient pas de moi mais qui vient vraiment de la nature.
La palette de couleur est limitée mais très ouverte, car il faut assez de liberté pour être réaliste. Pour la typographie, il fallait sortir de l’ouvrage de botanique encyclopédique classique donc pas d’empattement. Pour les titres j’ai emprunté au Bahaus. Toutefois, dans la littérature jeunesse l’enjeu de lisibilité est plus grand que dans la littérature adulte et cela réduit considérablement le spectre typographique.
DR 5. Parlez moi de votre technique d’illustration.
MLC Il a un travail de documentation en amont, parfois à partir de photographies mais je préfère avoir les graines sous la main afin de les observer à travers une table lumineuse par exemple.
La première étape est de crayonner et synthétiser la forme, les lignes de force, les axes de symétrie. Ensuite, je travaille avec Illustrator pour donner des formes très pures qui se prêtent bien au design. Ces formes sont ensuite sculptées et mises en lumière sur Photoshop.
Je me pose la question du plaisir de la lecture et cela amène à définir des zones de liberté et des zones de contraintes dans l’illustration. J’essayais de me concentrer exclusivement sur la graine, mais souvent c’est le fruit, qui engendre la dispersion de la graine, qui est le plus intéressant à illustrer. Donc je veille à être cohérente d’un point de vue scientifique mais je prends de la liberté afin d’apporter de la singularité au dessin. C’est un livre certes documentaire mais d’auteur, je fais un pas de côté par rapport à un illustrateur naturaliste rigoureux.
DR 6. Avez-vous incité l’éco-conception de l’ouvrage ?
MLC Quand on parle de plantes et d’arbres, on ne peut pas passer à côté de la question de l’empreinte écologique de fabrication du livre. Après, on ne peut pas faire tout ce qu’on veut car on est régi par des questions de rentabilité. La réalité économique est tellement verrouillée que même avec des efforts, les résultats sont assez discutables et il est difficile de valoriser les actions.
On cherche le juste équilibre entre l’esthétique, l’enjeu artistique et les contraintes techniques de fabrication liées à l’éco-conception. L’ensemble de la chaîne du livre est concerné par la question écologique, mais moi c’était juste pour la conception.
La maison d’édition Gallimard n’était pas la plus sensible et engagée sur le sujet, donc il a fallu inciter les équipes à se questionner et nous avons fabriqué le livre de manière plus éco responsable. Cela m’a permis de prendre conscience des problématiques vastes autour de la fabrication du livre et je continuerai à le faire.
DR 7. Faire rêver le lecteur renforce-il sa conviction écologique ?
MLC Je m’adresse à un lecteur qui n’a pas forcément de conviction. Faire rêver a le potentiel d’éveiller une sensibilité écologique et peut-être favoriser la mise en place d’un intérêt renforcé pour protéger l’environnement. Est-ce que faire rêver le lecteur peut renforcer sa conviction écologique ? Je pense qu’on a tous besoin de travailler notre imaginaire et que l’imaginaire est porteur d’utopie. Ça peut favoriser la mise en place de récits qui sont attentifs à la cause du vivant.
DR 8. Comment percevez-vous la notion du vivant ? Du point de vue de l’éco-critique dans le livre documentaire jeunesse.
MLC Le livre documentaire a refait surface il y a une dizaine ou quinzaine d’années. La question de l’environnement est beaucoup plus présente et le mot vivant est davantage présent dans la sensibilisation. Les sujets autour du vivant ne sont pas juste traités en matière de science et vie de la terre. Toutefois, il y a un gros contraste entre ce qu’on voit au programme scolaire et puis ce qu’on voit du discours des politiques, où la question du vivant est en second plan. Aussi, il y a des réappropriations de la notion du vivant dans approche stratégique et marchande et certains ouvrages perdent vraiment en cohérence.
Ouvrages
ABARZÚA, Rocío (traduction de l’anglais). Travesía botánica por Chile — Marianne North. Santiago : Libro Verde, 2024.
AUDIER, Serge. La société écologique et ses ennemis. Paris : Éditions la découverte, 2017.
BELHADJ, Nadja et MAJEWSKI, Marc. Le retour des Loups. Paris : Saltimbanque Éditions, 2022.
CHAMARET, Sandra (direction). De la couleur — comme un code. Paris : Co-édition Zeug et HEAR, 2016.
CHANSIGAUD, Valérie. Enfant et nature. À travers trois siècles d’oeuvres pour la jeunesse. Paris : Delachaux et niestlé, 2016.
CHANSIGAUD, Valérie. Histoire de l’illustration naturaliste. Paris : Delachaux et niestlé, 2009.
CASSANY, Lluís. Ellas y la Historia Natural: La naturaleza ilustrada por las mujeres. Barcelona : Mosquito Books, 2024.
DANSET-LÉGER, Jacqueline. L’enfant et les images de la littérature enfantine. Paris : P. Mardaga, 1980.
DE BROGLIE, Luis Albert. Deyrolle : Nature, art et éducation : leçons de choses & autres curiosités naturelles. Paris : Michel Lafon, 2022.
DEFOURNY, Michel. L’enfant et les images d’album, de 1950 à nos jours. Dans : Le livre et l’enfants — recueil de textes de Michel Defourny. Paris : De Boeck Supérieur, 2009.
DESCOLA, Philippe. Par-delà nature et culture. Paris : Gallimard, 2005.
DESMOULINS, Lucile et FAHYS, Pierre. « Quel futur sans nature ? ». Dans : Manifeste du muséum. Paris : Éditions du musée d’histoire naturelle, Relief éditions, 2017.
DURAND, Marion et BERTRAND, Gérard. L’image dans le livre pour enfants. Gradignan : l’École des loisirs, 1975.
GUILCHER, Jean-Michel. La vie cachée des fleurs. Paris : Flammarion - Montreur d’Images, 1950.
LECOINTRE, Guillaume (direction scientifique). Muséum Folie. Paris : Éditions du musée d’histoire naturelle, 2021.
LE GALL, Line et LAMY, Denis. « Les cyanotypes d’Anna Atkins ». Dans : Algues étonnants paysages. Paris : Delachaux et niestlé, 2019.
LAGOS, Ana et EYZAGUIRRE, Lorena. Los Secretos del Foye. Santiago : OchoLibros, 2024.
MELOT, Michel. Des archives considérées comme une substance hallucinogène. Paris : École nationale des chartes, 2023.
MORIZOT, Baptiste. Raviver les braises du vivant. Paris : Actes Sud, 2020.
MOSCIATTI, Octavia et SALINAS, Loreto. Reino Fungi — mundo entrelazado. Santiago : Amanuta, 2024.
OLDHAM, Todd. Charley Harper — An illustrated life. Los Angeles : Ammo Books, 2009.
PRINCE, Nathalie et THILTGES, Sébastien. Éco-graphies, écologie et littératures pour la jeunesse. Rennes : Presses Universitaires Rennes, 2018.
PLUCHE, Abbé Noël. Le spectacle de la nature. Paris : Bibliothèque Nationale de France, 1732.
SCHOENTJES, Pierre. Ce qui a lieu — Essai d’écopoétique. Marseille : Éditions Wildproject, 2015.
STAEBLER, Christian. Visions d’animaux pour mieux comprendre le monde. Angoulême : Biscoto édition, 2024.
STIFF, Ruth et PONSONBY, Laura. Margaret Mee – Marianne North Exploratrices Intrépides – Oeuvres Des Collections Des Royal Botanic Gardens, Kew. Londres : La Mona Bismarck Foundation, 2007.
TASCHEN. The Art and Science of Ernst Haeckel. Paris : Taschen Multilingue, 2017.
WANG & SÖDERSTRÖM, DIA, SAVOIE Alice, DUBOIS, David et Séoul. « Design et Écologie ». Dans : Etapes : design graphique & culture visuelle, Vol 243. Paris : Les Éditions Etapes, 2018.
WULF, Andrea. L’invention de la nature: Les aventures d’Alexander Von Humboldt. Les Éditions Noir sur Blanc, 2017.
Revues
BEAUCHAMP, Jeanne. « Agatha Liéven-Bazin, Éthologue et autrice — De l’importance de la vulgarisation scientifique ». Dans : Citrouille, La revue des librairies sorcières, nº99 : « Dossier animaux & nous — Ce qui nous lie », 2024.
MEYER, Virginie. « Critiques documentaires ». Dans : BnF, La revue des livres pour enfants, nº328 : « Dystopies?! », 2023.
MEYER, Virginie. « La nature ça n’existe pas — nouveaux regards sur le vivant dans les livres documentaires pour la jeunesse ». Dans : BnF, La revue des livres pour enfants, nº336 : « Que peut-on pour la nature ? », 2024.
KOSMALA, Lucie. « La création à l’épreuve de la responsabilité : deux points de vue engagés ». Dans : BnF, La revue des livres pour enfants, nº336 : « Que peut-on pour la nature ? », 2024.
VAN DER LINDEN, Sophie. « L’album entre texte, image et support ». Dans : BnF, La revue des livres pour enfants, nº214 : « L’analyse des livres d’images », 2003.
Articles
BENČINA CAMPOS, Jǒzepa. Marianne North: Su legado en la ilustración
naturalista y su paso por Chile. Laderasur. 1 de agosto, 2024.
https://
BOITTIAUX, Inès. Anna Atkins, Pionnière méconnue du cyanotype célébrée
dans un beau livre. 10 octobre 2023. Essentiels.bnf.
https://
CODEX 99. A Charley Harper Retrospective, part IV. 30 Juillet 2015.
Codex99. http://
DROPPELMANN A, Veronica. Ilustradora Loreto Salinas, más de una década
impulsando la relación de los niños con la naturaleza. Ladera Sur. 9 décembre 2021.
https://
ESPINOSA, Pablo. Loreto Salinas, ilustradora: « Reino Fungi subraya la
importancia de ver la naturaleza como un todo integrado ». 30 septembre
2024. fundacionlafuente
GUILLAIN, André. La narration graphique chez l’enfant. Paris : Tréma, 1992. [En ligne]. Disponible sur :
http://
GUIGNARD LEGROS, Virginie. Repenser la littérature jeunesse avec
l’évolution des pratiques et des possibilités. Cursus. 8 décembre 2019.
https://
HAMAIDE-JAGER, Eléonore et GAIOTTI, Florence. Rythmes et temporalités
de l’album pour la jeunesse. 10 / 2016. Journals.openedition.
https://
IDE, Javiera. Cinco mujeres extraordinarias de la exploración y la
ciencia. 23 avril 2018. Laderasur
KEMPF, Hervé. Philippe Descola : « La nature, ça n’existe pas ». 1 février 2020. Reporterre
LOGAN, Liz. Wild About Charley Harper’s NatureArt. 24 Septembre 2015.
Wsj
MULLER, Camille. Humboldt — L’invention de la nature biodiversité, voyage. 12 octobre 2023. learningfromlandscapes.
https://
PIFFAULT, Olivier. Le livre pour enfants après 1968. Essentiels.bnf.
https://
PIQUARD, Michèle. Paul Faucher, concepteur des albums du Père Castor, sergent recruteur de la Nouvelle Éducation dans l’entre-deux-guerres.
04 mars 2011. Journals.openedition.
https://
RENONCIAT, Annie. Origines et naissance de l’album moderne. 12 octobre
2022. Essentiels.bnf.
https://
Documents web
BnF Les essentiels. L’Atelier du Père Castor présente : la vie cachée
des fleurs – Le montreur d’images, Flammarion Père Castor.
Essentiels.bnf.
https://
BnF Les essentiels. L’album, emblème de l’évolution du livre pour
enfants. 07 avril 2016. Essentiels.bnf.
https://
GUILLAIN, André. La narration graphique chez l’enfant. Paris : Tréma, 1992. http://
MEUNIER, Christophe. Terre des hommes, enfants de la Terre. Quand le
Père Castor se mêle de géographie. (1/5), 7 avril 2016
https://
PLUCHE, Abbé Noël. Le spectacle de la nature. Paris : Bibliothèque
Nationale de France, 1732.
https://
Sitographie
Beaux Arts — Anna Atkins. https://
www
BNF Essentiels. https://
Charley Harper. Art Studio.
https://
Deyrolle Territoires.
https://
Éditions BNF. https://
Fundación La Fuente. https://
The Invention of Nature.
https://
Master STS Hypotheses. https://
Musée du Havre — Illustrations naturalistes d’Ernst Haeckel.
https://
Muséum National d’Histoire Naturelle — Géographie des plantes
équinoxiales.
https://
Musée du Vivant — L’écologie, définition.
http://
Open Edition Journals. https://
Videographie
CANAL9. Matinal Nuestra Casa. Secretos del Foye: Libro ofrece una
mirada profunda al patrimonio cultural. 15 juillet 2024. durée 16:30 min.
https://
GALLIMARD JEUNESSE. L’odyssée des graines. Réalisation : Cruschiform.
Disponible sur YouTube. 30 septembre 2024. Vidéo, durée 2 min 11.
https://
CINCINNATI MUSEUM CENTER. CMC Q&A – Brett Harper on the Art and
Activism of Charley Harper. Disponible sur YouTube. 30 septembre 2020.
Vidéo, durée 49 min 18. https://
Je tiens à remercier chaleureusement Marie-Laure Cruschi et Christian Staebler pour avoir accepté de contribuer à cette recherche, pour son enthousiasme et ses précieux conseils. Je remercie également mes professeures, Perrine Saint Martin et Alexandra Aïn, qui m’ont accompagnée tout au long du processus de recherche et de rédaction. Enfin, un immense merci à mon mari pour son aide précieuse dans la traduction de certaines idées de l’espagnol vers le français ainsi que dans la relecture et la correction de mon écriture et de ma grammaire.
DE BROGLIE, Louis Albert. Deyrolle, Leçons de choses, tomes 1 & 2. Paris : Éd. Michel Lafon, 2013. pp. 79. ↩︎
PLUCHE, Abbé Noël. Le spectacle de la nature. Bibliothèque Nationale de France, 1732. ↩︎
Source : museeduvivant
.fr [Consulté le 04 janvier 2025]. ↩︎PRINCE Nathalie, THILTGES Sébastien. Éco-graphies, écologie et littératures pour la jeunesse. Presses Universitaires Rennes, 2018, pp.35. ↩︎
RENONCIAT, Annie. Origines et naissance de l’album moderne. 12 octobre 2022. Essentiels.bnf. Essentiels
.bnf [Consulté le 04 janvier 2025]. ↩︎MEYER, Virginie. « La nature ça n’existe pas – nouveaux regards sur le vivant dans les livres documentaires pour la jeunesse ». Dans : BnF, La revue des livres pour enfants, nº336 : « Que peut-on pour la nature ? », 2024. ↩︎
Selon Sophie Van Der Linden, spécialiste de la littérature jeunesse, il s’agit de livres qui s’inscrivent dans la découverte du loisir de la lecture. ↩︎
MULLER Camille. Humboldt — L’invention de la nature biodiversité, voyage. 12 octobre 2023. learningfromlandscapes. learningfromlandscapes
.com [consulté le 06 janvier] ↩︎Goethe est l’un des précurseurs de la naturphilosophie, une science qui privilégie une approche qualitative des espèces, en proposant de considérer l’organisme végétal et plus largement, l’être vivants dans sa globalité et son devenir. ↩︎
LE GALL Line et LAMY Denis. « Les cyanotypes d’Anna Atkins » Dans : Algues étonnants paysages. Delachaux et niestlé. Paris : 2019, pp.106. ↩︎
BOITTIAUX Inès. Anna Atkins, pionnière méconnue du cyanotype célébrée dans un beau livre. 10 octobre 2023. beauxarts. beauxarts
.com [consulté le 06 janvier] ↩︎AUDIER Serge. La société écologique et ses ennemis. Paris : Editions la découverte, 2017. ↩︎
STAEBLER, Christian. Visions d’animaux pour mieux comprendre le monde, Biscoto, 2024, pp.124. ↩︎
DE BROGLIE, Luis Albert. Deyrolle : Nature, art et éducation : leçons de choses & autres curiosités naturelles. Paris : Michel Lafon, 2022. ↩︎
RENONCIAT, Annie. Origines et naissance de l’album moderne. 12 octobre 2022. Essentiels.bnf.essentiels
.bnf [Consulté le 04 janvier 2025]. ↩︎.fr BnF Les essentiels. L’album, emblème de l’évolution du livre pour enfants. 07 avril 2016. Essentiels.bnf. essentiels
.bnf [Consulté le 04 décembre]. ↩︎.fr MEUNIER, Christophe. Terre des hommes, enfants de la Terre. Quand le Père Castor se mêle de géographie. 07 avril 2016. Hypotheses. lta
.hypotheses [Consulté le 10 janvier]. ↩︎.org PRINCE Nathalie, THILTGES Sébastien. Éco-graphies, écologie et littératures pour la jeunesse. Presses Universitaires Rennes, 2018, pp.135. ↩︎
OLDHAM, Todd. Charley Harper — An illustrated life. Los Angeles : Ammo Books, 2009. Traduit de l’anglais : CODEX 99. A Charley Harper Retrospective, part VII. 30 Juillet 2015. Codex99. Codex99
.com [Consulté le 20 janvier]. ↩︎CODEX 99. A Charley Harper Retrospective, part IV. 30 Juillet 2015. Codex99. Codex99
.com [Consulté le 20 janvier]. ↩︎OLDHAM, Todd. Charley Harper — An illustrated life. Los Angeles: Ammo Books, 2009. Traduit de l’anglais: CODEX 99. A Charley Harper Retrospective, part VII. 30 Juillet 2015. Codex99.Codex99
.com [Consulté le 20 janvier]. ↩︎Comme para exemple : coutumes, croyances, tradition orale, vision du monde des peuples autochtones. ↩︎
Dont Christian Staebler. Certains des illustrateurs avaient déjà publié des travaux dans le journal Biscoto. ↩︎
« Cela veut dire qu’elle essaye d’expliquer quelque chose qui existe réellement » STAEBLER, Christian. Vision d’animaux pour mieux comprendre le monde, Biscoto, 2024, p. 156. ↩︎
Traduit en français : Le Règne des Champignons. ↩︎
Animales Chilenos, Ed. Varias 2013 ; Jardín de Chile, Ed. CEA Libros, 2020 ; Animales Peruanos, Ed. Planeta, 2020 ; Animales Argentinos, Ed. Ororeja, 2000 ; Agua y tierra, Anfibios y reptiles de América, Ed. Amanuta, 2022 ; Animales Mexicanos, Ed. Hueders, 2015. ↩︎
Les typographies Oldstyle Fat Faces, font honneur à l’élégance distinctive des polices anciennes, telles que Cooper Black, avec un fort contraste et des formes arrondies et volumineuses. ↩︎
Le mycélium est l’appareil végétatif des champignons, formé d’une masse de filaments plus ou moins ramifiés généralement blancs, sur lequel poussent les champignons. ↩︎
Désignant le type de champignon Amanita Muscaria, une espèce de champignon basidiomycète de la famille des Amanitaceae. ↩︎
ESPINOSA, Pablo. Loreto Salinas, ilustradora: « Reino Fungi subraya la importancia de ver la naturaleza como un todo integrado ». 30 septembre 2024. fundacionlafuente. fundacionlafuente
.cl [Consulté le 20 janvier]. ↩︎Comment nomenclature latine et la descriptions des espèces. ↩︎
Marie-laure Cruschi (Cruschiform), L’odyssée des graines, Gallimard jeunesse, 2024, pp.151. ↩︎
La page contenant le texte du message environnemental, en bleu cobalt, est placée cette fois sur la page de droite. pp.151 ↩︎
Cette fois, sur la première page de lecture, la page de gauche, l’autrice place une illustration vectorielle du paysage fluvial avec des ours polaires sur la glace fondante et au loin le bâtiment de la chambre forte. ↩︎
« Ces dernières années, depuis les découvertes de Jane Goodall, de nombreux ouvrages ont mis l’accent sur les formes de sensibilité, de sentience et d’intelligence non humaines ». MEYER, Virginie, La nature ça n’existe pas – nouveaux regards sur le vivant dans les livres documentaires pour la jeunesse. Dans : BnF, La revue des livres pour enfants, no336 : « Que peut-on pour la nature ? », 2024. pp.108. ↩︎
Le livre n’a pas de traduction officielle en français. Le Foye est une espèce d’arbre dont le nom scientifique est Drimys winteri. ↩︎
Un album jeunesse photographique est un livre composé de photographies, accompagnant généralement d’un texte, qui peut être un récit de fiction, éducatif ou documentaire. ↩︎
Le patrimoine culturel immatériel représente l’intangible (pratiques, représentations, expressions, connaissances, croyances et savoir-faire) et les objets tangibles (instruments, matériaux, artefacts) ou lieux qui lui sont associés pourraient être considérés comme du patrimoine matériel. ↩︎
Les Mapuches (peuple de la terre) en mapudungún, leur langue native. Ils constituent le peuple autochtone le plus nombreux du Chili, historiquement installé dans le centre-sud du pays. Ils font preuve d’une forte cohésion culturelle et une identité fondée sur le respect de la pachamama (mère‑nature) en mapudungún. Pendant la période coloniale, le peuple mapuche a lutté et résisté avec acharnement face à la conquête espagnole. ↩︎
Foye correspond au nom commun de l’arbre en langue mapuche (Mapudungún) et Canelo, au nom commun en espagnole. ↩︎
Le réensauvagement consiste à laisser la nature prendre soin d’elle-même, de permettre aux processus naturels de façonner la terre et la mer, de réparer les écosystèmes endommagés et de restaurer les paysages dégradés. ↩︎
La cosmovision mapuche est une vision holistique du monde. Elle implique que toute action qui affecte la nature a des répercussions dans la communauté et le divin. Les Mapuches croient en l’existence de forces spirituelles qui habitent le monde vivant, comme les ngen (esprits protecteurs de la terre, de l’eau et des forêts). ↩︎
« La nature n’est jamais loin dans mes images et mes histoires, et elle toujours associée à quelque chose de rassurant ou de merveilleux ». Lisons Jeunesse ! par Manon. Rencontre — Fêtons le printemps avec Marc Majewski ! 14 avril 2023. Lisonsjeunesse. lisonsjeunesse
.fr [Consulté le 20 janvier]. ↩︎Un album jeunesse illustré est un livre composé d’illustrations, accompagnant généralement d’un texte, qui peut être un récit de fiction, éducatif ou documentaire. ↩︎
BELHADJ Nadja et MAJEWSKI Marc. Le Retour des Loups. Paris : Saltimbanque Éditions, 2022. ↩︎
L’écocritique analyse la manière dont la littérature représente le rapport entre les humains et la nature à des moments particuliers de l’histoire. ↩︎
Pierre Schoentjes, écrivain français et auteur de l’œuvre, Ce qui a lieu : Essai d’écopoétique, 2015. Définir l’écocritique française d’écopoétique : l’étude du rapport entre la littérature et l’environnement naturel. ↩︎
Traduit de l’espagnol : ESPINOSA, Pablo. Loreto Salinas, ilustradora: « Reino Fungi subraya la importancia de ver la naturaleza como un todo integrado ». 30 septembre 2024. Fundacionlafuente. Fundacionlafuente
.cl [Consulté le 13 octobre 2024]. ↩︎Ibid. ↩︎
PRINCE Nathalie et THILTGES Sébastien. Éco-graphies, écologie et littératures pour la jeunesse. Presses Universitaires Rennes, 2018, pp.33. ↩︎