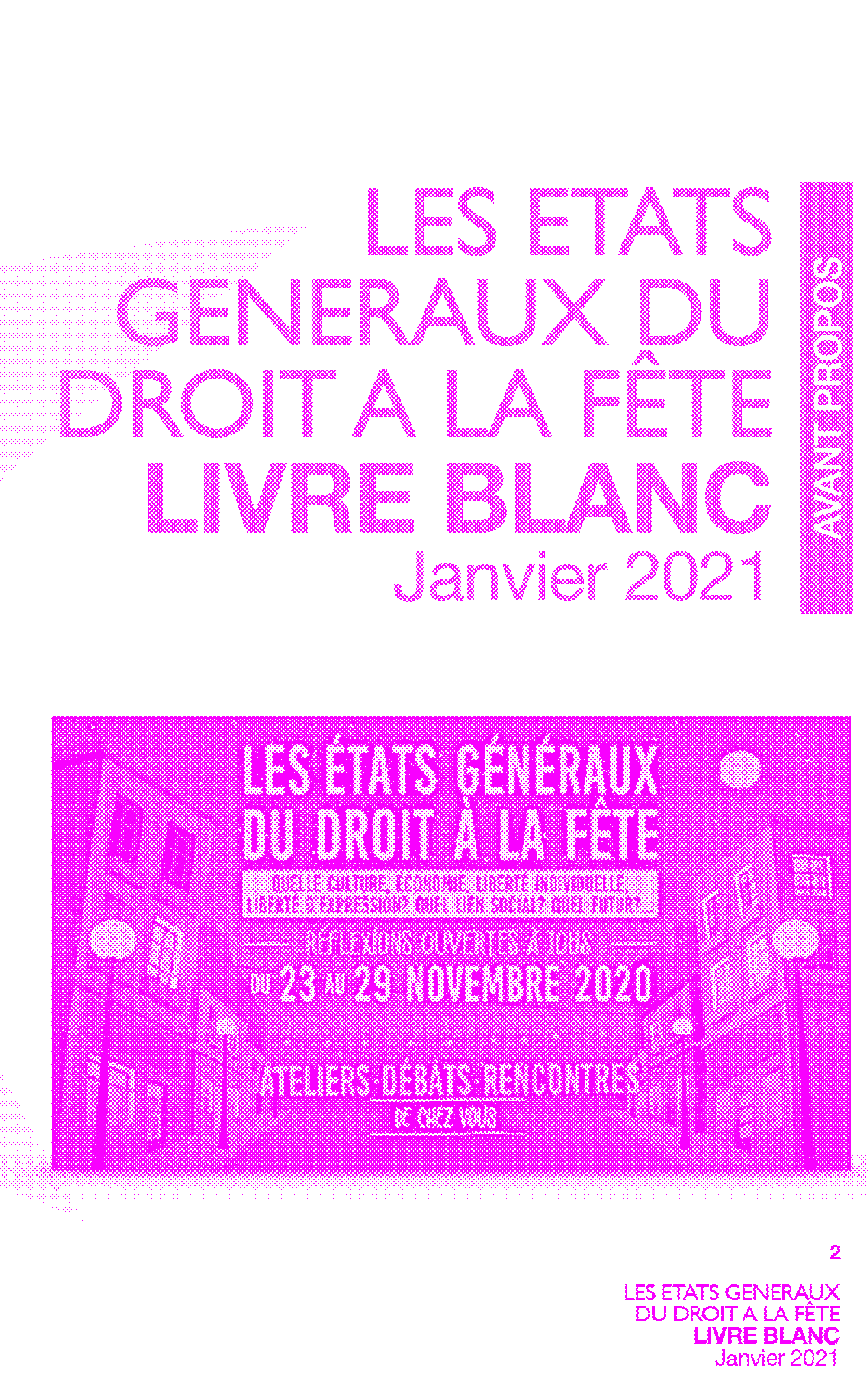
« La nuit doit revoir le jour ». Derrière le beau slogan médiatisé se cache la détresse des acteurs de la fête et de la nuit qui s’insurgent depuis des mois contre la fermeture de leurs établissements et craignent l’effondrement. La situation inédite, les difficultés rencontrées et les risques encourus par les acteurs économiques et culturels, nécessitent une mobilisation nationale, qui dépasse l’approche sécuritaire et anxiogène, une mise à l’agenda de la nuit qui ouvre des perspectives en termes d’expérimentations, de droit et de politique publique dans le respect des règles sanitaires. Alors que « tout s’oppose à la nuit », la crise sanitaire est aussi l’occasion de changer de regard sur nos vies et sur nos villes.
Au-delà des discothèques, c’est tout un monde qui vacille et avec lui une partie de notre vie sociale. La nuit est un temps particulier pour la fête et un moment essentiel d’interactions pour nos villes, nos quartiers et nos villages. Quand le couvre-feu s’installe, quand la fête devient impossible, quand les salles ferment, quand les événements sont annulés, quand celles et ceux dont le métier est de favoriser la convivialité, le plaisir et la rencontre sont interdits d’exercer, c’est un secteur économique important, des emplois mais aussi une culture, un art de vivre, un monde, et notre santé mentale qui sont directement menacés. Se rencontrer, partager et s’émerveiller ensemble est vital. Que se passera-t-il si 30% des établissements de nuit disparaissent. Que deviendront nos villes avec leurs nuits vides et en friches ?
Les difficultés ne sont pas apparues avec la crise. Entre liberté et insécurité, la nuit est un monde en mutation permanente. Le poids des réglementatons, l’aseptisation de certains quartiers, les cohabitations parfois douloureuses entre usagers et résidents, l’évolution des modes de vie et de consommation avaient déjà fragilisé ce secteur et ses multiples acteurs. En ce sens la Covid est un révélateur mais aussi l’occasion d’une mobilisation et d’une prise de conscience plus larges. Elle met notamment en évidence l’importance de « l’espace public » au sens politique du débat et de l’opinion et celle « des espaces publics » au sens architectural du terme avec les rues et les places, le besoin d’Etats généraux pour échanger et celui d’actions locales pour tester. C’est là, à l’extérieur des établissements que le rebond et les expérimentations ont été possibles. C’est par ces dépassements, permis par les débats et l’expérimentation in situ, que des solutions ont vu le jour.
Comme souvent en cas de crise, les interdictions ont d’abord frappé la nuit. Les établissements ont été les premiers à fermer. Ils seront les derniers à ouvrir. Le secteur a subi la double peine du confinement et du couvre-feu et les acteurs économiques et culturels ont l’impression d’être incompris. Le virus muterait-il après 20h ? Pourquoi les autorités ont-elles toujours peur de la nuit, de la fête et des jeunes. Pourquoi ne pas faire confiance aux professionnels responsables et expérimentés et laisser s’organiser des fêtes clandestines avec leurs lots de débordements et de stigmatisations associées. L’approche réglementaire semble également avoir pris le pas sur la reconnaissance des dynamiques locales. Les mesures prises de façon abrupte et « d'en-haut » le sont souvent par méconnaissance de la nuit, de la fête et de ses acteurs, de son importance accrue en termes d’économie, d’emploi, d’atractivité, de création et comme élément central de nos modes de vie et du bien-être. Pour nombre de professionnels, ceLe méconnaissance rime souvent avec absence de reconnaissance, voire mépris pour certaines formes artistiques et certains lieux de diffusion comme les scènes électro, rap ou métal. On peut reprocher l’approche négative de la nuit toujours abordée en termes de problèmes, de difficultés et de peur. Elle ne prend pas suffisamment en compte le travail transversal engagé localement, autour « d’Etats généraux », de diagnostics, de démarches de prévention, de plateformes d’échanges, de « conseils de la nuit », de « maires de nuit et l’invenAon de nouveaux outils de médiations comme les « chartes de nuit ». La question sanitaire doit être abordée de manière globale en regard d’autres dimensions centrales de la nuit, de la culture et de la fête (économie, social, urbanisme, mobilité, environnement, éthique…).
Au-delà des récriminations, les acteurs de la fête et de la nuit ont multiplié les initiatives tentant notamment de s’adapter avec des propositions à l’extérieur dans l’espace public ou une offre en ligne. Faisant preuve de responsabilité, de créativité et d’innovation, ils ont imaginé des agencements inédits entre établissements de tailles et d’activités diverses, secteur public et secteur privé, espace privé et espace public. Dès le premier confinement, ils ont cherché à coopérer avec les autorités locales, à se projeter vers demain en posant des quesAons d'éthique, de soutenabilité de la fête et en proposant le développement d’écosystèmes nocturnes à l'échelle de quartiers avec les résidents et la définition d’espaces publics plus malléables et modulables pour accueillir des activités et favoriser l’adaptation.
Elaborés en partenariat, naturellement interdisciplinaires, mélangeant acteurs du monde culturel, de la nuit, de la prévention, de la réduction des risques, représentants des pouvoirs publics, techniciens des collecAvités, élus et universitaires, ces sept jours d’Etats généraux, d’ateliers, de débats et de rencontres ont permis d’établir un premier état des lieux sur un monde fragilisé par la crise qui résiste et s’organise. Il se structure, innove, interpelle sur les enjeux, cherche une reconnaissance et propose des pistes dans un dialogue inédit entre le local et le global, les acteurs de terrain et les autorités. En cela aussi la nuit innove et éclaire le jour. La réussite de la dynamique qui s’engage Aent notamment à une forte articulation entre les acteurs économiques et culturels, les pouvoirs publics et les chercheurs mais aussi à un dialogue renouvelé entre l’échelon local et l’échelon national.
Le Livre blanc est un « appel à la confiance » lancé vers les pouvoirs publics et les territoires. Les propositions dépassent le simple catalogue de revendications sectorielles pour faire émerger un « droit à la fête ». La réflexion transversale (santé, culture, économie, sécurité, tranquillité publique, urbanisme, développement durable, numérique, solidarité, mobilité…) permet d’esquisser les contours d’une indispensable « politique publique de la nuit » dans les villes, les quartiers, les territoires ruraux et péri-urbains et à l’échelle du pays. Dans la pratique, des « conseils de la nuit » pourraient être déployés sur tout le territoire. A l’échelle du pays, la création d’un « Conseil national de la nuit » associant compétences empirique, technique, scientifique et politique est proposée.
La réflexion qui s’engage sous la pression de la crise sanitaire doit permetre d’échapper aux réponses binaires pour déployer une « pensée nuitale » qui invite à la mesure (« sans lumière pas de ville la nuit mais trop de lumière tue la nuit ») et oblige à la co-construction au plus près du terrain et avec tous les acteurs concernés. La crise est l'occasion de sortir par le haut et de prendre au sérieux la nuit, la culture, ses acteurs et ses espaces. La nuit a assurément beaucoup de choses à dire au jour et au futur de nos territoires. Protégeons nous et profitons-en pour imaginer ensemble les nuits de demain mais aussi les vies et les villes « qui vont avec ». Question d’imaginaire, de responsabilité et de confiance.
Lien vers le texte completintervention de Luc Gwiazdzinski : Géographe - Professeur à l’ENSA Toulouse Président du Conseil scientifique de la Plateforme de la vie Nocturne, tiré du texte "LES ETATS GENERAUX DU DROIT A LA FÊTE LIVRE BLANC", Janvier 2021